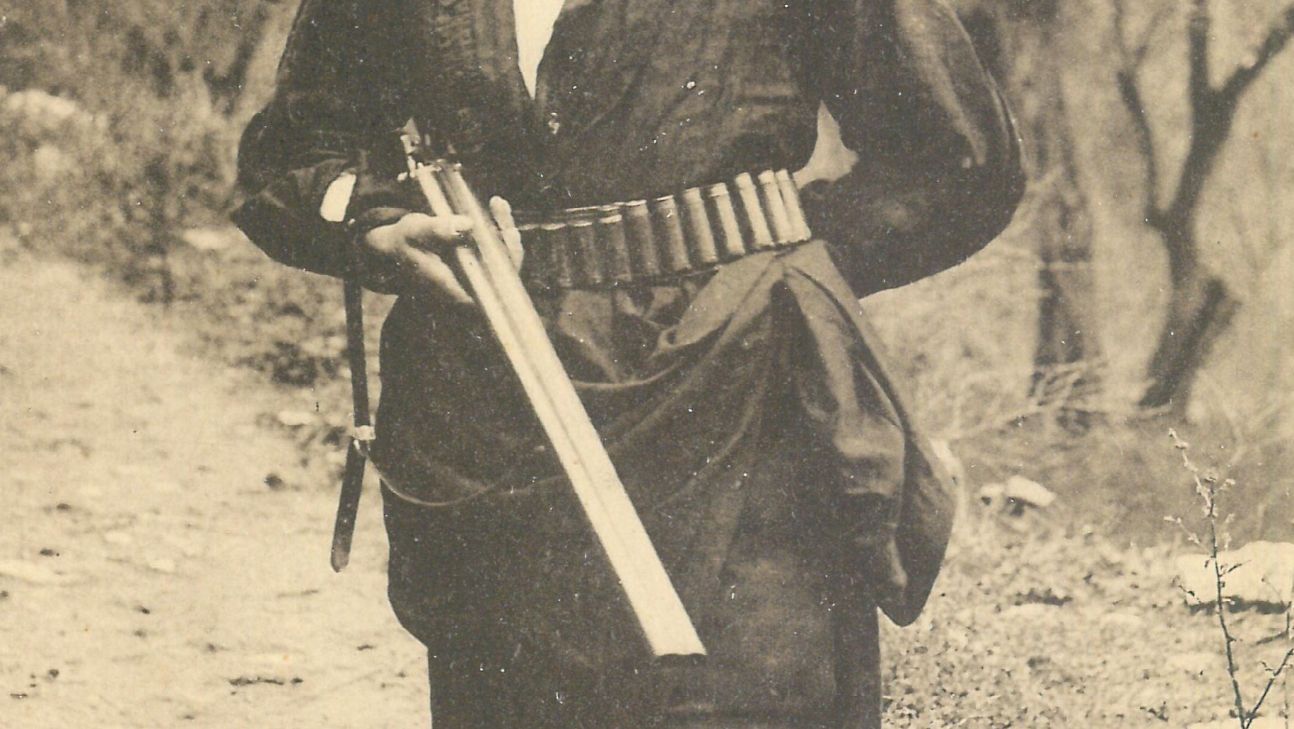Nos fragilités
En chacun de nous une fêlure passe, elle menace l'ensemble, l'organise, elle est notre chance et notre péril le plus haut. C'est sur cette conviction que Charlotte Casiraghi a conçu son nouvel essai qui paraît sous le titre La Fêlure (Julliard) : "comme une enquête vivante, littéraire, incarnée, sur les petites et les grandes tragédies de notre sort partagé, et qui sont sans doute le lieu à partir duquel nous pensons et aimons avec la plus grande intensité. C'est aussi le lieu où nous risquons de casser, de nous détruire, de perdre, d'abîmer les autres, de nous gâcher mais où nous sommes capables de déplacer notre identité et de réinventer notre existence. Il y a des effondrements visibles et spectaculaires, et des craquelures minuscules en surface, dont on ne prend conscience qu'après, une fois qu'on est brisé". Un livre qui est aussi comme une traversée, à partir d'une célèbre nouvelle de Fitzgerald et à travers les œuvres des écrivaines Ingeborg Bachmann, Colette ou Marguerite Duras, de la poétesse Anna Akhmatova, du navigateur Bernard Moitessier ou du chanteur J. J. Cale, et bien d'autres. Fabula vous invite à en lire un extrait…
Les éditions de Minuit rééditent de leur côté dans leur collection de poche l'un des derniers livres du philosophe Jean-Louis Chrétien, disparu en 2019, et auquel un ouvrage collectif est récemment venu rendre hommage : un essai sur la Fragilité comme sur l'un des traits essentiels de la condition humaine. Ce "lieu commun" de notre compréhension de nous-mêmes parcourt tous les domaines, de la philosophie à la poésie, du roman à la peinture ou à l’histoire. Bien que nul ne l’ignore, chaque homme le découvre en acte avec une sorte de saisissement et d’effroi. J.-L. Chrétien en décrit d’abord les figures variées : le dénuement du nourrisson, les matières fragiles (verre, argile, bulle de savon), la fêlure invisible qui soudain produit la catastrophe, ou enfin la poétique des ruines. Il y va dans un second temps du concept même de fragilité, de Sénèque à Kant en passant par saint Augustin, qui donnera à la fragilité un sens moral que la modernité tentera d’écarter. Le livre s’achève sur la fragilité de la voix humaine, qu’un rien peut briser, qui pourtant dit le sens qui ne périt pas et que l’homme se transmet, en le renouvelant, d’une génération à l’autre. Pour Acta fabula, Chloé Vettier avait rendu compte de l'ouvrage lors de sa première parution : "Pour une généalogie de la fragilité".