par Marc Escola
(Université de Lausanne)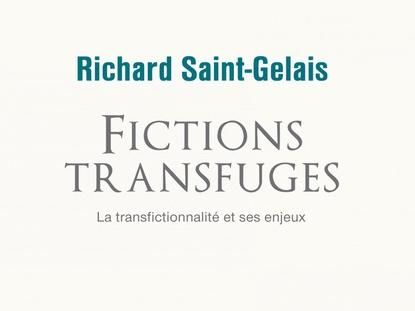
Paru en 2011 aux éditions du Seuil dans la regrettée collection « Poétique », Fictions transfuges de Richard Saint-Gelais traitait de « la transfictionnalité et ses enjeux », en constituant en objet d'étude cette étrange faculté qu'ont les personnages de fiction de s'émanciper des œuvres qui leur ont donné le jour pour aller peupler d'autres œuvres et, pour reprendre la formule consacrée, connaître d'autres aventures. Conçu comme une sorte de supplément, ou comme un versant peut-être inattendu de ce phénomène, le dernier chapitre de l'ouvrage s'interrogeait sur le possible recours de la critique littéraire à des opérations transfictionnelles.
Reprenant une notion qu'il avait abordée dans un ouvrage antérieur[1], R. Saint-Gelais proposait d'appeler parafictionnalisations les éléments que tout lecteur d'un texte de fiction produit pour les « verser aussitôt au compte de la fiction » (p. 458) ; posant que « l'activité parafictionnelle n'est pas confinée à la lecture ordinaire », il montrait que « les ouvrages théoriques y ont fréquemment recours », en s'intéressant notamment à l'holmésologie (p. 462-471), aux spéculations sur les textes possibles qui font le sel des Lettres sur La Princesse de Clèves publiées dès 1678 par l'un des premiers lecteurs du roman, Valincour (p. 471-482), mais aussi aux « critiques transfictionnelles avouées » (p. 499-522), et notamment à la démarche de Pierre Bayard dans Qui a tué Roger Ackroyd ? (1998).
Le discours critique peut-il revendiquer une activité qui relève de l'imagination fictionnelle ? Est-il à même d'assumer une dimension transfictionnelle ? En d'autres termes : peut-il s'autoriser à étendre délibérément la diégèse du texte pour pouvoir le commenter ?
Dossier Transfiction.
Marc Escola — L'activité de parafictionnalisation dans le discours critique peut être rapportée au paradoxe du commentaire (suffisamment souligné dans les années 1960 par T. Todorov comme par M. Foucault, cités au passage) : prétendre déployer le sens d'un texte, c'est supposer que le texte ne dit pas tout, et donc postuler son incomplétude pour se donner l'opportunité de suppléer ce qui manque (« Comme les lecteurs lors de leur parcours du texte, les critiques produisent des parafictionnalisations dans une optique dominée par la recherche de l'équivalence sémantique, mais qui ne peut passer que par une élaboration qui excède le texte », p. 460). Par ailleurs, cette activité parafictionnelle dans le discours critique a ceci de paradoxal que la part d'invention doit être sans cesse déniée : les éléments forgés pour les besoins de l'interprétation (par exemple, telle hypothèse sur les motivations d'un personnage) sont régulièrement donnés comme « exacts », et aussitôt « résorbés » par l'équivalence sémantique. Comment s'articulent ces deux paradoxes ? Doit-on penser que, dans le cas des textes de fiction, ils n'en forment qu'un seul ? Tu ne sembles pas tenté d'assimiler le second au premier : alors même que tu multiplies les exemples de moments parafictionnels dans le discours critique, tu poses que le geste transfictionnel n'est pas inhérent à la critique (p. 523), tout en soutenant in fine que « la frontière entre métatextualité (le texte ne dit pas si…) et parafictionnalisation (on ne sait pas si tel personnage…) est à ce point si mince qu'il est aisé de basculer dans la critique transfictionnelle » (p. 529).
Richard Saint-Gelais — Je répondrai d'abord sur le dernier point en disant qu'effectivement, il me paraît important de refuser d'assimiler tous les gestes critiques — et, plus largement, tous les résultats de la lecture — à des parafictionnalisations. Mon objectif, lorsque j'ai élaboré cette notion dans Châteaux de pages, était de rendre compte de dispositifs textuels qui perturbent la fiction « de l'extérieur », d'une manière qu'on ne puisse réduire à la logique interne de cette fiction — des dispositifs, donc, qui résistent aux tentatives de les parafictionnaliser lors de la lecture ; je pense notamment aux troublants changements d'identité qui affectent les personnages de La Maison de rendez-vous de Robbe-Grillet ou aux modifications de statut ontologique (images dont la description se transforme en récit d'une scène animée, ou inversement) que Jean Ricardou décrit comme des « captures » et des « libérations »[2]. Il s'agissait en somme de décrire (et en même temps de circonscrire) une opération lecturale fondamentale, mais souvent mésestimée, dans l'instauration des effets de représentation.
On peut en effet parler de parafictionnalisation lorsqu'un résultat de lecture est rapporté à la fiction, à l'univers fictif, par la personne qui a produit ce résultat ; or tout ce que produit la lecture ne peut pas se voir attribuer un tel statut. Prenons un exemple des plus simples : dans l'une des éditions de Nada de J.-P. Manchette apparaît le nom « Loindexter », que le lecteur n'avait jamais rencontré jusque-là et qu'il ne reverra plus par la suite[3] ; le lecteur a en revanche croisé à plusieurs reprises un autre nom, « Poindexter » ; la conclusion à laquelle s'arrête l'immense majorité des lecteurs, c'est évidemment que « Loinexter » est une simple coquille pour « Poindexter ». Relever la différence entre les deux noms, et y voir une faute d'impression, est ici une opération lecturale banale, accomplie sans même s'y arrêter, mais qui repose sur des calculs interprétatifs moins simples qu'il n'y paraît, reposant notamment sur l'hapax que constitue ce nom et sur sa quasi-identité avec celui d'un des principaux personnages du récit[4]. Or ce qui caractérise cette interprétation est qu'elle nous fait sortir du cadre de la fiction, en faisant intervenir, au sein de l'espace rescriptural de la lecture, le texte comme artefact typographique, avec les accidents qui peuvent l'affecter. Mais on peut, à travers une expérience de pensée, concevoir une parafictionnalisation de ce « Loindexter », par exemple en avançant la supposition que le récit introduit inopinément un nouveau personnage, ambassadeur comme Poindexter, mais qui se nomme Loindexter ; ou alors, sachant que le passage est focalisé sur l'agent Bunker, l'un des gardes du corps de l'ambassadeur, si l'on postule que ce « Loindexter » est une erreur commise par ce personnage, qui se tromperait sur le nom de l'ambassadeur qui l'emploie[5]. Dans les deux cas, ce à quoi la lecture rapporterait ses résultats — apparition d'un nouveau protagoniste, erreur d'un personnage —, ce n'est pas au texte comme tel, mais la fiction elle-même.
Les procédés de parafictionnalisation ont ceci de fascinant qu'ils montrent la lecture en train de contribuer à l'édification de la fiction, que ce soit par des inférences (par exemple, les motivations psychologiques d'une action d'un personnage), par la figuration mentale (lisant « Il court à perdre haleine », nous nous figurons les jambes du personnage en mouvement, la modification de son souffle, etc.) et même par des questions (« Emma Bovary va-t-elle continuer à s'endetter ? » ; « Edwin Drood a-t-il été tué ? Par qui ? »).
Cette coproduction de la fiction, toutefois, est rarement reconnue comme telle par qui l'accomplit. Sauf dans les cas d'inférences explicites, par exemple en raison de leur caractère conjectural ou de l'effort cognitif qu'ils exigent[6], le fait de « verser en fiction » les éléments parafictionnels amène, insidieusement, à considérer qu'ils font déjà partie de la diégèse et que la lecture, à supposer qu'on s'arrête à son rôle, ne fait que les mettre au jour. C'est donc ainsi que je reformulerais le premier paradoxe que tu pointes : la lecture est une production qui s'ignore, qui à la limite doit s'ignorer pour que s'instaure l'effet de représentation.
Passons maintenant à la forme professionnelle de lecture qu'est la critique, d'abord pour rappeler qu'elle non plus ne se réduit pas à la parafictionnalisation : établir un parallèle entre Emma Bovary et don Quichotte, ou traquer les alexandrins qui parsèment la prose de Paludes, c'est chaque fois faire autre chose que d'œuvrer à reconstruire les univers fictifs en question. En fait, l'étonnement consiste plutôt à noter qu'il arrive à la critique de commettre des parafictionnalisations, opération toujours un peu suspecte dans la mesure où elle est liée, comme on vient de le voir, à l'illusion référentielle. Comme la critique a vocation d'aboutir à un (méta)texte à propos d'un autre, on se retrouve alors devant une variété curieuse de la transfictionnalité — curieuse en ce qu'elle ne se fait pas sur le mode narratif mais bien sur celui du commentaire. C'est alors que surgit un nouveau paradoxe, propre à la critique, qui doit, comme l'ont bien vu Foucault et Todorov, ajouter au texte initial, mais d'une façon telle que cet ajout se résorbe dans un rapport spéculaire entre métatexte et texte, le premier se rabattant sur le second. La notion de suppléance, que tu convoques très judicieusement dans ta question, dit justement ce paradoxe, et je ne peux ici que renvoyer à Derrida.
J'arrive (enfin) à ta question : a-t-on affaire à deux paradoxes, l'un qui toucherait l'exercice ordinaire de la lecture de fiction, l'autre qui serait propre à la critique lorsque celle-ci se risque à être transfictionnelle ? Je serais tenté de répondre qu'il s'agit essentiellement du même paradoxe, mais que celui-ci se voit exacerbé dans — par — la critique transfictionnelle (fût-ce à son corps défendant lorsqu'il s'agit de ce que j'appelle la critique transfictionnelle honteuse, qui ne veut pas reconnaître son caractère transfictionnel).
La lecture comme acte privé n'a pas à répondre des parafictionnalisations qu'elle produit, et que rien, si ce n'est les scrupules du lecteur ou de la lecture, n'empêche d'être extravagantes. Le discours critique est en revanche un acte public qui doit (en principe) pouvoir justifier ce qu'il avance, qui vise à convaincre mais qui doit en même temps aller au-delà des affirmations (et, le cas échéant, des parafictionnalisations) que le premier venu aurait pu faire siennes. La solution réside dans ce ressort majeur de toute interprétation qu'est le principe d'équivalence, non pas cette fois avec le texte lui-même mais avec le vouloir-dire de ce texte, qui sert ici de caution : « le texte ne dit pas explicitement ce que je vous dis qu'il dit, mais mes interventions ne font que reconstruire ce qu'il en est de son sens, de sa diégèse, etc. ». Le paradoxe, généralement invisible lors de la lecture ordinaire, acquiert une intensité accrue en raison du caractère inédit, audacieux — en un mot : non trivial — du commentaire. La compréhension de Madame Bovary demande, entre d'innombrables autres parafictionnalisations, que l'on saisisse qu'Emma Rouault est devenue Emma Bovary après avoir épousé Charles Bovary, dont elle a pris le nom, mais nulle critique ne s'en tiendra évidemment à des résultats de ce genre. Par contre, lorsque Marc Girard remarque que Rodolphe, dans l'épisode des Comices, prend soin de disposer trois tabourets (alors qu'Emma et lui sont seuls) et avance que c'est sans doute pour mettre la jeune femme en confiance en lui laissant le choix de la place[7], il fait deux choses : d'une part, il rend saillant un élément apparemment anodin de la diégèse ; d'autre part, il grossit (parafictionnellement) cette diégèse d'une supposition qu'on pourra trouver plausible. Il y a là une intervention, et visible (autrement dit : une inférence explicite) ; en même temps, cette intervention entend recouvrer un « déjà-là » silencieux : l'intention qui présiderait au geste d'un personnage. Girard parvient ainsi à éviter les deux écueils qui, dans une culture du commentaire, menacent les résultats de la critique : paraître gratuits ou être attribués à une faculté d'invention du critique. De là que le discours critique mette en œuvre une dynamique à trois termes : le texte, le discours critique, et l'intention signifiante dont le texte serait porteur mais qui n'apparaît au grand jour qu'à travers l'intervention professionnelle du critique…
Marc Escola — Fictions transfugures fait une belle place aux Lettres sur La Princesse de Clèves de Valincour (1678), mises en lumière par Gérard Genette dans son célèbre essai « Vraisemblance et motivation » (1966 ; repris dans Figures II, 1969), puissamment réévaluées par Michel Charles qui a défini à partir d'elles ce qu'il nomme « la lecture rhétorique » à l'âge classique (Introduction à l'étude des textes, Seuil, 1985), comme par Christine Montalbetti qui en a donné une réédition (GF-Flammarion, 2001 : juste avant de devenir romancière…).
Tu montres (p. 474 sq.) que les opérations de Valincour (les possibles qu'il forge pour ramener le texte réel à plus de vraisemblance, ou à plus d'orthodoxie aristotélicienne) portent sur l'intrigue et non pas sur le monde de la fiction. Le critique ici propose des scénarios de remplacement : interventions toutes ponctuelles, qu'il aligne sans souci de leurs conséquences diégétiques (il ne cherche pas à prolonger la ligne narrative alternative que la variante proposée vient pourtant ouvrir). Le geste, qui vise au fond à « corriger » localement l'architecture de l'intrigue, mérite-t-il encore le nom de parafictionnalisation ? Il est vrai qu'il n'est pas si facile de distinguer entre les opérations qui portent sur le texte et celles qui portent sur la fiction… Si toute intervention sur le monde de la fiction peut se traduire en une version alternative de l'intrigue, existe-t-il des opérations sur l'intrigue qui soient sans incidence sur l'univers fictionnel ?
Richard Saint-Gelais — Ce que fait Valincour est ambigu, et c'est cette ambiguïté qui fait tout son intérêt à mes yeux. Mais d'abord : un mot sur la question toujours délicate des rapports entre récit et monde fictif. À partir de quel point peut-on dire qu'on passe d'une articulation narrative à une appréhension de la fiction comme monde ? Ces deux notions sont évidemment poreuses, mais on peut tenter de délimiter leurs domaines respectifs en distinguant les individualités (personnages, actions singulières, lieux et moments) et les données abstraites, encyclopédiques, de portée plus générale. Lire une fiction comme monde, cela amène à voir le récit comme un parcours particulier au sein d'une réalité considérablement plus vaste, dont il ne fournit qu'un aperçu extrêmement limité. Dès lors il suffit — mais ce geste n'a rien d'innocent — de ne pas souscrire à la thèse de l'incomplétude de la fiction pour supposer, au-delà de l'étroite fenêtre ménagée par le récit, un monde fourmillant. Ce serait par exemple, lisant dans La Princesse de Clèves que M. de Nemours « résolut d'aller chez sa sœur, la duchesse de Mercœur, qui était à la campagne assez près de Coulommiers », s'interroger sur (ou, pour les plus résolus, imaginer) la vie de cette sœur, la distance exacte qui la sépare de Coulommiers, l'origine de son éventuelle richesse, etc. (On notera en passant que cela reviendrait à ne pas estimer la lecture contrainte par un critère de pertinence, selon lequel la narration indique tout ce qu'il y a à savoir sur la fiction — ou, dans une version moins stricte de ce critère, que le texte met en place les axes sur lesquels des parafictionnalisations seraient légitimes. Selon cette vue, La Princesse de Clèves favoriserait les spéculations d'ordre psychologique et non celles portant, par exemple, sur les rapports de production au sein du monde fictif.)
Ce n'est pas sur ce terrain encyclopédique que Valincour intervient, sauf lorsqu'il lui arrive de noter ironiquement que la fiction obéit à des lois qui ne sont pas celles qui régissent la réalité (ainsi : « [...] cet égarement n'aboutit à rien qu'à le faire errer toute la nuit au milieu d'une forêt, où tout autre qu'un héros de roman se serait enrhumé pour plus de huit jours », p. 49 de l'éd. citée).
Mais, une fois cela dit, il me faut nuancer mon propos, car Valincour, pas plus que les autres participants à la querelle de La Princesse de Clèves, ne s'en tient au contenu narratif. Il « immerge » le récit dans un cadre qui le dépasse, ce cadre étant fourni — et défini — par la vraisemblance censée régir les événements et les actions des personnages. Une règle de conduite, formulée ou formulable sous forme de maxime (« une femme ne doit pas avouer à son mari les sentiments qu'elle a pour un autre », par exemple), est une donnée d'application générale, encyclopédique donc, censée être valide dans un certain nombre de mondes, et dans le cas qui nous occupe celui de La Princesse de Clèves. Or ce système de règles n'est pas pour Valincour un objet de spéculations — son objectif n'est pas de reconstituer une axiologie ou une déontologie parallèles qui seraient celles du monde fictif instauré par Mme de la Fayette — mais bien, conformément au régime de lecture classique, un tremplin de jugements : le monde fictif n'est pas tenu pour autonome par rapport au monde réel d'où proviennent ces maximes. Pour dire cela dans les termes de Genette : le pouvoir déclaratif de l'auteur ou de l'autrice (La Princesse de Clèves est paru sans nom d'auteur et le critique ne se soucie pas de cet anonymat) ne va pas, aux yeux de Valincour, jusqu'à la capacité d'instaurer un monde où ces règles seraient remplacées par des règles inédites, idiosyncrasiques[8]. Il s'agira plutôt de ramener, normativement, la diégèse vers ce que tu appelles justement l'orthodoxie aristotélicienne, et c'est là que Valincour fait quelque chose qui se rapproche de la parafictionnalisation, et donc de la critique transfictionnelle, en imaginant des cours d'événements qui respecteraient ces maximes.
Mais deux remarques avant de revenir sur ce point. D'abord, il ne s'agit pas, chez Valincour, d'expansions inférentielles qui traiteraient le monde fictif comme un espace débordant de toutes parts ce que le récit en fait voir et qui pourrait être « exploré » par l'imagination lecturale. Ce sont bien plutôt des corrections qui ont la particularité d'aboutir aux situations déjà racontées dans le roman en empruntant — à cela se borne l'altération — un trajet diégétique estimé plus conforme à la vraisemblance. L'opération est donc chaque fois téléologique, l'issue étant fixée d'avance par le récit, auquel le critique défère en concevant soigneusement ses interventions de manière à éviter de faire « déraper » l'intrigue dans une direction nouvelle.
J'en viens au cœur de ta question : ces interventions sont-elles parafictionnelles ? Pas tout à fait. Valincour ne produit pas des énoncés apocryphes qui viendraient grossir la fiction (dans une logique de l'expansion) ou la supposer autre (ce qui serait la logique de la version contrefictionnelle) ; autrement dit, il ne dit pas : « compte tenu de ce qu'on nous raconte, on peut supposer qu'il est arrivé telle chose par le passé » ni : « il arrivera telle chose par la suite » ni : « les choses ne se sont pas passées comme le récit nous le dit »… Il imagine plutôt que l'auteur ou l'autrice aurait pu écrire un roman où les choses se seraient passées de manière légèrement différente et accessoirement plus vraisemblable. On ne trouve jamais sous sa plume d'hypothèses contrefictionnelles ; on a plutôt affaire à ce que je serais tenté d'appeler des « contrescripturaux », des décisions d'écriture potentielles — lesquelles auraient évidemment affecté le contenu diégétique, mais celui-ci n'est jamais autonomisé par rapport à son inscription textuelle, comme les parafictionnalisations le font tendanciellement. Ce qui nous ramène à la question des rapports entre récit et monde : Valincour n'intervient pas sur le monde fictif, il ne traite pas le récit comme un document sur un monde à propos duquel le critique s'estimerait autorisé à nous en dire davantage (comme le fera par exemple la critique psychologisante en attribuant des états d'esprit des personnages) ou avancer des révélations (comme le feront les holmésologues et, plus récemment, Pierre Bayard). Valincour ne conçoit la diégèse que comme le résultat de décisions narratives toujours révisables — ce qui le rend fascinant pour qui s'intéresse aux textes possibles —, mais toujours déterminantes.
Marc Escola — Peut-on imaginer de rendre le geste de Valincour (cette forme de « transfictionnalité sous surveillance métatextuelle » constante, p. 475) plus systématique ? Au lieu de concevoir des variantes isolées, on tenterait de produire, à partir d'une première décision, une suite cohérente de variantes de façon à élaborer une version alternative de l'intrigue dans son ensemble ? Cela s'appelle certes une récriture, et l'on a depuis longtemps reconnu la dimension métatextuelle de l'hypertextualité (depuis G. Genette au moins : Palimpsestes, 1982, dûment allégué au début de ce même chapitre), mais peut-on concevoir une récriture dont la finalité serait de part en part critique ou métatextuelle ? Soit : une série d'opérations sur le texte de fiction méthodiquement pensées pour produire non pas une nouvelle fiction mais bien un commentaire du texte de départ ?
Richard Saint-Gelais — Question vertigineuse, car elle revient à faire subir au texte de Valincour ce que lui-même fait à celui de Mme de la Fayette, à en imaginer une version possible ; un Valincour potentiel, en somme, qui ne s'en tiendrait pas à des variantes isolées, qui ne découperait pas La Princesse de Clèves en segments possédant chacun sa logique (micro-)aristotélicienne, si je puis dire. On peut se demander ce qui a pu empêcher Valincour de procéder de cette manière systématique que tu envisages. Ce que je dirais, avec toute la prudence qui s'impose (surtout pour moi qui ne suis pas dix-septiémiste !), c'est que cela aurait eu pour conséquence de rendre son entreprise sensiblement plus autonome par rapport au texte du roman. En limitant ses interventions à des rectifications ponctuelles et — c'est le point important ici — sans incidence les unes sur les autres, il fait en sorte que son texte est constamment sous la dépendance structurelle de La Princesse de Clèves, auquel il doit sans cesse revenir, qui demeure donc son axe tuteur. Alors que si ses modifications s'étaient articulées entre elles, elles auraient exercé une pression les unes sur les autres : ce que Valincour aurait imaginé à l'étape n aurait été tributaire de ce qu'il avait imaginé aux étapes n-1, n-2, etc. Dès lors, la version alternative de l'épisode n aurait-elle encore été le résultat d'un geste purement critique ? N'aurait-elle pas été aussi, si ce n'est davantage, la résultante de la logique narrative déclenchée par Valincour, qui se serait éloigné de plus en plus de la trame initiale ? A-t-il eu conscience de cela, a-t-il sciemment voulu éviter cette manière de procéder qui aurait profondément bouleversé les rapports entre son texte et La Princesse de Clèves ?
De manière assez curieuse, la stratégie de Valincour se rapproche de ce qu'on retrouve, aujourd'hui encore, dans de très nombreux systèmes transfictionnels et que j'ai appelé le « modèle satellitaire ». On observe en effet ceci : lorsqu'une fiction donne lieu à plusieurs dérivés transfictionnels, ces derniers s'écriront — et se liront — en fonction du seul texte original, et non en fonction les uns des autres. De là, par exemple, que personne ne songera à dire que La fille d'Emma de Claude-Henri Buffard contredit le Mademoiselle Bovary de Raymond Jean : chacun de ces romans est mis en regard du roman de Flaubert, ce qui empêche de voir dans le premier une version contrefictionnelle du second (ce qu'il est pourtant, objectivement). D'une certaine façon, l'ouvrage de Valincour invite à une telle lecture « cloisonnante », cette fois à l'échelle de ses rectifications ponctuelles : chacune intervient sur l'épisode correspondant de La Princesse de Clèves, mais elles ne sont pas censées être confrontées les unes aux autres ; on repart chaque fois à zéro, c'est-à-dire à La Princesse de Clèves.
Mais on peut se poser la question sur un plan historique : est-ce que le fonctionnement que tu imagines est envisageable à l'époque classique ? Est-il venu à l'esprit de Valincour, qui l'aurait sciemment écarté ? Était-il au contraire un impensé, un impensable compte tenu de sa conception de la fiction, de la critique ? Et, s'il ne l'est pas : est-ce qu'on n'atteindrait pas ici une des limites de la « modifiabilité » que la conception rhétorique est prête à reconnaître aux œuvres ?
Marc Escola — Le fait est qu'on ne trouve pas dans la critique de l'âge classique de tels commentaires… Mais l'on en est parfois très proche, dans les parages même de Valincour. Au lendemain des débats sur La Princesse de Clèves, un critique qui s'est fait connaître sous le pseudonyme de Du Plaisir a produit à la fois un commentaire linéaire du roman et une nouvelle historique dont l'intrigue est déduite des corrections proposées — une sorte de récriture mais sur la base de nouvelles données diégétiques (on y retrouve les ressorts principaux de La Princesse de Clèves, mis en œuvre selon les principes forgés dans l'exercice critique). Les deux titres de Du Plaisir sont accessibles dans l'anthologie des Nouvelles galantes du XVIIe siècle publiée dans la collection GF-Flammarion (2004) : Sentiments sur les lettres et l'histoire (c'est-à-dire le genre de la nouvelle historique) avec des scrupules sur le style et La Duchesse d'Estramène, qui n'a rien d'un exercice d'école mais qui forme un « petit roman » assez réussi, lequel peut se lire indépendamment de La Princesse de Clèves.
Richard Saint-Gelais — J'en viens au deuxième volet de la question précédente : quel serait le statut d'« une série d'opérations sur le texte de fiction méthodiquement pensées pour produire non pas une nouvelle fiction mais bien un commentaire du texte de départ » ? Ce qui correspondrait à cette formule, ce seraient pour moi les transfocalisations polémiques, par exemple les versions de Madame Bovary où Charles Bovary devient le protagoniste et le personnage focal. Ces versions font passer leur lecteur par les mêmes points diégétiques mais d'une manière qui conteste la perspective d'Emma et ce qu'elle implique de jugements sur la personnalité et l'intelligence de Charles. Dans le cas de La Princesse de Clèves, il faudrait imaginer une récriture du point de vue de M. de Clèves (avant sa mort !), de celui de M. de Nemours ou de tel personnage de la cour qui observerait tout cela avec détachement et intérêt.
Mais cela affecterait-il ce qui intéresse Valincour au premier chef, à savoir les enchaînements d'actions et de circonstances ? Pas forcément, mais on peut imaginer qu'une transformation ostensible (la transfocalisation) aurait été accompagnée de modifications factuelles comme celles que produit Valincour, du coup moins apparentes ou, peut-être, justifiées par cette autre perspective, surtout si celle-ci se donnait comme mieux informée, selon la logique de la correction transfictionnelle que je décris dans le chapitre 6 de Fictions transfuges.
Ce qui se rapprocherait de ce que tu imagines sans cesser pour autant de relever de la critique, c'est La Vie de Don Quichotte et de Sancho Pança d'après Miguel de Cervantes Saavedra, dans lequel Miguel de Unamuno part d'une hypothèse faisant de don Quichotte une figure christique, à partir de laquelle il retraverse le récit de Cervantes qu'il interprète dans ce sens mystique. Mais s'il peut le faire sans dommage, c'est-à-dire sans ouvrir une branche narrative qui l'éloignerait de l'intrigue originale, c'est que ses interventions ne changent que le sens des événements (ou, à la rigueur, les pensées des personnages), jamais leur teneur factuelle.
Marc Escola — S'agissant de Valincour toujours, tu notes (p. 478) qu'il s'arrête « au bord de la fiction, là où la diégèse cesse de sembler autonome, mue par ses propres lignes de force (désirs et dispositions des personnages, situations, etc.) et apparaît comme la construction qu'elle est » (un artefact textuel donc). Et tu soulignes à plusieurs reprises « l'ambivalence » de la critique transfictionnelle, « qui, en tant que critique, rapporte les effets de fiction au texte (actuel ou virtuel) qui les instaure et, en tant que transfiction, tend à les détacher de cet ancrage scriptural » (p. 476). Tu évoques régulièrement une « tension » : « entre les versants métatextuel (rendre le texte conforme à ses principes, ou du moins à ceux qu'on lui suppose) et “créatif” (amener l'intrigue là où le texte ne le prévoyait pas) de la critique transfictionnelle » (p. 482). Faut-il aller jusqu'à considérer qu'il y a là comme une antinomie ? Ou bien peut-on imaginer des formes heureuses de transfictionnalité critique qui parviendraient à concilier les deux postulations, ou à trouver un équilibre entre les deux pôles ? Question subsidiaire : une convergence avec le développement des cours « d'écriture créative » (creative writing) serait-elle souhaitable ?
Richard Saint-Gelais : Cette tension est extrêmement précieuse pour moi : je ne me serais pas penché sur la critique transfictionnelle avec la même passion s'il s'agissait d'une pratique sereine et confortable. Ce qui m'a fasciné, d'entrée de jeu, c'est le caractère inclassable de la critique transfictionnelle, qui est une pratique discursive qu'on n'arrive pas tout à fait à loger dans les catégories préexistantes puisque c'est à la fois fabuler, raconter, lire, interpréter… Cela se fait certes dans des proportions variables, et avec une visibilité variable. Ce dernier paramètre est particulièrement important à mes yeux, car il permet de distinguer des postures aussi radicalement différentes, pour m'en tenir à des cas extrêmes, que la critique psychologisante et l'holmésologie. La première est à ce point ancrée, depuis deux siècles, dans la tradition que nous n'avons même pas tendance à y voir une entreprise transfictionnelle, ce qu'elle est pourtant à sa manière inavouée. Quant à la seconde, elle est résolument ludique — ce qui a amené plusieurs à la dénoncer comme futile... — mais elle soulève, pour peu qu'on s'arrête à ses postulats et à ses manœuvres, des questions fondamentales sur les limites de la fiction, le statut de l'auteur (évacué sans plus de façons par les holmésologues, qui attribuent les récits de Conan Doyle à John Watson, ainsi promu au rang d'auteur), les enjeux de l'inférence (dans quelle mesure relève-t-elle de la réception, de la production fictionnelle ?), etc. Ces questions, la transfictionnalité au sens ordinaire du terme (suites, séries, cycles, univers partagés, etc.) les posait déjà. Mais prendre en considération la place que les phénomènes transfictionnels peuvent prendre dans la critique, littéraire ou fanique, ce n'est pas seulement voir de la transfictionnalité là où on ne s'y serait pas attendu : cela force aussi à se demander ce que cela change que d'intervenir sur une fiction dans un texte qui n'a pas un statut fictionnel avoué. Dans la transfictionnalité « standard », déjà, les choses ne sont pas simples : un texte apocryphe qui reprend le personnage de Berthe Bovary se situe-il sur le même plan (fictionnel) que celui de Flaubert, ou doit-il être pris comme une fictionnalisation d'une fiction préalable ? Face à la critique transfictionnelle, cela se complique encore un peu davantage en raison du statut ambivalent que cela prend nécessairement. En tant que critique, le texte se donne comme un discours sérieux, en principe falsifiable : on peut reprocher à un critique d'être dans l'erreur. Mais dans la mesure où cela se lit aussi comme une fiction, cela soustrait les énoncés du critique à la véridiction... On voit que la critique transfictionnelle met en crise — et donc : force à réfléchir sur — le fonctionnement du discours critique et du discours fictionnel du fait de leurs interférences…
Ces réflexions et ces enjeux pourraient-ils nourrir l'enseignement de la création littéraire ? Assurément. Mais cela se ferait, presque inévitablement, en refusant les postulats qui encombrent encore souvent ce domaine, à commencer par ceux qui ont trait à l'expression de soi qui, à en entendre certains, présiderait à la pratique de l'écriture. Penser plutôt cette dernière comme une intervention sur un tissu textuel préexistant, cela aurait l'avantage, non pas d'évacuer la part personnelle de l'écriture de fiction, mais bien de faire voir, en acte, que cette part est inextricablement prise dans un réseau de textes et de lectures.
Marc Escola — La réflexion menée en 2011 sur critique et transfictionnalité était entée sur ce constat : « La critique peut décrire, interpréter, juger ou expliquer ; tous [les critiques] ne s'entendront pas sur cette liste, mais tous conviendront qu'il ne lui revient pas de contribuer à l'œuvre en grossissant celle-ci d'épisodes supplémentaires ou concurrents ; le ferait-elle qu'elle s'exposerait à plusieurs reproches, déontologiques, méthodologiques et théoriques » (p. 483). Douze ans plus tard, ce constat demande-t-il à être nuancé, ou faut-il le reconduire à l'identique ? Les essais que Pierre Bayard a fait paraître à la suite de ceux auxquels tu consacres la dernière section du chapitre (notamment et surtout Qui a tué Roger Ackroyd, Minuit, 1998), qui faisaient alors grand bruit, ont-ils contribué à assouplir les pratiques critiques, en légitimant en quelque façon un droit d'intervention sur les œuvres, ou bien faut-il considérer que le respect de la lettre du texte demeure aujourd'hui comme hier constitutif de la critique elle-même, qui ne saurait revendiquer le moindre droit à l'ingérence ?
Richard Saint-Gelais — Mon livre date déjà, et de toutes sortes de façons qui font que je suis heureux de l'avoir écrit au moment où je l'ai écrit, un moment charnière où les pratiques transfictionelles (qu'elles soient romanesques ou critiques) avaient encore quelque chose de déstabilisant, surtout pour un chercheur qui, comme moi, avait fait ses études au moment où l'emprise du structuralisme sur les études littéraires commençait à peine à reculer, où les théories de la lecture étaient encore une curiosité, où les théories de la fiction n'avaient pas encore essaimé de la philosophie du langage (d'où nous vient la sémantique des mondes possibles) vers les études littéraires, où les études culturelles n'étaient pas à l'ordre du jour dans la recherche francophone… Dans ce contexte, les notions d'œuvre et de clôture de l'œuvre passaient pour des évidences communes. C'est une quinzaine d'années plus tard, vers le milieu des années 1990, que j'ai réalisé le divorce entre ce climat théorique et des pratiques qui m'étaient pourtant familières depuis au moins l'adolescence, celles en particulier de la sérialité. J'avais été exposé, comme d'innombrables lecteurs et lectrices, à des textes que je qualifierais aujourd'hui de « transfictionnels », mais dont le fonctionnement et les enjeux propres étaient neutralisés par d'autres considérations (l'analyse narratologique dans la lignée de « Discours du récit », l'analyse actantielle à la façon de Greimas — sans compter que les positions de Jean Ricardou, dont j'étais alors très proche, m'amenaient à y voir une simple accentuation de l'illusion référentielle (aujourd'hui, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une exacerbation qui loge une crise discrète au cœur du régime de la représentation). Le jour, donc, où j'ai décidé de me pencher sur le phénomène qu'il m'a bien fallu alors baptiser d'un terme, la transfictionnalité, ça a été avec un étonnement, une sidération qui me forçait à me poser question sur question, à ne rien prendre comme allant de soi… J'en dirais autant de mes premiers contacts avec la critique transfictionnelle — non pas à travers les livres de Pierre Bayard mais plutôt la critique fanique (sur Star Trek) et son ancêtre l'holmésologie. À la parution de Qui a tué Roger Ackroyd ?, j'avoue avoir été quelque peu frustré, car j'avais déjà eu l'idée de faire quelque chose de semblable sur un autre roman policier, Le Faucon maltais de Dashiell Hammett (1930), où il n'est pas impossible d'avancer que le détective, Sam Spade, n'accuse Miss O'Shaughnessy au terme de son enquête que pour camoufler sa propre culpabilité[9]. Il reste que la lecture de l'essai de Pierre Bayard a suscité sur moi un trouble, comme probablement chez tous ses premiers lecteurs et lectrices. Il est vrai que cet effet a fini par s'atténuer au fil des essais où Bayard a repris la même formule de « contre-enquête » sur d'autres œuvres, policières ou non. Entre-temps se sont multipliées des démarches comme celle de Jacques Dubois (« critique amoureuse ») ou celles qui relèvent de la théorie des textes possibles, démarches qui forment ce que j'appellerais une nébuleuse, un ensemble dont les opérations et, plus fondamentalement, les postulats de départ ne sont pas exactement les mêmes. L'influence de Bayard est peut-être plus nette dans la façon dont on peut aujourd'hui pratiquer la théorie sous le sceau de l'humour. Mais je reprendrais volontiers ce que j'écrivais en 2011 sur l'humour de Bayard : il s'apparente souvent à de la légèreté, et parfois à une forme d'inconséquence théorique. Ainsi lorsqu'il affirme, dans L'Affaire du Chien des Baskerville, accepter la thèse de l'incomplétude de la fiction, mais en la définissant d'une manière qui revient dans les faits à refuser cette thèse. Or la question de l'incomplétude n'étant ni simple ni familière aux non-spécialistes, on peut craindre que cette désinvolture encourage une confusion qui ne me paraît pas très souhaitable.
C'est moins un malentendu qu'une certaine perplexité qui surgit lorsque Bayard soutient de façon apparemment sérieuse (il dirait sans doute « pince sans rire ») que les personnages vivent une existence indépendante de leurs auteurs et donc du texte qui les instaure. On me répondra que cette dernière thèse forme le postulat de l'ensemble des textes transfictionnels. Or les mêmes gestes ne produisent pas les mêmes effets dans une fiction et dans un ouvrage critique. Supposer, dans un roman, que l'existence d'un personnage transcende les limites de l'œuvre qui l'a instauré, c'est, tendanciellement, plonger la lecture dans des paradoxes conceptuellement féconds. Affirmer cela le plus tranquillement du monde dans un essai, surtout aujourd'hui où on assiste à une répudiation en règle du « soupçon » moderniste face à la fiction, c'est, je le crains, contribuer à une banalisation, aussi bien de la transfictionnalité que de la critique transfictionnelle, y compris dans ses formes les plus aventureuses ; une banalisation, et par suite une « dé-paradoxisation » : je crains qu'on finisse par perdre de vue les contradictions théoriquement productives auxquelles la transfictionnalité nous confronte, au profit d'une sorte de jeu un peu insouciant.
Marc Escola — Un des traits les plus troublants de la démarche de Pierre Bayard consiste en effet à postuler, sous le sceau de l'humour donc, l'existence d'une diégèse unique, indépendante de l'auteur comme de ses lecteurs, qui serait « la vérité » de l'affaire ; c'est l'autorité prêtée à cette diégèse supposée qui autorise le critique à concurrencer l'auteur, à corriger par exemple les conclusions de l'enquêteur au dénouement d'un roman policier, après avoir refait l'enquête… sur la base du seul texte. Il y a là bien sûr un coup de force, diversement apprécié par les lecteurs de Pierre Bayard (dans le meilleur des cas, il invite à entrer dans un jeu sérieux, à la façon de l'holmésologie, qui met en compétition des lecteurs-enquêteurs). Il reste que si l'on tient qu'il y a, au terme de l'exercice transfictionnel, des variantes meilleures, ou plus « légitimes », que d'autres, c'est sans doute au regard d'une « version » qu'on ne peut manquer de douer d'autorité — en postulant par exemple un état antérieur du texte et un scénario abandonné en chemin, ou un piège tendu par l'auteur ou son narrateur, ou en suggérant une révision toujours possible du texte par son auteur lui-même, etc. Au fond, tous les jeux transfictionnels dans le domaine de la critique littéraire n'ont-ils pas paradoxalement pour effet de nous faire éprouver l'emprise de l'autorité de l'auteur ?
Richard Saint-Gelais — Assurément. Je note toutefois que Bayard, si l'on excepte Enquête sur Hamlet, et encore, prend comme objets privilégiés de ses contre-enquêtes des romans policiers, pour des raisons que j'ai indiquées dans Fictions transfuges : les romans policiers sont des récits fondés sur le « paradigme indiciaire » (C. Ginzburg), et appellent une lecture marquée par une méfiance face aux stratégies textuelles déployées par l'auteur. Cette méfiance, classiquement, est levée lorsqu'on atteint la zone textuelle tout à fait spéciale occupée par l'exposé final de la solution par le détective, lieu d'une vérité en principe indiscutable. Mais il suffit — c'est le geste diaboliquement habile posé par Bayard, que même les holmésologues, ces sceptiques professionnels, n'avaient pas posé — de refuser de conférer ce privilège aux dernières pages du texte pour qu'il devienne possible de supposer, sous ou derrière le texte, une solution invisible, que seule une critique interventionniste puisse mettre au jour. Il y a donc refus de souscrire à la diégèse « officielle », celle dont on avait jusque-là toutes les raisons de penser qu'elle correspondait aux intentions de l'autrice. Or, en se penchant sur des romans policiers, Bayard « s'attaque » à des textes qui n'ont pas des auteurs au sens traditionnel, romantique, du terme, i.e. des individus porteurs d'une vision du monde singulière, détenteurs d'un sens et d'une vérité de l'œuvre. Agatha Christie ou Conan Doyle sont plutôt vus comme des techniciens remarquables, ou, dans le meilleur des cas, comme les créateurs de figures qui se sont implantées dans l'imaginaire collectif comme Sherlock Holmes ; mais ces écrivains n'ont pas une autorité qui conférerait à leurs œuvres une « aura » (au sens que W. Benjamin donne à ce terme) : leurs textes sont des mécaniques brillantes, dont la seule vérité est technique : quels mécanismes permettent de déjouer les efforts de la lecture pour trouver la solution, d'en livrer les éléments sans les rendre apparents, etc. ? C'est peut-être ce déficit d'autorité symbolique qui permet à Bayard de proposer des versions contrefictionnelles, donc très « agressives » car elles affectent le tissu diégétique du récit, alors que la critique transfictionnelle honteuse, souvent liée à des positions on ne peut plus traditionnelles sur l'intériorité des personnages, reste orientée vers la recherche d'un « vouloir-dire » qui nous ramène directement à l'intention de l'auteur. La bannière de la critique transfictionnelle recouvre donc, on le voit, des pratiques hétérogènes, adoptant des conceptions significativement différentes.
Il n'est cependant pas si aisé de sortir de l'orbite de l'auteur. C'est ce que montre le commentaire de Jean Bellemin-Noël sur Qui a tué Roger Ackroyd ?, où il se demande ce qu'il en est de la relation d'Agatha Christie à la solution fantôme débusquée par Bayard : « savait-elle, oui ou non, que le Dr Sheppard pourrait bien être innocent du meurtre de Roger Ackroyd ? »[10]. En termes moins intuitifs : a-t-elle conçu la solution donnée par Poirot comme un ultime piège destiné à leurrer lectrices et lecteurs, un piège assez redoutable pour n'être, peut-être, jamais découvert ? Une mystification dont personne ne s'aviserait serait-elle encore une mystification ?
Un dernier mot, pour signaler une remarquable étude qui prend à bras le corps la question des rapports entre transfictionnalité, critique transfictionnelle et intention auctorielle : la thèse de Camilla Ulleland Hoel qui examine les continuations du Mystère d'Edwin Drood, le dernier roman (inachevé) de Dickens, en s'appuyant sur la notion de « fonction-auteur » (M. Foucault). Hoel en a tiré un livre qui a été édité fin 2022 : Solving the Mystery of Edwin Drood (Edinburgh University Press). Pour résumer rapidement sa thèse : les « droodistes », continuateurs et analystes confondus, sont conscients de leur déficit d'autorité discursive : aussi convaincants que puissent être les dénouements imaginés ou reconstruits (c'est tout un), ils savent qu'ils ne bénéficieront jamais de la caution directe et explicite de l'auteur. La mort de Dickens produit un effet contradictoire : d'une part, un appel, une pulsion narrative, un désir de complétion où les continuateurs ont toute la place ; de l'autre, une béance que les tentatives mêmes de la combler mettent fatalement en évidence, puisque ces tentatives sont hantées par la figure de l'auteur qui disposait d'une autorité qu'ils n'auront jamais, et dont Hoel montre qu'ils ont tenté de la suppléer par toutes sortes de moyens, des plus loufoques (comme les séances de spiritisme où l'esprit du romancier était invoqué) aux plus raisonnables, comme les raisonnements fondés sur le genre (récit policier ? roman psychologique ?) auquel on peut rattacher le roman. On a donné tellement de réponses aux questions que suscite le segment rédigé d'Edwin Drood (Drood est-il mort ou seulement disparu ? s'il s'agit d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre, Jasper en est-il le coupable ? qui est Dick Datchery ?) qu'il y a fort à parier que le dénouement envisagé par Dickens se trouve quelque part au milieu de cette proliférante littérature. Mais cela ne change rien, puisque cette « bonne » solution, avancée comme toutes les autres par un.e droodiste, ne parvient pas à quitter le domaine de la spéculation. Disons cela autrement : les continuateurs restent finalement « entre eux » ; le seul espace qui demeure est, irrémédiablement, un espace interprétatif où, en l'absence de l'auteur, aucun arbitrage ne peut survenir.
Marc Escola — Faudra-t-il un jour, et peut-être dans un proche avenir, penser les opérations de la cancel culture, qui invite à réviser les œuvres sur des critères moraux ou idéologiques, comme un avatar imprévu de la critique transfictionnelle ?
Richard Saint-Gelais — Je répondrais en deux temps. D'abord, les récritures comme celles qu'on observe de ce côté travaillent souvent sur la connotation, sur les significations latérales qui s'attachent à certains termes socialement sensibles ; or, si on remplace le « mot en n » (n-word) par « afro-descendant », on ne change pas la dimension référentielle mais plutôt — ce n'est évidemment pas rien — les valeurs auxquelles le texte adhère tacitement. Est-ce une opération transfictionnelle ? Si on répond oui, c'est qu'on étend la portée de cette notion au-delà de que ce que j'avais envisagé il y a dix ans, puisque l'altération porte alors sur une donnée extra-fictionnelle (pour revenir au début de notre entretien : cette altération ne semble pas, à mes yeux, constituer une parafictionnalisation). Il est vrai que, dans le cas récent de Roald Dahl[11], les nouvelles versions semblent[12] contenir de flagrantes corrections transfictionnelles, passant par exemple de « She went to Africa with Ernest Hemingway and to India with Rudyard Kipling » à She went to Africa with Ernest Hemingway and to California with John Steinbeck ». Un cas intéressant est celui de l'effacement des traits particularisants, par exemple l'obésité d'un personnage — « The fat shopkeeper said » devenant « The shopkeeper said », ce qui a une incidence clairement transfictionnelle (idem si on remplace, par exemple « A man » par « A person »). Mon rôle, ici, n'est pas de me prononcer sur l'opportunité de ces récritures. Je noterai seulement qu'en tant qu'opérations transfictionnelles, leur objectif est de se substituer aux versions incriminées et non de s'y ajouter comme une critique à son objet. Le risque, c'est bien sûr celui de la disparition progressive des versions originales qui seraient supplantées à terme par les versions politiquement correctes, de sorte qu'on ne disposerait plus du couple original / version sans lequel il n'y a plus de relation critique (ni même transfictionnelle)[13].
Ce couple, par contre, est conservé lorsqu'une œuvre transfictionnelle s'ajoute — et non pas : se substitue — au texte original, comme le fait La Prisonnière des Sargasses de Jean Rhys, où l'on accède à la perspective de l'épouse réduite au silence et à la captivité dans le Jane Eyre de Charlotte Brontë. La force à la fois narrative, stylistique et idéologique de ce livre tient précisément à cela : à sa relation à un autre texte, à son action sur la lecture de cet autre texte. C'est cette confrontation des lectures (Jauss dirait : ce dialogue des horizons d'attente) que l'on perd en même temps que la distinction entre original et version, et c'est pourquoi cette dernière m'apparaît de la plus haute importance, aujourd'hui.
Marc Escola (Université de Lausanne) — Richard Saint-Gelais (Université Laval), mars 2023.
Mis en ligne dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula en avril 2023.
[1] Richard Saint-Gelais, Châteaux de pages. La fiction au risque de sa lecture, Montréal, Hurtubise HMH, coll. « Brèches », 1994.
[2] Jean Ricardou, Le Nouveau Roman, Paris, Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1973 ; rééd. coll. « Points Essais », 1990.
[3] Jean-Patrick Manchette, Nada, Paris, Gallimard, coll. « Carré noir », 1973 [1972], p. 62.
[4] Que cela demeure, malgré son évidence apparente, une hypothèse de lecture, c'est ce qui explique que j'aie tenu, le jour où j'ai eu entre les mains une autre édition du roman (en Série Noire cette fois), à vérifier si c'était bien le nom « Poindexter » qui apparaissait dans le passage en question.
[5] Ajoutons que chacune de ces suppositions soulève à son tour des difficultés demandant à être résolues, peut-être par d'autres parafictionnalisations : Que vient faire ce nouveau personnage dans l'intrigue ? Faut-il s'attendre à des quiproquos ? D'où vient que l'agent Bunker se trompe ? Aurait-il mal entendu le nom de l'ambassadeur ? On pourra estimer que le coût cognitif de ces échafaudages est excessif : c'est précisément cette estimation qui amènera à tenir pour probable l'hypothèse de la coquille. Mais il faut bien voir que d'autres contextes, comme ceux qu'offrent certains romans à énigme, pourraient les rendre tout à fait rentables.
[6] La notion d'inférence explicite a été proposée par Philip N. Johnson-Laird dans son ouvrage Mental Models, Cambridge, Harvard University Press, 1983.
[7] Marc Girard, La Passion de Charles Bovary, Paris, Imago, 1995, p. 23.
[8] C'est, le parallèle dût-il surprendre, le même postulat qui anime les amateurs de science-fiction qui reprochent à tel récit de faire fi des lois de la physique ou de telle donnée scientifique.
[9] Il me faut immédiatement ajouter que cette contrelecture est bien moins intéressante que celle à laquelle se livre Bayard : Spade, en effet, ne cache guère que l'identité du (ou de la) véritable coupable ne le préoccupe guère et qu'il s'agit surtout pour lui de livrer à la police un suspect plausible. Le roman de Hammett contient donc le germe de sa propre déstabilisation, ce qui rend nettement moins spectaculaire la supposition que le détective serait le coupable.
[10] Jean Bellemin-Noël, « Hercule Poirot exécuté ou la fin des paradoxes », Critique, no 618 (novembre 1998), p. 773.
[11] Pour une description des modifications apportées et de la controverse qui s'en est suivie, voir <https://womensagenda.com.au/latest/progressive-or-futile-offensive-words-removed-from-roald-dahl-classics/>;.
[12] Je m'en tiens à cette formulation prudente, n'ayant pas pu consulter ces nouvelles versions.
[13] La droite américaine, elle, procède de manière plus radicale et expéditive en faisant disparaître des bibliothèques scolaires et publiques (et un jour, qui sait, de l'espace public tout entier) des centaines de livres où il est question de l'histoire des Noirs ou bien de la communauté LGBTQ.