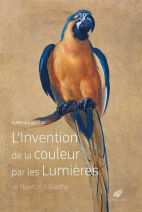
Les couleurs des Lumières
1Face à la monotonie des beiges, gris, bruns et greiges qui envahissent les médias sociaux, l’on se demande si ce n’est pas une triste aspiration à l’uniformisation qui nous amène à vouloir nous immerger dans ce monde monochrome. Cependant l’ouvrage d’Aurélia Gaillard, L’Invention de la couleur par les Lumières. De Newton à Goethe, qui envisage l’explosion des couleurs au xviiie siècle, offre une vive échappatoire à cette tendance qui n’a de toute évidence pas encore rassasié l’opinion publique puisque c’est « Mocha Mousse » qui a été élue « couleur de l’année » en 2025.
2Le parti-pris de l’auteure est singulier. Encouragée par son expérience personnelle de la synesthésie, Aurélia Gaillard envisage son objet coloré avec une grande sensibilité. D’abord visuelle, celle-ci se répercute dans sa capacité à faire dialoguer son étude d’œuvres littéraires avec l’histoire de l’art et des techniques, résultant en un essai riche en couleurs, puisqu’abondamment illustré d’œuvres d’art, de figures et de schémas. Ensuite, elle montre une grande sensibilité matérielle, dont témoigne son désir de réaliser une étude de la couleur en tant que phénomène. Elle considère ainsi avec attention les traces d’une culture matérielle. Tant du point de vue de sa méthode que celui de sa réalisation, l’histoire de la perception des couleurs au siècle des Lumières d’Aurélia Gaillard fournit un exemple d’étude interdisciplinaire réalisée sur un vaste corpus mêlant différents genres de textes : techniques, médicaux, philosophiques, scientifiques, romans et contes.
Les Lumières : inventeurs des couleurs, fabricateurs des teintes
3Si le terme d’« invention » qu’Aurélia Gaillard mobilise dans le titre de son ouvrage intrigue au départ, ce dernier est précisé dès l’introduction et mis en lien avec les ambitions matérielles de l’ouvrage. Ce n’est pas au sens latin de « trouver » qu’inventer est ici entendu, mais bien au sens de « fabriquer » (p. 8-9). Une seconde précision permet à l’auteure de définir l’objet de cette invention en distinguant clarté et teinte des couleurs. Tandis que l’Antiquité latine considérait principalement les couleurs en fonction de leur clarté, c’est-à-dire leur brillance et leur rapport à la lumière, le xviiie siècle quant à lui voit s’opérer une démultiplication des teintes — les coloris et leurs nuances —, ainsi qu’un renouvellement paradigmatique de la couleur :
s’y renouvellent et s’y réunissent pour la première fois des discours, des savoirs, des pratiques et des termes, une langue, qui ne touchent plus seulement, de façon sectorisée et réduite, des savants et des « connaisseurs » (peintres, teinturiers, et autres praticiens de la couleur), mais un nouveau public et toute une société mondaine de plus en plus mondialisée. (p. 9)
4Ce qui distingue donc le xviiie siècle des xvie et xviie siècles, évidemment pas en reste en ce qui a trait au renouvellement artistique, technique et scientifique, c’est la concomitance de ces différents discours, de sorte que les couleurs des Lumières participent au fondement d’une nouvelle épistémologie. En effet, le « voir coloré » (p. 11) n’est pas seulement à la source d’une nouvelle connaissance : au sein de la culture des apparences du xviiie siècle, identifiée par Daniel Roche, « vivre en couleurs » (p. 11) devient une expérience, une nouvelle forme de « participation au monde » (p. 233). Aurélia Gaillard défend en outre que la métaphore de la lumière ou de la clarté qui donne son nom au mouvement philosophique participe à la construction de l’imaginaire coloriste du xviiie siècle. Si l’étude fait avant tout coïncider ses bornes avec celles du siècle des Lumières, elle étend son spectre lorsque nécessaire.
5Ainsi, Aurélia Gaillard montre que les conséquences de l’exploration du monde et la « découverte » de l’Amérique continuent à contribuer à propager l’imaginaire coloré et coloriste dans un temps long. Elle mobilise notamment les ouvrages de Jean de Léry et d’André Thevet pour expliquer la création d’un horizon d’attente nécessaire à l’installation de cet imaginaire. Cependant, selon elle, le xviiie siècle est particulier en ce qu’il voit redoubler les phénomènes d’exotisme. D’abord, le renforcement des relations avec le Moyen et l’Extrême-Orient met en avant un orientalisme dans l’art et la littérature. Puis, le changement d’échelle du monde dû au capitalisme commercial encourage une forme de saturation : « on explore, collecte, commerce, raconte, illustre plus » (p. 151). Et, finalement, dans un monde qui conçoit une opposition binaire entre métropoles et colonies, ces dernières paraissent comme « le lieu original des couleurs : là où elles apparaissent, d’où on les extrait, exporte, reproduit » (p. 161). Aurélia Gaillard montre que « colorisation et colonisation vont de pair » (p. 154). Le rapport d’exploitation induit une vision distordue des colonies, à la fois idéalisée et déshumanisante. Or, cet aveuglement partiel contribue à voir les paysages colorés tout en invisibilisant ceux qui y habitent. Ainsi, la circulation des couleurs dans les récits des mondes coloniaux se fait selon le mode du continuum : « La peau est traitée comme un tissu, le paysage également » (p. 165), de façon à recomposer un paysage de ressources « à l’usage de l’Europe » (p. 165) dans lequel les Européens se sentent libres de puiser sans impunité.
6L’étendue du phénomène, couplée à l’absence de distinction entre les catégories génériques des œuvres, qui opposerait par exemple les textes didactiques des textes fictionnels, permet à Aurélia Gaillard de revenir dans son étude sur l’invention des couleurs en tant que réduction en art d’un savoir. Elle revient pour ce faire, dans sa première partie, sur la longue tradition aristotélicienne de traités sur la couleur depuis De la sensation et des sensibles et La Vue et le Visible d’Aristote, mais aussi sur la construction d’un savoir spécifique à la peinture dans le De pictura d’Alberti en 1435, et l’usage des couleurs en peinture dans le corpus plinien ou encore à l’approche philologique de Telesio dans De coloribus libellus, 1528. Cette histoire de ce que l’on pourrait appeler un savoir colorer permet à l’auteure d’identifier une sectorisation discursive des couleurs. Selon elle, jusqu’en 1670, savoirs et pratiques des couleurs relèvent de discours imperméables : le philosophe et le praticien ne partagent pas la même palette. En se gardant de faire une histoire des sciences de la couleur, qui chercherait à établir les fondements de la théorie trichromatique moderne et de ses conséquences scientifiques et intellectuelles, Aurélia Gaillard insiste au contraire sur le « foisonnement » (p. 40) des couleurs, leur « inflation » dans le discours et la désectorisation de ce dernier.
7Faire dialoguer techniciens, théoriciens, savants et praticiens permet de mettre au jour une science du coloris, une « chromatique » (p. 74) qui vise à la « distinction pour l’œil entre teinte, saturation et luminosité ou clarté » (p. 79). Son analyse mène à trois conclusions : la multiplication des couleurs, leur diversification, ainsi que leur abstraction et leur essentialisation, dans leurs implications scientifiques et sociales. C’est le cas du blanc, par exemple, dont l’évolution de couleur à valeur est analysée finement pour montrer, au prisme des travaux de l’historienne Catherine Lanoë, la « fabrique d’un idéal de beauté blanche comme outil de distinction sociale » (p. 66).
Un grand nuancier
8Face à cette multiplication, les couleurs sont soumises au mouvement rationaliste de l’épistémè classique : elles sont identifiées, classées, organisées. Dans la seconde partie, « Voir, nommer, classer », Aurélia Gaillard voit dans l’éclatement coloré qui se produit au xviiie siècle les prémisses d’une « grammaire » des couleurs1. Dépassant la symbolique de l’ancienne triade chromatique unissant noir, blanc et rouge, essentielle à la sémiotique médiévale et renaissante, le potentiel heuristique des couleurs est approché avec les outils linguistiques de la grammaire, qui offre une structure et des principes, ou encore ceux de la musique, par des analogies associant les sept couleurs aux sept notes de la gamme.
9Ces entreprises d’organisation et de théorisation se manifestent par l’abondance de diagrammes, de figures, de tables, de catalogues, de nuanciers, de palettes, de dictionnaires, dont plusieurs sont reproduits dans l’ouvrage. C’est aussi l’histoire du cercle chromatique, dont le premier modèle géométrique se double d’un modèle sensualiste (p. 192) et s’indépendantise du discours scientifique pour être repris dans le domaine des arts, qui le façonne à ses propres besoins.
10La réflexion sur les couleurs donne également lieu à des « exercices de style » en peinture, comme en témoigne l’impressionnant Canard blanc de Jean-Baptiste Oudry, présenté au Salon de 1753 et dont la reproduction est commentée par Aurélia Gaillard. Ce tableau, ou plutôt ces tableaux, puisqu’il a comme pendant Faisan, lièvre et perdrix rouge, permettent par le regroupement de couleurs très proches (les blancs, dans le premier, les roux bruns, dans le second) de comparer et de prendre conscience de toutes les nuances de la palette employée, aussi minimale soit-elle.
11Mais ces exercices de style sont encore plus flagrants dans la langue, qui voit s’opérer, selon Aurélia Gaillard, le basculement dans ce monde coloré. Il semble même que les néologismes rivalisent d’ingéniosité — et d’humour ? c’est peut-être une question qui aurait pu être traitée — les uns avec les autres. L’ouvrage contient, tout du long, des évocations et énumérations savoureuses de couleurs qui titillent l’imagination, comme « queue de serin », « œil de roi », « frangipane », « ventre de carmélite » (p. 131) ou encore le très théâtral « indépendance de l’Amérique » (p. 132). Une vaste liste de « nouvelles » couleurs est présentée en annexe, avec la date de l’attestation et un exemple. Il semble que dans l’entreprise de nommer les couleurs, que l’auteure qualifie de « jubilatoire » (p. 133), le plaisir soit partagé et concerne tant la détermination du nom, que l’entreprise de son inventaire par l’auteure du livre, et enfin sa découverte par la lecture…
La couleur préférée des Lumières
12Les réactions émotionnelles aux couleurs (tant considérées comme des phénomènes visuels que linguistiques) sont au cœur de l’étude d’Aurélia Gaillard puisqu’elles sont perçues comme conséquences du développement de la nouvelle place accordée à l’intériorité au xviiie siècle et de la « primauté de la sensation et du sensible dans la connaissance et la relation au monde » (p. 41). Son approche sociologique lui permet d’accueillir le phénomène du goût et de la mode dans son étude pour révéler des tendances dans les prédilections des couleurs : ce sont les « années “puce” » (p. 132), la folie de la bigarrure, des taches, mouchetures et autres zébrures (p. 137) — qu’il aurait par ailleurs été intéressant de mettre en rapport avec ses manifestations littéraires, comme l’a fait Frank Lestringuant dans son étude des discours bigarrés au xvie siècle2 —, mais c’est aussi le siècle du rose et du vert.
13L’invention du rose en tant que teinte à part entière (indépendant du rouge dont il n’était jusqu’à lors qu’une nuance) est montrée grâce à un parcours de lexicographie historique couplé à l’analyse de ses manifestations littéraires. Celle-ci permet de montrer non seulement que le rose est un phénomène social puisqu’il est un marqueur de distinction, mais aussi, par le biais d’une analyse genrée, permet de saisir les origines de l’association entre rose et féminin ainsi que, par extension, les débuts de la sexualisation des couleurs. Le rose, qui est au centre du plus récent opus de Michel Pastoureau, sorti quelques mois seulement après l’Invention de la couleur par les Lumières, est épinglé par Aurélia Gaillard comme signe d’un « changement épistémologique touchant la représentation du monde » (p. 118). Sa plasticité participe à en faire une expérience sensuelle complète : parce qu’il rappelle la fleur et la peau qui en a la couleur, il affecte les sens de la vue, de l’odorat, du goût, voire celui du toucher.
14Cependant, il faut attendre la conclusion du livre pour que l’auteure révèle son opinion sur la couleur préférée des Lumières. La notion de « couleur préférée », qu’elle prend le temps de commenter, est vue comme l’aboutissement de la valorisation et de l’essentialisation des couleurs. La couleur devient quelque chose que l’on se permet de « savourer » (p. 11), personnellement et pour elle-même. Prenant ici une certaine distance avec les analyses de Michel Pastoureau, qui voit dans le xviiie siècle le siècle du triomphe du bleu, elle établit que c’est le vert (pomme ?) (p. 235) que préfèrent les Lumières. En effet, cette prédilection pour le vert se manifeste dans le mouvement d’esthétisation de la nature, la théorisation des jardins, la vogue des herbiers et des livres à colorier qui présentent des naturalia, tout en correspondant à une sensibilité « technique », puisque le vert est la couleur moyenne, celle qui se trouve au milieu de la séquence chromatique de la théorie newtonienne.
15Cette analyse est fondée sur une section particulièrement nourrie et réussie de l’ouvrage traitant de la fabrique des mondes féériques comme mondes colorés. Selon l’auteure, le conte agit comme « laboratoire expérimental et réservoir d’images » (p. 142), qui contribue à la « conceptualisation » (p. 146) du genre. Les couleurs du conte évoluent de la triade noir/blanc/rouge déterminant une interprétation symbolique à un foisonnement de couleurs. Ce dernier détermine un nouveau « régime esthétique des couleurs » (p. 175) au sein duquel le vert occupe une place déterminante. L’univers coloré des contes se perçoit dès lors en et pour lui-même ; il est « pur signe » (p. 174).
16Il manque peut-être, à l’analyse de l’engagement du corps (p. 181) sensible dans le phénomène de la couleur, une étude des effets physiologiques et psychologiques de cette nouvelle prolifération des couleurs. Les couleurs ne deviendraient-elles pas une forme de pharmakon, dont on use et abuse ? Qu’oblitère leur présence presque hallucinatoire ?
Et les couleurs furent
17L’Invention de la couleur par les Lumières permet à Aurélia Gaillard de déterminer le mode d’apparition et les conséquences du surgissement des couleurs dans la société, la langue et l’imaginaire du xviiie siècle. Par une riche analyse, conduite sur des objets littéraires, techniques et scientifiques, elle a montré comment l’unification du champ de connaissances autour de la couleur mène à « ressentir une relation personnelle, affective, sensitive, esthétique avec la couleur » (p. 169). Elle montre aussi comment dans ce xviiie siècle qui est historiquement une « oasis » ou une « parenthèse colorée » (p. 10), les Lumières s’inventent spécialistes des couleurs, comme coloristes. Diderot, pour qui la couleur est source de vie3, représente bien que la primauté accordée à la sensibilité s’accorde avec un goût pour la couleur, jusqu’à pleine saturation. Aurélia Gaillard ouvre la porte d’un univers coloré et on l’y suit sans hésitation. Son étude claire, convaincante et abondamment illustrée, montre enfin sa pleine maîtrise de la théorie de Fontenelle selon lequel l’émerveillement agit comme moteur de la connaissance.

