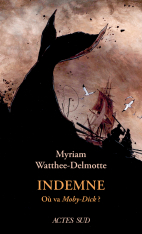
Répondre au désastre avec Moby-Dick
Un flou générique
1Il est des livres singuliers que l’on peine à classer dans un genre ou une catégorie. Celui de Myriam Watthee-Delmotte, Indemne, Où va Moby-Dick ?, intrigue dès son titre. Les remerciements à Yannick Haenel renvoient à une signification spirituelle du titre. L’indemne est ce qui a échappé à la damnation. Le titre oriente donc vers la défense d’une valeur spirituelle du livre dans un monde au bord du naufrage. Tandis que le sous-titre, à la forme interrogative, laisse planer le doute : s’agit-il d’un essai sur le roman de Melville ? d’une réécriture ? d’une suite ?
2L’autrice, directrice de recherche du Fonds national de la recherche scientifique belge, professeur émérite de l’université catholique de Louvain, est bien connue pour ses travaux de recherche sur Henry Bauchau, sur les rapports entre littérature et spiritualité, sur littérature et arts de la fin du xixe siècle à nos jours. Elle publie ici une fiction à la structure originale qui a obtenu le prix Malesherbes, le Libraire du roi 2025. Le narrateur n’est autre que celui de Moby-Dick, le roman célèbre d’Herman Melville paru en 1851. Ishmaël raconte d’abord la vie de son auteur, ses échecs, ses espoirs, ses doutes. Puis la destinée du livre auquel il appartient à travers la circulation de celui-ci de mains en mains. Chaque chapitre porte alors le prénom du lecteur que nous allons suivre jusqu’à ce que le livre devienne la possession d’un(e) autre. Ces lecteurs et lectrices sont eux-mêmes soit des personnages de fiction, soit des personnalités réelles, tels Jean Giono ou Yannick Haenel.
3Le lecteur suit donc la vie d’un exemplaire original du roman de Melville de sa parution à nos jours dans différents pays, essentiellement en France et en Belgique, incluant un passage à Saint-Pétersbourg. La fiction donne à lire des tranches de vie à différentes époques. Si bien que le lecteur suit à la fois l’histoire éditoriale du livre, l’histoire de sa réception dans son pays d’origine et en France, l’Histoire des États-Unis et de l’Europe, dans sa variété et ses vicissitudes. La « grande » Histoire et la « petite » histoire du quotidien des personnages de fiction se mêlent à des moments de la biographie des auteurs réels évoqués, Melville, Giono dans la délicate période de l’Occupation — moment où il décide de se lancer, avec d’autres, dans la traduction et l’édition de Moby-Dick en français —, Yannick Haenel au moment de la naissance de sa vocation d’écrivain au Prytanée militaire de La Flèche, Christophe Chabouté qui a créé un roman graphique à partir de Moby-Dick, ou encore à des peintres comme Alfred Kappes ou Ilya Repine dont des tableaux sont reproduits dans le livre. Se crée un premier effet de tournoiement des genres, entre roman, biographie, essai sur l’art (littérature, peinture, cinéma et bande dessinée lorsque les adaptations du roman sont présentées au fil du texte).
Un essai-fiction sur l’agir de la littérature
4Le parti pris de structurer les chapitres en fonction de chaque possesseur du livre montre aussi combien le roman propose une théorie de la lecture. Les lecteurs de Moby-Dick qui se succèdent au fil des époques révèlent ce que la fiction leur inspire sous la forme d’un journal intime (p. 78-82) ou de commentaires critiques ou métatextuels révélés par des monologues intérieurs ou des psycho-récits : « L’étudiant en tire une réflexion sur l’usage de la fiction littéraire dans la constitution identitaire de chacun » (p. 188). Le livre révèle systématiquement le personnage du lecteur à lui-même en instaurant un dialogue de soi à soi. Il le porte, par ailleurs, à des réflexions métaphysiques qui définissent la lecture comme une activité spirituelle et le moteur d’une exploration des profondeurs du moi. Le dialogue intérieur qui s’instaure nécessairement entre un livre et son lecteur est souvent mis en scène dans le roman en un dialogue « incarné » entre le lecteur et le narrateur du livre qu’il tient entre ses mains. Ishmaël déclare par exemple :
De nous montrer à quel point nous sommes toujours enclins à croire plutôt qu’à analyser. Vu que c’est ce qui m’a, personnellement, amené au désastre, je dois dire que je suis sensible à sa démonstration dont je saisis toute l’importance. Mon propre récit confirme sa théorie et j’en suis un peu pantois. (p. 188)
5Le principe du dialogue entre le lecteur et le livre soutient une théorie émotionnelle de la lecture fondée sur l’intersubjectivité. À travers ces différents niveaux de lecteurs et de lectures, c’est bien l’agir de la littérature qui est interrogé. Myriam Watthee-Delmotte a déjà abordé cette question dans des essais : Dépasser la mort, L’agir de la littérature (2019), La littérature, une réponse au désastre (2025)1. Ces deux titres font d’ailleurs écho à la situation même du narrateur d’Indemne, confronté au naufrage de son navire dont il est le seul rescapé. La lecture de Moby-Dick résonne avec la vie de tous les lecteurs présentés dans le roman, vient panser leurs plaies et approfondir leur questionnement existentiel. Il en est ainsi de Maggie, une lectrice non érudite, qui a sauté de nombreux passages, mais qui « a frémi » et apprécié les « profondes vérités » qu’elle a décelées dans l’intrigue (p. 64-65). Il en est ainsi du peintre Alfred Kappes qui se raccroche au livre de Melville « en cas de coup dur » comme à un « compagnon intime de ses détresses » (p. 46).
6En outre, la confrontation des époques met en évidence l’impact du contexte historique sur l’interprétation du livre par le lecteur. Ainsi d’une classe de lycéens pendant la Seconde Guerre mondiale :
7Les commentaires des élèves sur Moby-Dick continuent de refléter leur perception de l’actualité. Les adolescents ne peuvent plus accorder aucune sympathie à Ahab, qu’ils identifient au Führer qui a répandu le sang des innocents et détruit son pays en l’embarquant dans sa folie. […] La fiction est filtrée par le passé proche et les terribles révélations du présent, elle fournit l’occasion d’évoquer ce qui heurte de manière indirecte, sous couvert d’imaginaire. (p. 170)
8Tout d’abord, les variations diachroniques des interprétations montrent combien la lecture d’un livre permet de prendre le pouls d’une époque. L’Histoire et la lecture sont nécessairement liées, comme dans la structure d’Indemne. Ces variations donnent aussi à penser la notion d’anachronisme au cœur des théories de la réception, en écho avec un numéro récent de la revue Littérature2. Elles interrogent également la définition d’un livre-culte et du succès littéraire. Ensuite, les pouvoirs thérapeutiques de la lecture sont évoqués ici dans la mise en scène d’échanges sur le livre qui viennent en partie traiter les traumas de guerre. Cet aspect réapparaît à la fin du roman à travers le personnage de Claire, lectrice professionnelle qui intervient auprès des détenu(e)s, des malades ou des personnes âgées. Il se situe dans la lignée de nombreux travaux parus ces dernières années sur la bibliothérapie, comme ceux, entre autres, de Régine Detambel3, citée par Myriam Watthee-Delmotte, d’Alexandre Gefen4 ou d’Isabelle Blondiaux5.
9Par ailleurs, grâce à la fiction, l’émotion n’est pas évacuée du processus critique. C’est le cas, par exemple, de Jean Giono dévoilant sa lecture de Moby-Dick dans Pour saluer Melville. La fiction permet, par une approche empathique, de montrer plus aisément un niveau d’analyse qui se place sur le plan des émotions et définit la lecture comme un processus de rapprochement des psychè, déjà souligné par la psychocritique. Pour saluer Melville apparait comme le modèle herméneutique d’Indemne, à la croisée de la fiction, de la biographie et de l’essai : « Mais laissez-moi vous dire que j’apprécie sincèrement le “salut” qu’il lui adresse, car c’est celui d’un homme blessé à un autre homme blessé. » (p. 150).
Dialogue, lecture et création
10Parallèlement à ce dialogue entre Moby-Dick et son lecteur, se tisse également un échange entre le narrateur de Moby-Dick et les livres qu’il rencontre sur les rayonnages des bibliothèques où il est tour à tour rangé. Il se trouve ainsi confronté à Alice au pays des merveilles (p. 66-68) ou à Peter Pan, d’autres livres que l’on a pu destiner à la jeunesse. De même, il fréquente l’Ulysse d’Homère et l’Ulysse de Giono, des récits épiques ou récits d’aventure, qui ont pu recevoir la même étiquette que lui. Si bien que la fiction fraye sans cesse avec une réflexion sur le genre, sur la manie taxinomique de la critique et du monde de l’édition qui décide parfois avec bonheur ou, au contraire, avec un regard biaisé, du destin d’une œuvre. Ces confrontations sont aussi l’occasion de commentaires critiques sur ces ouvrages, il en est ainsi de la comparaison entre les deux Ulysse (p. 173-174). Elle engage, de ce fait, une réflexion sur la réécriture, sur la mythocritique, mais aussi plus généralement sur l’enchantement comme fonction de la littérature et sur l’affabulation comme forme de vie :
Aussi, depuis que je le connais, je sais que les enchanteurs existent, ce sont ceux qui maîtrisent l’art de raconter. Comme Herman [Melville] et Jean [Giono], qui sont de sacrés bonimenteurs. On ne peut pas leur en vouloir, c’est leur bouée, celle qui leur permet de ne pas sombrer dans la morosité du monde de médiocrité qui les entoure. L’affabulation est nécessaire à leur survie. S’inventer un monde imaginaire, plonger dans la fiction leur permet d’exister plus intensément, à un autre degré de profondeur. Et comme je les comprends ! (p. 174)
11Le commentaire sur l’œuvre des auteurs lus par les personnages d’Indemne ou des auteurs réels présents comme personnages dans Indemne est aussi l’occasion d’une réflexion sur les rapports entre réel et fiction :
Vous voyez immédiatement ce qui interroge mon jeune ami : nous vivons emprisonnés par des signes, par des images de nous-mêmes que la société nous propose pour nous convaincre de ce qu’il convient que nous soyons ; nous sommes dominés par des fictions auxquelles nous nous sentons obligés de nous conformer, même si elles sont sans fondement véritable pour nous. Je ne peux pas m’empêcher de penser à Herman [Melville] et Jean [Giono] qui ont senti cette pression s’exercer sur eux et y ont résisté mais en payant le prix fort. (p. 187)
12En un jeu de miroir qui donne le vertige, un propos théorique est généré par la fiction, mais ce propos peut lui-même n’être que fiction. Le réel est pétri de fiction, si bien que théorie et fiction ne sont pas si éloignées qu’il y paraît.
13Enfin, la lecture est aussi présentée comme l’un des fondements d’une vocation d’artiste et de son rituel. L’évocation de Yannick Haenel, dans le chapitre qui lui est consacré, en est l’exemple le plus éclatant. Là encore, le roman de Myriam Watthee-Delmotte fait pendant à son travail de recherche sur les rapports entre rite et création6.
*
14Le dialogue entre les œuvres et entre les créateurs (écrivains ou artistes) est au cœur de ce roman. Il y est mis en scène, il y est pensé, et il en est le fonctionnement même. Si « s’approprier la matière du livre pour lui donner une vitalité nouvelle » (p. 234) est le propre de l’écriture et de la lecture, ce dialogue fécond n’est-il pas aussi celui de la critique sous cette forme si singulière de l’essai-fiction ? Quoi qu’il en soit, en présentant le point de vue de l’auteur, du narrateur-personnage et du lecteur, le roman est avant tout une ode à la création et aux pouvoirs (salvateurs) de l’imagination.

