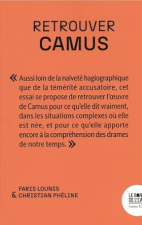
Camus relu aujourd’hui. Questions de méthode
1À l’automne 2023, un Associate Professor à l’université de Caroline du Nord (États-Unis), persuadé qu’il fallait aider les Français à s’affranchir de leurs idoles intellectuelles, nous enjoignait d’« oublier Camus ». Publié à la Fabrique, le livre d’Olivier Gloag a d’abord semblé avoir partie gagnée, tant il a été porté par une intense campagne, toute idéologique, de promotion. Et pourtant, Camus a continué à être joué dans de nombreux théâtres, lu en public, expliqué dans des classes et des amphis, vendu en librairie… La démarche du polémiste a été d’emblée contestée par ceux que lui et ses soutiens récusent a priori comme « thuriféraires » de Camus parce qu’ils connaissent son œuvre et sa pensée, qu’ils s’en nourrissent et les placent au rang des plus grandes du siècle dernier, et que, sans naïveté hagiographique, ils en tirent de quoi être au monde autrement. Acceptant mal que l’on détourne les textes pour mieux accabler l’auteur par des jugements aussi abrupts qu’anachroniques, ces « camusiens » sont montés au créneau à intervalles réguliers et par des canaux divers : rappel en est fait à la fin de Retrouver Camus (p. 101-145), l’ouvrage plus exhaustif que les éditions Le Bord de l’eau publient en janvier 2025, sous la double signature de Faris Lounis et Christian Phéline.
2Le fin débatteur et bon historien de l’Algérie coloniale qu’est ce dernier avait déjà mis à mal en 2020 la méthode du pamphlétaire dans le portrait à charge que celui-ci venait de proposer de Camus pour la collection A Very Short Introduction (qui, avec tout le crédit des éditions d’Oxford, s’adresse au grand public anglo-saxon). Après avoir souligné les simplifications et torsions opérées dans cet ouvrage, il a été relayé dans sa veille critique par d’autres « camusiens » et par de bons connaisseurs des débats qui traversent en ce moment la sphère intellectuelle française, dont le jeune Algérien, Faris Lounis, journaliste indépendant et formateur.
Débusquer une tentative d’éradication intellectuelle
3Unissant leurs talents respectifs, ces deux auteurs ont voulu « retrouver Camus ». Certes, le discours d’accompagnement d’Oublier Camus soutenait qu’il s’agissait seulement de libérer « des manipulations de l’establishment politique […] une œuvre historique menacée par une propagande apolitique mise au service d’une tentation antipolitique plus inacceptable encore » (Préface de Fredric Jameson, p. 9-10). Retrouver Camus qualifie tout au contraire de « tristes tropismes » la conjonction des voix qui se sont réunies dans un soutien inconditionnel au pamphlet anti-camusien publié à la Fabrique :
Tristes, moins parce que de sincères fidélités aux luttes de libération nationale d’antan se refusent trop souvent à interroger les menaces pour l’avenir que recelaient nombre de leurs directions, et l’inconditionnalité de certains des soutiens qu’elles ont reçus. Tristes, moins parce que les indispensables résistances à toutes les formes de la violence postcoloniale dans notre société peinent à se donner des objectifs qui fassent vraiment réparation et ouvrent la voie à un dialogue civique égalitaire. Mais tristes, surtout quand des intellectuels en position d’auteur, d’éditeur, de chercheurs, de médiateurs culturels, loin de tenter d’ouvrir à ces fidélités et à ces résistances une visée démocratique universalisante, les instrumentalisent pour perpétuer des lectures simplistes de l’histoire et les fractures ethnico-sociales héritées de cette dernière. (p. 15)
4En cela, sous la parure d’une autoproclamée pensée critique, l’opération Oublier Camus procédait bien d’une offensive idéologique menée au nom d’une conception rétrograde de la littérature : celle qui la somme, plutôt que de symboliser le réel dans sa complexité, d’illustrer un point de vue « progressiste » qui abdique lui-même toute réserve sur les tendances despotiques des régimes du « socialisme réel » ou de nombre des directions de libération nationale. Faris Lounis et Christian Phéline veulent pour preuve de cette volonté d’éradication intellectuelle de toute pensée non conforme à de tels préceptes, l’injonction contenue dans l’infinitif du titre – bien corroborée par une simple lecture de l’ouvrage. Ils entendent, eux, relire l’œuvre de Camus « pour ce qu’elle dit vraiment, dans la réalité complexe des situations complexes où elle est née » (p. 19) : une lecture de gauche ? Soit, si cette démarche se distingue en tout de celle de tant de « plumitifs réactionnaires défendant Camus pour mieux le dévoyer » (p. 19) et « affadissant l’écrivain pour en faire un simple penseur du juste milieu, l’expose aux récupérations les plus suspectes » (p. 6) ; de gauche aussi, si cela implique que l’on interroge une œuvre d’une manière exigeante et lucide, sans méconnaître ses limites, mais en respectant la teneur exacte des écrits et le contexte historique de leur énonciation. Et d’abord par une utilisation rigoureuse du terme d’ « Algériens » – alors que Gloag valide par avance la définition « arabo-musulmane » exclusive de l’algérianité qui prévaudra après 1962 en désignant d’emblée ainsi les seuls colonisés, tandis qu’il parle des « pieds-noirs » comme d’une collectivité dont il réfute par définition qu’elle ait pu comporter des différenciations à l’égard du racisme contre les colonisés et dans l’attitude à l’égard du fait colonial.
5Pour mener cette autre lecture, il fallait d’abord montrer comment fonctionne le procès à charge – dont les auteurs de Retrouver Camus établissent, point par point, le caractère arbitraire.
Mettre au jour des méthodes abusives
6Dans la première partie, « Faux procès, vraies affabulations », Faris Lounis et Christian Phéline démontent minutieusement la manière dont Gloag opère pour persuader le lecteur que Camus aurait été, tout à la fois, un colonialiste obstiné jusqu’à la dernière heure, un résistant tardif et surévalué, un opposant à la peine de mort plus opportuniste que conséquent, et même un sexiste invétéré. On s’en tiendra ici au premier point : l’accusation majeure portée contre l’écrivain qui, pour n’avoir pas, avant sa mort prématurée, soutenu l’indépendance telle qu’elle se dessinait sous l’hégémonie du FLN, est réduit dans toutes ses positions à n’avoir jamais été qu’un paladin acharné de la domination coloniale – sans même que le polémiste ne relève qu’en se ralliant personnellement sans réserve, fin 1959, à la perspective gaullienne de l’autodétermination, il accepta en définitive ce que serait le choix majoritaire en Algérie. Sur plusieurs exemples, Retrouver Camus oppose à ces accusations à l’emporte-pièce une analyse très précise des détournements, confinant parfois à l’imposture, que le pamphlétaire inflige aux mots et aux situations.
7Camus, en défendant en 1937 le plan Blum-Viollette qui tendait à un lent élargissement du droit de vote des colonisés, aurait continué à prôner une simple réforme du régime colonial, à la différence des forces politiques « indigènes » qui, alors, seraient déjà « revenues de leurs espérances assimilationnistes » (p. 24-27). Il fallait donc rappeler que, tout à l’inverse, les réformistes religieux des Oulémas et les élus musulmans du Dr Bendjelloul et du jeune Ferhat Abbas, et le PCA lui-même, s’étaient alors réunis dans le « Congrès musulman algérien » en défense de ce même plan en le plaçant explicitement dans la perspective politique du « rattachement à la France » ; pour sa part, Camus voulait, non sans quelque volontarisme, y voir une étape vers « l’émancipation parlementaire intégrale des musulmans ». Réformisme pour réformisme, pourquoi donc retenir contre lui une position plutôt plus ouverte, du point de vue de « l’émancipation » de l’ordre colonial, que celle que partageaient alors toutes les principales forces se réclamant de l’opinion des colonisés ?
8De même, l’auteur d’Oublier Camus soutient que Camus aurait, la même année, « quitté le Parti communiste algérien juste au moment où celui-ci commençait à défendre des positions nationales ». Faris Lounis et Christian Phéline le soulignent (p. 27-30) : cette reprise d’une légende bureaucratique maquillant rétrospectivement la position des communistes algériens, occulte que le courant indépendantiste n’a commencé à s’implanter vraiment en Algérie qu’à partir de l’été 1937, avec l’Étoile nord-africaine telle que la dirigeait Messali Hadj. Le PCA, loin de se solidariser avec ce courant sur des « positions nationales », a alors activement soutenu son interdiction par le Front populaire, puis l’arrestation des dirigeants du PPA qui avait remplacé l’Étoile après cette dissolution. Camus n’a alors nullement « quitté » de lui-même un parti qu’il aurait jugé trop « national » : dans le sillage des sinistres « Procès de Moscou », il en a été exclu pour avoir manifesté son désaccord avec cette attitude pro-répression de l’appareil communiste. Il fut en outre jusqu’en 1939 le seul Européen d’Algérie à se prononcer publiquement pour la libération inconditionnelle de Messali et des autres dirigeants du PCA. Cette attitude n’en faisait certes pas un indépendantiste avant l’heure, mais pas davantage le suppôt le plus en pointe de l’ordre colonial que Gloag voudrait en faire. Mais elle singularisait plutôt positivement le jeune militant par rapport aux forces politiques algériennes de l’époque, au moins du point de vue du sens des droits démocratiques et de la solidarité militante face à la répression coloniale.
9Les deux auteurs de Retrouver Camus dénoncent également cette autre accusation qui fait de Camus un promoteur acharné de l’ordre colonial : il aurait, dans Alger républicain en 1938, défendu l’inégalité coloniale des salaires (p. 30-32) ; or il notait simplement que les augmentations alors obtenues par chacun n’était qu’un pis-aller, tant pour l’ouvrier indigène que pour l’ouvrier européen, et il défendait avec constance dans Alger républicain l’égalité de tous les travailleurs algériens face aux lois sociales.
10Il est de même reproché au compte rendu dans Combat des massacres de mai-juin 1945 dans le Constantinois d’avoir systématiquement minimisé les victimes parmi les colonisés pour insister sur les victimes parmi les Européens (p. 34-36) et d’avoir réduit la « critique [d]es carnages de Sétif et de Guelma par un euphémisme sans les nommer » (p. 40). C’est pour le pamphlétaire ignorer que le vocable de « répression collective » utilisé par l’écrivain pour les désigner qualifie de la façon la plus exacte, et mieux que celui de « massacres » à portée plutôt quantitative, ces formes extrêmes de la violence coloniale qui rompent avec le principe démocratique de l’individualité des peines selon lequel nul ne saurait être réprimé pour des actes qu’il n’a pas personnellement commis. Quant à l’article du 23 mai 1945, « C’est la justice qui sauvera l’Algérie de la haine », accusé de constituer « un appel à intensifier la colonisation », Camus, bien que favorable à la mesure, proposée par les communistes, d’étendre le droit de vote à tous les indigènes titulaires du certificat d’études, ne faisait qu’y noter, non sans bon sens, que cette mesure resterait vaine tant qu’un million d’enfants seraient sans école. Dans le même article, d’ailleurs, le jeune journaliste affirmait sa « conviction que le temps des impérialismes occidentaux est passé ».
11La polémique s’aggrave encore avec la dénonciation faite de l’article de Combat du 10 mai 1947 sur les massacres à Madagascar comme tendant à comparer les Malgaches aux nazis et « la contagion » visée dans le titre de cette tribune comme une mise en garde contre « le risque d’une épidémie de peste insurrectionnelle à nos colonies » (p. 37). Une lecture honnête suffit pourtant à vérifier que ce sont bien les pratiques coloniales répressives de la France et son recours à la torture que Camus dénonce quand il écrit que « nous faisons dans ces cas-là, ce que nous avons reproché aux Allemands de faire ». Mieux, s’il parle de « contagion », c’est pour s’inquiéter du sentiment de suprématie se répandant alors chez des Français qui « vivent, de manière inconsciente, sur la certitude que nous sommes supérieurs en quelque manière à ces peuples et que le choix des moyens propres à illustrer cette supériorité importe peu », et pour conclure par un vigoureux appel à combattre ce racisme, si l’on veut garder « le droit difficile de dénoncer, partout où il se trouve, l’esprit de tyrannie ou de violence » (p. 38-39).
12Les auteurs de Retrouver Camus le soulignent donc : une malveillance aussi systématique conduit à passer sous silence la précocité et la vigueur de la dénonciation camusienne de la montée en France d’un racisme contre les colonisés et contre les Algériens en particulier. Ce combat se poursuivra dans la protestation publique que l’écrivain sera l’un des rares à élever contre la tuerie dont furent victimes à Paris des militants du MTLD lors du défilé pacifique du 14 juillet 1953. La tribune parue dans L’Express du 29 novembre 1955 s’alarmera de même du fait que « l’un des effets du drame algérien [soit] le développement d’un état d’esprit raciste dans la population française » (p. 39) à l’égard des Algériens vivant en métropole.
13À propos de la torture, le pamphlétaire affirme que Camus « [n’en] parle pas [...], refuse de [la] condamner publiquement ». C’est ignorer que le jeune journaliste d’Alger républicain fut l’un des premiers, dans ses chroniques judiciaires de 1939, à dénoncer la pratique policière de l’eau et de l’électricité dont les suspects indigènes étaient alors déjà communément les victimes. C’est surtout dissimuler que, dans l’« Avant-propos » (mai 1958) des Chroniques algériennes, l’écrivain s’est exprimé avec la plus grande vigueur pour « dire que la lutte armée et la répression ont pris, de notre côté, des aspects inacceptables » et que « les représailles contre les populations civiles et les pratiques de torture sont des crimes dont nous sommes tous solidaires ». Il y appelait en outre à « refuser toute justification, fût-ce par l’efficacité, à ces méthodes », sans céder le moins du monde à « l’argument majeur de ceux qui ont pris leur parti de la torture » selon lequel elle aurait permis « de retrouver cent bombes ». Dans une référence transparente à la toute récente interdiction de La Question d’Henri Alleg, il concluait que, plutôt que « des méthodes de censure, honteuses ou cyniques, mais toujours stupides », le « devoir du gouvernement » serait de « supprimer et condamner publiquement » la pratique de la torture (p. 38-40).
14Bref, Faris Lounis et Christian Phéline établissent de la manière la mieux circonstanciée comment Oublier Camus fausse les textes et positions de Camus, selon « une vision de l’histoire n’admettant que des alternatives binaires telles que Colonialisme versus Indépendantisme, Anticommunisme versus Communisme, Non-Violence versus Violence révolutionnaire » (p. 16). Réduit à ces couples idéels simplistes, l’hégélianisme dont se prévaut le polémiste s’y résume « à un moralisme aussi abstrait que péremptoire ne sachant délivrer que le blâme le plus grave ou la glorification sans réserve » (p. 16). À cet égard, la part la plus fastidieuse du pamphlet de La Fabrique reste sans doute la longue narration manichéenne où, au mépris du sens de la nuance qu’aurait permis la distance historique, le débat Sartre-Camus de 1938 à 1960 se trouve rejoué en une caricature où « la célébration toujours superlative de la lucidité et de l’entièreté des engagements de l’un est opposée à ce que serait l’inconsistance intellectuelle et morale de l’autre » (p. 17).
15La seconde partie de Retrouver Camus, « La surinterprétation comme système », poursuit la mise à mal de la méthode du polémiste, dans l’a priori toujours hostile avec lequel il traite, cette fois, de chacune des œuvres narratives « algériennes » de Camus.
16Les auteurs exposent le travers de Gloag qui confond le plus souvent le personnage et l’auteur, imputant à ce dernier les positions de ses héros ou narrateurs de fiction (Marcel, le mari raciste de Janine dans la nouvelle « La Femme adultère » de L’Exil et le Royaume, ne serait ainsi qu’un porte-parole de l’attitude de Camus à l’égard des colonisés, et Meursault, dans L’Étranger, témoignerait en direct de sa distance à l’égard de ces derniers, voire de son souhait que prévale une « Algérie sans les Algériens »). Plus fondamentalement, le pamphlétaire enferme le romancier, et s’enferme lui-même, dans cette double impasse selon laquelle « reproduire fidèlement » une situation sociale critiquable, ou ne pas s’en démarquer explicitement serait, de la part de l’auteur, l’« accepter » ipso facto. Mais on voit alors mal comment, selon un postulat aussi absurde, la littérature aurait eu quelque chance de rendre compte des contradictions à l’œuvre dans une situation coloniale sans être accusée, soit d’en embellir les réalités, soit de les justifier...
17Cette partie, comme l’indiquent bien ses intertitres, questionne impitoyablement les interprétations arbitraires avancées dans Oublier Camus : « L’Étranger : le “fantasme” d’un “refoulement des colonisés” ? » ; « La Peste : une métaphore de la peur de l’insurrection coloniale ? » ; » L’Exil et le Royaume : négation du colonisé, idéalisation du colonisateur ? » ; « Le Premier Homme : l’espoir vain d’un retour au passé ? ». Arrêtons-nous, là encore, sur un de ces cas, celui de La Peste, où le polémiste va jusqu’à affirmer que le redoutable bacille serait non pas la métaphore de la menace fasciste, comme le prétendait l’écrivain et comme l’ont compris tant de ses lecteurs, mais celle du risque d’un soulèvement des colonisés et de la peur inspirée aux Européens par une telle « épidémie » ; et tant pis si, dès lors, les colonisés ne seraient à ses yeux que des rats et si Camus, à rebours de toutes ses convictions ou illusions sur un dépassement de l’antagonisme colonial des communautés, ne s’y montrerait qu’un précoce avocat des plus injustifiables « ratonnades » (p. 77-83) !
18De L’Étranger à « La Femme adultère », à « L’Hôte » et au Premier Homme, le lecteur découvrira par ailleurs les analyses très attentives et historiquement situées que Faris Lounis et Christian Phéline proposent de chacun des autres récits algériens. Elles établissent le caractère téméraire de tant de dénonciations se voulant postcoloniales qui voudraient n’y voir que romantisation nostalgique des premiers temps de la colonisation, mythe d’une terre qui aurait été vierge de ses habitants d’origine, ou fantasme d’une Algérie qui se débarrasserait d’eux. Les deux auteurs le rappellent en effet : si le jeune Camus de 1937 a pu s’illusionner sur le devenir des rapports entre les communautés, c’est, non pas dans le rejet des colonisés, mais bien plutôt dans la vision quelque peu irénique selon laquelle il n’y aurait « pas de différence entre la façon dont vit un Espagnol ou un Italien des quais d’Alger, et les Arabes qui les entourent », ou dans l’espoir que le desserrement progressif des discriminations coloniales ménagerait leurs retrouvailles dans une même « culture méditerranéenne ». Sur les deux décennies qui vont de 1942 à la mort de l’écrivain, chacune des situations mises en scène dans la fiction pourrait ainsi être comprise comme jalonnant symboliquement une prise de conscience de l’inanité d’une telle attente et de la manière dont l’impossibilité d’une relation de simple humanité en situation coloniale signait la proche finitude de la colonisation de peuplement.
Retrouver Camus, ouvrir à une relecture historiquement située de Camus
19Mais les deux auteurs, dans leur troisième partie, « Camus dans son siècle : des interpellations toujours actuelles », veulent aussi dépasser la polémique. Retrouver Camus n’y consiste pas à en faire, à l’instar de ses partisans mainstream, un prophète omniscient pour le xxie siècle mais à montrer, textes à l’appui, comment la manière dont il a interrogé son époque peut encore, au niveau des principes éthiques et politiques, éclairer les complexités de la nôtre.
20Lucidement, Faris Lounis et Christian Phéline soulignent d’abord la « part d’impensé » (p. 102-116) que comporte son analyse du fait colonial (ils préfèrent ce terme à celui, ouvert à trop d’abus subjectifs, d’« inconscient colonial »). Ils rappellent d’ailleurs que Camus lui-même, dans l’« Avant-propos » de Chroniques algériennes, reconnaissait ses possibles « insuffisances » et « erreurs de jugement ». Peu connaisseur du monde islamique, ne parlant pas l’arabe et ne vivant plus continûment en Algérie à partir du début des années 1940, il percevait mal les fermentations à l’œuvre dans la société coloniale et mesurait mal la profondeur d’enracinement populaire de l’aspiration à la libération nationale qu’il réduisait à une « formule purement passionnelle » (p. 105). Malgré les inconséquences auxquelles l’exposaient ces limites, les deux auteurs refusent que lui soit contestée la sincérité de ses propos en 1957 à Stockholm : « J’ai été et suis toujours partisan d’une Algérie juste, où les deux populations doivent vivre en paix et dans l’égalité. J’ai dit et répété qu’il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique. »
21Même si Camus n’a pas fait remonter ses combats jusqu’au principe du système colonial, les auteurs de Retrouver Camus montrent comment trois de ses interpellations, et jusqu’aux sérieuses inquiétudes qui le firent hésiter devant le drame algérien, sont « toujours actuelles » :
22À l’accusation d’anticommunisme proférée par l’auteur d’Oublier Camus, ils opposent d’abord (p. 116-122) le rappel de l’anti-stalinisme que Camus aura exercé de la façon la plus vigilante, et du partage que, proche des milieux anti-autoritaires et syndicalistes révolutionnaires, il aura su tenir entre « l’espoir et l’idéal communiste » de la Révolution russe et son involution despotique. Il est vrai que la pensée réductrice de Gloag bannit une telle dialectique « d’un débat qui ne connaît que le couple communisme / anticommunisme » et où l’État soviétique stalinisé d’alors reste identifié sans réserve par son préfacier au « choix de la révolution ». Quant à la conviction du pamphlétaire selon laquelle, en toutes circonstances, « le communisme est inséparable de l’émancipation des peuples colonisés », elle l’enferme dans une cécité volontaire sur les errements du PCA et du PCF sur la question coloniale, de la thèse fumeuse de la « Nation en formation » (1939) au vote des « Pouvoirs spéciaux » (1956), qui la contredisent ouvertement.
23Les deux auteurs de Retrouver Camus examinent ensuite comment et pourquoi l’écrivain, pour qui la question éthique et politique des moyens et des fins a toujours été une part essentielle de sa réflexion sur l’Histoire, a dénoncé toutes les « violences contre les civils » (p. 122-135), d’où qu’elles viennent et même quand elles se réclament de causes légitimes (comme l’étaient les luttes de libération). Ils l’observent d’ailleurs : Gloag se contente de simplement « oublier » l’Appel pour une trêve civile en Algérie lancé le 22 janvier 1956, avec l’appui au moins tactique de responsables algérois du FLN, dans la recherche d’une décrue concertée des violences contre les populations désarmées comme préalable à toute négociation sereine et inclusive sur l’avenir de l’Algérie. C’était bien sûr, précisent-ils, dénoncer toutes les atteintes que leur portait la force coloniale, et non pas proscrire aux colonisés toute violence, mais affirmer hautement que, pour eux aussi, « aucune cause ne justifie la mort de l’innocent ». Plutôt que d’affronter un débat aussi essentiel, le pamphlétaire reprend la sempiternelle mise en cause de la réplique sur « la justice et la mère » faite à l’interpellation d’un étudiant algérien lors de la remise du prix Nobel en décembre 1957, en y dénonçant une défense arrogante de l’Algérie française, quand son verbatim complet établit sans le moindre doute qu’elle ne visait que le cas, aussi évoqué dans Le Premier Homme, où cette femme, de la condition la plus modeste, aurait été victime de la violence aveugle d’un attentat de rue.
24Enfin, les auteurs posent avec Camus la question « Au-delà du colonialisme, quelle algérianité ? » (p. 136-144) ; question qui, selon l’écrivain, ne pouvait admettre, nous l’avons dit, un a priori arabo-musulman exclusiviste ou le déni de toute aspiration de membres de la communauté européenne ou juive à être partie prenante, dans le respect du plus grand nombre, d’une Algérie dégagée du joug colonial. Partageant l’indifférence à ces préoccupations qu’en leur temps manifestèrent la plupart des soutiens métropolitains du FLN, Gloag ne s’émeut guère de la conception à la fois ethniciste et politique de la nationalité qui s’est imposée en 1963, ni de l’impossibilité de fait à laquelle s’est dès lors heurtée la libre expression des minorités dans un nouvel État s’organisant selon le principe du parti unique. Les deux auteurs le soulignent : le pamphlétaire réduit à une émotivité communautaire, ou à une dernière ruse « colonialiste », la façon dont Camus voulait encore croire, en janvier 1956, qu’on puisse « faire coexister la présence française et la présence arabe » en « rend[ant] justice aux droits des uns comme des autres » (p. 143) ; ce faisant, il ne peut guère comprendre les sources intrinsèques de la faillite de tout pluralisme et de l’étouffement, par l’appareil militaire, de toutes les velléités démocratiques des Algériens d’aujourd’hui.
25Retrouver Camus signale ainsi tout ce que les prises de parti de Camus « peuvent encore apporter à la compréhension des drames de notre temps », époque où, dans un contexte nouveau, ces mêmes interrogations se reposent de la manière la plus aiguë. Dans la pensée camusienne du siècle passé, on trouvera des questions, pas des réponses : celles-ci, nous avons à les élaborer – avec la même vigilance politique et autant d’exigence éthique que celles que manifesta l’écrivain.
26Dans leur piquante conclusion, « Orwell, au secours ! Jdanov revient » (p. 145-154), Faris Lounis et Christian Phéline mettent à nu les soubassements idéologiques de l’opération Gloag, rendus plus manifestes encore par la récusation parallèle du romancier britannique, George Orwell (contemporain de Camus). Avec le renfort de son contempteur Edward Lee-Six et pour, comme tant d’autres, n’avoir pas assez « choisi son camp », ce dernier aura été accusé tour à tour dans le débat d’avoir été pro-impérialiste, délateur, antisémite et homophobe.... Un « Oublier Orwell » expéditif et pathétique, tant l’auteur de La Ferme des animaux ou de 1984 aura, par la force de ces métaphores, permis à plusieurs générations jusqu’à la plus récente, de mieux penser les ressorts des despotismes contemporains et la part décisive qu’y prend la dévaluation de toute vérité et de tout sens des mots dans leur novlangue. Non sans malice mais de manière fort démonstrative, Retrouver Camus suggère combien la pensée si tristement simpliste du polémiste et de ses soutiens procède d’un même appauvrissement du langage et s’embarrasse aussi peu de l’exactitude des textes et des faits. Mais les tenants d’Oublier Camus n’en reviennent-ils pas ainsi, volens nolens, à Andreï Jdanov, cet idéologue soviétique qui a inspiré les préceptes culturels et artistiques du « réalisme socialiste », tels que Camus en dénonçait en 1957 lors de sa conférence d’Upsal, qui a suivi la réception du prix Nobel, la stérile visée moralisatrice et édifiante : un « académisme de gauche », promouvant « un art de propagande avec ses bons et ses méchants, une bibliothèque rose, en somme, coupée, autant que l’art formel, de la réalité complexe et vivante ». Au risque que « l’art vrai [soit] défiguré, ou bâillonné », ceux qui s’en font aujourd’hui les nouveaux champions n’hésitent pas à appeler à « oublier » tout auteur du passé victime de leur projet d’autodafé intellectuel. Faris Lounis et Christian Phéline lancent l’alerte : « Ce néo-jdanovisme révolu ne pourrait aujourd’hui que gravement dévoyer la réflexion critique tant sur l’histoire et la littérature que sur bien des questions éthiques et politiques actuelles que, dans ses limites, la pensée de Camus reste à même d’éclairer. » (p. 154)
27Oui, décidément, il faut lire, et de près, tout Retrouver Camus ! Ceux qui veulent réfléchir sur et à partir de Camus, y trouveront un ambitieux programme de réflexion et de travail pour les années à venir…

