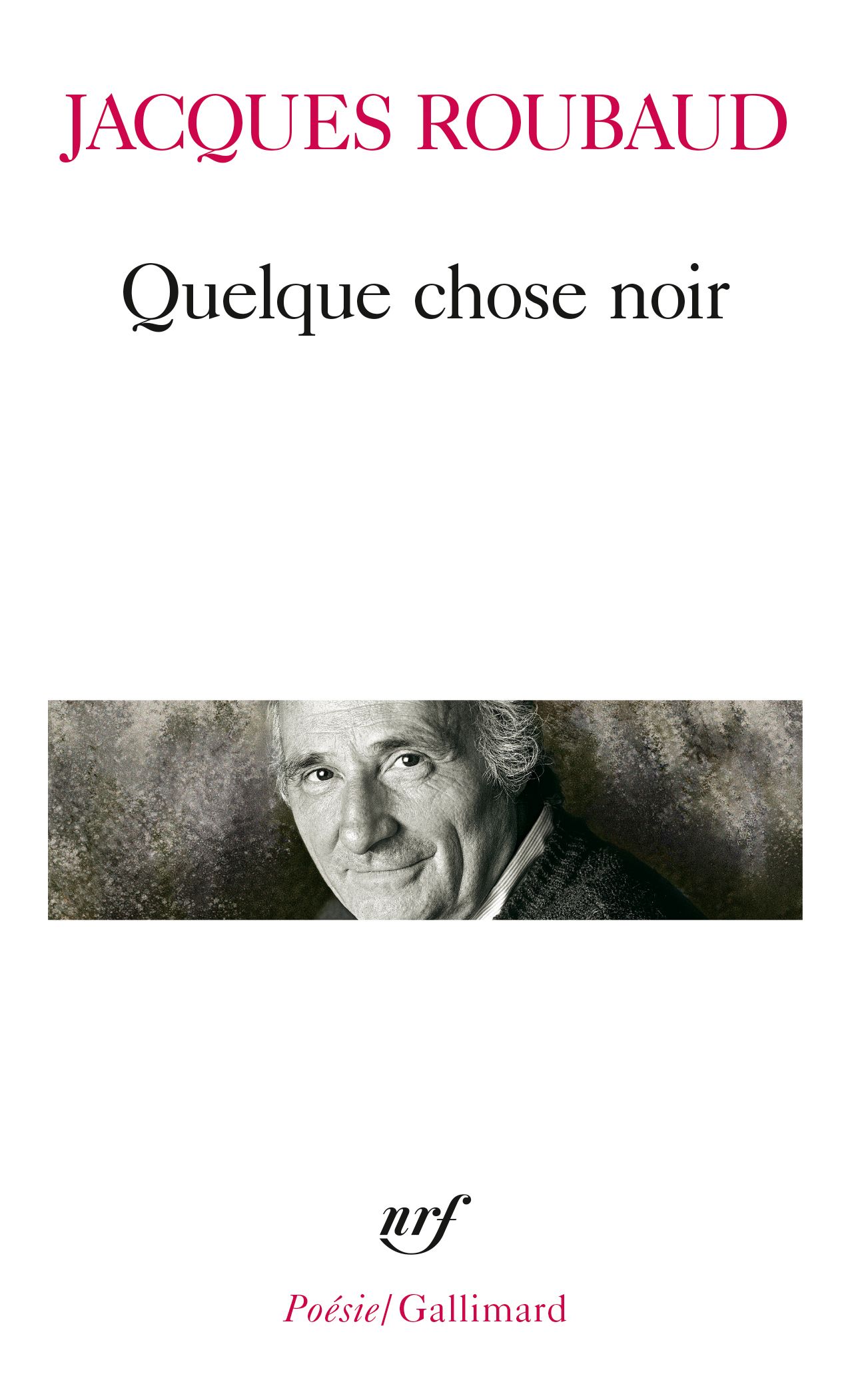
Lire Quelque chose noir de Jacques Roubaud à l'aune des théories linguistiques sous-jacentes, par Marta Krol (inédit)
Lire Quelque chose noir à l'aune des théories linguistiques sous-jacentes
Par Marta Krol (Université de Strasbourg)
—
I. Introduction
Il n'est plus utile d'insister auprès des lecteurs de Jacques Roubaud sur l'importance dans son œuvre de la doctrine des troubadours, et sur le double rôle de l'amour et de la mémoire, essentiels dans Quelque chose noir (Gallimard, 1986, désormais : QCN). Les agrégatifs sauront aussi bien situer ce poète mathématicien et joueur de go parmi les membres de l'Oulipo, en observant dans le recueil le maniement de la catégorie du nombre. On a par ailleurs déjà souligné l'intérêt de l'écrivain pour la poésie médiévale japonaise. La présente étude met au jour une influence moins manifeste et pourtant constitutive du recueil : celle des théories philosophiques et linguistiques qui dominent le paysage des sciences humaines dans la deuxième moitié du XXe siècle. Considéré à juste titre comme un savant, Jacques Roubaud est aussi un esprit de son temps, vivement intéressé par les modèles du langage en vogue, d'autant que ceux-ci adoptent une démarche mathématico-logique qui lui est familière. Tout au long du recueil se trouvent disséminés des marqueurs peu apparents qu'il faut savoir interpréter, en tant qu'outils conceptuels du poète et objets de méditation.
II. Pour mieux lire Quelque chose noir
À partir du courant de la philosophie analytique anglo-saxone, née avec la logique des propositions et le calcul des prédicats du mathématicien allemand Frege (1848-1925), un mode d’analyse et une symbolique issus de la logique formelle ont renouvelé la linguistique à partir du milieu du siècle. Ainsi, une sémantique vériconditionnelle appréhende-t-elle le sens linguistique à travers ses conditions de vérité, et déjoue la disjonction classique vrai / faux appliquée aux langues naturelles en adoptant les concepts, propres à la logique modale, de vérité floue, de mondes possibles et d'univers de croyance. L'idée centrale est que la vérité en langage naturel n'est pas bijective, mais relative à des espaces dits contrefactuels et à des situations discursives. Avant les linguistes (Robert Martin, Jean-Claude Milner et bien d'autres), ce sont les philosophes, les logiciens et les philosophes du langage qui ont posé les prolégomènes de ce courant de pensée, en s'emparant d'objets primitivement linguistiques tels que « sens », « proposition », « phrase » ou « négation ». Trois d’entre eux sont nommés dans l'œuvre : Ludwig Wittgenstein (p. 45), Jean-Claude Milner (p. 75) et Alexius Meinong (p. 87) ; d'autres (Gottlieb Frege, Bertrand Russell, Willard Orman Quine, Saoul Kripke, Noam Chomsky, David K. Lewis...) y sont convoqués d'une manière implicite mais non moins lisible, à travers certains de leurs concepts.
1. Ce que « montre » la proposition : de Frege à Wittgenstein
L’œuvre de Frege a fait entrer dans le vocabulaire philosophique le terme de « proposition », pour le rendre à la linguistique dans une acception spécifique qu'actualisent plusieurs occurrences de QCN (p. 14, 75, 101, 128-9) : la proposition bien construite se définit désormais en linguistique comme un énoncé doté de sens. Ce sens consiste en sa valeur de vérité (p. 101) qui peut être : « vrai » ou « faux » (cf. p. 14 : je comprenais très clair le sens de cette proposition. parceque je contemplais sa confirmation négative). Les deux valeurs obéissent à la loi du tiers exclu, ou au principe de non-contradiction (p. 87) : non-vrai implique faux, et non-faux implique vrai ; la négation se superpose ici à un type d’antonymie (l’antonymie contradictoire). Dès lors, on peut situer l'intérêt patent du poète pour la négation, qui consiste à inverser la valeur de vérité d'un énoncé. Le je du recueil tente notamment d'examiner ce que pourrait être la négation ou le contraire de « Elle est vivante » (p. 128), cette proposition, fausse dans [s]on univers, et de s'en emparer par le biais de dénominations (rien-toi avec exactitude, ce bipôle impossible p. 85) et de prédications (La négation de toi, p. 87). C'est pourquoi la négation se présente sous toutes ses formes et se voit fréquemment thématisée (Je ne peux pas écrire de toi, p. 121 ; L'irressemblance, p. 17 ; Théologie de l'inexistence, p. 84 ; Il n'y a pas de négation possible de ton nom, p. 88 ; Maintenant sans ressemblance, p. 107 ; Nonvie, p. 140 et passim, jusqu'à Rien, p. 146).
D'autre part, on doit à Frege[1] le terme description définie (expression employée p. 109), soit un SN déterminé par un article défini, et dont le nom-tête un nom commun qui désigne un individu unique à la faveur de son sens lexical (parmi ses exemples : le vainqueur d'Austerlitz vs. le vaincu de Waterloo). Le poème « Cette région » p. 109 fait partie de ceux qui montrent combien la sémantique logique fregéenne fournit au je de QCN un prisme (mais non pas un cadre strict) à la méditation poétique. La description définie le Ministère de la Marine évoquant un souvenir dessiné avec une précision maniaque forme dans l'esprit du scripteur une dérisoire région, par manière de dire, ou encore un paysage moralisé mais en réalité totalement éparpillé[s].
Élève puis contradicteur de Frege, le philosophe du langage autrichien Ludwig Wittgenstein (1889-1951) est une référence récurrente dans le journal intime d’Alix ; on comprend grâce au poème éponyme (p. 45), figurant dans la section III dédiée aux souvenirs de moments partagés, que le couple s'était rendu sur la tombe du philosophe. Se consacrant à la photographie d’art, Alix projetait une thèse sur la théorie de l’image dans Wittgenstein (dite par les spécialistes la picture theory). Le motif de l’image ou de la monstration est envisagé par le philosophe soit de manière abstraite, comme la forme même de la proposition (elle montre, dit-il), soit concrètement, comme une représentation plastique (par exemple un tableau de peintre). Ce motif est central dans le Tractatus philosophicus[2] (1921) qui fait système, mais présent également dans l’œuvre postérieure, notamment dans Investigations philosophiques (publiés à titre posthume en 1953), qui assouplit largement le Tractatus en consacrant les concepts de langage naturel et de jeux de langage. Aussi l'image est-elle un leitmotive du recueil : la section VI (pp. 91-103) y est dédiée, sans pour autant l'épuiser (cf. Images de toi, ces mots, p. 34 ; L'encre et l'image se retrouvent solidaires et alliées, p. 47 ; la réflexion sur la couleur inspirée de Wittgenstein, p. 57 ; Ce qui est complète ce qui se montre mais maintenant le nie, p. 65 ; car si cette image, à jamais devait me taire p. 111 ; cf. aussi les occurrences toutes wittgensteiniennes, p. 15, 21, pp. 31-32, 117, 123, 128). Dans la même perspective, le retour du motif le golfe de toits (p. 20, 31, 37, 56, 91-2, 103) dit la volonté de rendre compte d'une configuration perçue (par la fenêtre), en sa valence plastique de l'image.
Autre référence nette à Wittgenstein, le poème « L'irressemblance » (p. 17) emploie le concept d'air de famille et exploite avec une ironie amère le critère afférent de ressemblance, critère d'attribution du référent à une catégorie nominale proposé par Wittgenstein à la place du modèle dit CNS[3] ; le nom l'investigation au premier paragraphe reprend le titre même de Wittgenstein. Dans « Morte » (p. 68), appartiennent au champ conceptuel du Tractatus l'expression un état-des-choses, la réflexion sur la couleur (pour le philosophe, attribut nécessaire de l'objet perçu) que traduit incolore, ainsi que la dialectique intérieur-extérieur. Également, « La certitude et la couleur » (p. 57) met en question la thèse wittgensteinienne sur la nature indissociable de la perception d'un objet et d'une couleur, en évoquant des incertitudes et flottements catégoriels dans l'application des adjectifs rouge, vert, blanche et noire relativement aux images mémorielles ou matérielles de la défunte.
D'autre part, le poète nourrit sans doute un intérêt particulier et personnel pour le philosophe autrichien à cause de la préoccupation centrale du Tractatus : que peut-on exprimer ? Dans la préface de celui-ci, le philosophe formulait cette célèbre réponse : Ce qui peut être dit peut-être dit clairement ; et ce dont on ne peut parler, il faut le passer sous silence ; c’est aussi la dernière proposition du traité. Il est à noter que le silence n'est pas exactement un renoncement aux yeux du philosophe ; il peut au contraire être un versant du dire : « Il ne faut pas chercher à exprimer l’inexprimable, dit Wittgenstein dans sa correspondance. L’inexprimable se tient, inexprimablement, dans ce qui est exprimé ». J. Bouveresse (1973 : 14) signale que selon Wittgenstein le « [Tractatus] se composait de deux parties : celle que nous possédons et une autre, non écrite, qui est en fait la plus importante ». En effet, ce qui est tu peut se montrer : l'alternative dire / montrer correspond — dans le meilleur des cas, non pas dans celui d'un silence informe — à celle entre exprimer et taire. Le poème « Mort » (p. 66) médite cette question, familière à Alix même dans son journal. La mort est éprouvée comme une monstration vide, caduque : Ta mort, de ton propre aveu, ne dit rien ? elle montre. quoi ? qu'elle ne dit rien [...] (p. 66).
Le point essentiel est que sur le plan macrostructural, la lutte entre la tentation du silence (Entre les mois de silence où je ne me prolongeais que muet. / Et le futur proche où je me tairai de ces poèmes, p. 85 ; je vais me mettre à verser dans le second silence, p. 86, etc.) et la tentative inchoative de dire (te dire, encore), malgré l’extrême difficulté de l’entreprise qu’atteste partout le vacillement de l’attelage sujet-prédicat[4], est la tension constitutive du recueil : entre ces limites étroites je dois essayer de me tendre (p. 86). « Méditation du 21/7/85 » (p. 25) culmine sur On ne peut pas me dire : « il faut le taire » ; car Quelque chose va sortir du silence, de la ponctuation, du blanc remonter jusqu'à moi (p. 124). En somme, on peut lire QCN comme une exploration de l'alternative wittgensteinienne entre le silence et l'expression claire : Devant ta mort je suis resté entièrement silencieux. [...] Avant cette autre mort je ne savais comment dire. j'étais comme silencieux (p. 131-2).
2. Où es-tu ? Exister, subsister, être parlé avec Meinong
Le philosophe autrichien Alexius von Meinong (1853 - 1920) mentionné dans « Apatride » p. 87, énonce entre autres que la totalité des objets accessibles à l'esprit sont des types et des modes d'être divers. Il en distingue trois grandes classes : les objets qui existent (tel un arbre) ; ceux qui subsistent, c'est-à-dire qui sont réels, qui ont un univers, sans pour autant exister (par exemple les nombres, la différence entre rouge et vert) ; les heimatlos, objets apatrides ou sans lieu parce qui n'existent ni ne subsistent, n'ont pas d'univers, telles les fictions. Les heimatlos sont dits paradoxaux parce qu'ils échappent au principe de non-contradiction: d'une manière logiquement impensable, à la fois ils n'ont pas d'univers et ils sont des objets, c'est pourquoi ils ne sont plus quelque part (je veux dire en quelque construction) possibles (p. 87). Ne pouvant être affirmés, ils ne sont pas sujets à la négation : objets incolores, apatrides, noyau dur sur lequel la négation n'avait prise [...] (p. 78). Le je méditant assimile à ce dernier type les êtres passés et révolus, parlés présents (p. 87) ; on voit que le paradoxe tient ici en un tiers qui défie non plus l'alternative entre être (dans un univers) et ne pas être, mais celle entre être passé et être présent. Ce tiers est suspendu à l'acte de nommer largement thématisé (Te nommer p. 87 etc.) : les êtres paradoxaux roubaudiens, en particulier Alix, sont affirmés présents par l'adresse (p. 87). Il n'en reste pas moins que, conformément à la typologie de Meinong, ils n'ont pas d'univers (cf. aussi « Où es-tu ? », p. 19). Le poème « Dans cette lumière, IV » (p. 117), par le contre-rejet inaugural Située / dans l'entre-monde, insistant puis par le verbe subsiste, fait nettement écho à cette thèse. Si grâce à la théorie des êtres apatrides le poète peut se soutenir de l'idée qu'un tiers n'est pas exclu entre le passé et le présent, point de consolation facile. Il ne cède pas pour autant à la facilité d'une fiction, de quelque construction, ce que souligne l'adverbe pourtant : Et pourtant il ne m'est pas envisageable... tout comme, dans « Méditation de la comparaison », l'assertion programmatique je pourrais mais je ne m'y résigne pas (p. 85).
La seconde thèse de Meinong pourrait également être un vecteur de l'écriture du deuil. Elle affirme que tout objet, qu'il existe ou non, a nécessairement une nature ou une essence qui lui permet de devenir le sujet d'un jugement correct de prédication. La montagne d'or (exemple de Meinong, utilisé p. 130 montagnes d'or) est d'or et elle est une montagne, bien qu'elle n'existe ni ne subsiste ; il en irait de même de l'épouse morte, une fois la dénomination adéquate trouvée : En te nommant je voudrais te donner une stabilité [...], Te nommer c'est faire briller la présence d'un êetre antérieur à sa disparition [...], Ton nom est trace irréductible (p. 87-8). Pour Meinong, l'« être-ainsi » de tout objet est bien indépendant de son être. D'autre part, le poème « Maintenant sans ressemblance » (p. 107), et la section VII qu'il ouvre, se mesurent au défi de rendre compte de la situation d'énonciation, déictiquement convoquée — d'un maintenant (p. 107), de cette lumière (p. 108, 111, 114, 117), de cette région (p. 109), etc. — dans laquelle le je lyrique fait l'expérience de la présence d'un tu, et tente de le décrire, alors que ce tu est sans référent. Le poème cité enchaîne, en exacerbant la perspective meinongienne, des prédicats sans support exprimé et sous le coup de négativité (mettons ici de côté leur grammaire propre) : Sans même temps sans infini / Sans tain noir [...] / Maintenant sourde ayant cessé d'être nue ayant cessé d'être femme ayant cessé [...].
Par ailleurs, le vers Sans couleur dors furieusement (p. 117) est une citation libre de Noam Chomsky (père de la grammaire générative transformationnelle né en 1928) dont la thèse sous-jacente n'est pas sans lien avec le propos de Meinong. Elle stipule que la forme de l'énoncé, sa syntaxe, est à elle seule un véhicule du sens linguistique. Ainsi la séquence « incolores idées vertes dorment furieusement », parce que grammaticale, formellement correcte, est recevable et interprétable (par exemple par métaphore) malgré les incompatibilités lexicales qu'elle exhibe. On voit comment l'écrivain peut associer cette thèse à la fois à celle du jugement correct impliquant un objet ne serait-ce que paradoxal (Meinong), et à celle de la monstration de la phrase (Wittgenstein).
3. Le secours des mondes possibles et de la rigidité du nom : théorie sémantico-logique du langage
La référence à Meinong conduit tout droit à la théorie des mondes possibles, domaine philosophico-logique majeur du XXe siècle que le recueil mobilise largement. Roubaud, en mathématicien formé à la logique modale, s'y intéresse : il publie en 1991 le recueil La Pluralité des mondes de Lewis (le philosophe David K. Lewis, 1941-2001, est l'auteur de On the Plurality of Words), et se réfère fréquemment à des contributeurs de cette théorie, par exemple Jaako Hintikka[5] (1929-2015). Cette théorie (en dépit d'appropriations interdisciplinaires réductrices dont elle est souvent l'objet) repose sur un formalisme serré et requiert des compétences précises en logique, dont le lecteur de Roubaud est exempt. Elle manipule des entités linguistiques, à savoir les propositions, auxquelles elle applique les différentes valeurs de modalité à l'aide d'opérateurs et selon des lois rigoureuses. Les modalités dites classiques ou « aléthiques » qu'elle manipule sont le nécessaire, le possible et le contingent[6]. Parmi elles, la modalité du possible ouvre à la notion de mondes possibles, construction abstraite qui ne se superpose pas à la banale éventualité (comme dans l'expression « C'est possible »). Un monde possible est un domaine contrefactuel dans lequel les énoncés ne sont pas déclarés vrais, mais comme pouvant être vrais. Contemporain de Roubaud, Robert Martin, principal linguiste français à l'avoir mis au travail (1983) dans sa discipline, analyse ainsi les morphèmes du futur, du conditionnel et du subjonctif comme principaux opérateurs des mondes possibles (à côté d'opérateurs modaux comme peut-être) en langage naturel.
Trois poèmes au moins sont élaborés à partir de ce concept, significativement se faisant suite dans l'ordre du recueil : « Roman-photo » (p. 51) et « Roman II » (p. 53) sont précédés de « Une logique » (p. 49). Les deux premiers, qui le convoquent explicitement, concourent sans surprise à la série de « romans ». Cette référence générique intéresse le poète en ce que le roman est le genre par excellence de la fiction, c'est-à-dire de la fabrique des mondes que l'on pourrait qualifier de possibles. La modélisation de la fiction langagière par ce concept de la logique, proposée par plusieurs auteurs de la mouvance logicienne, demeure une question largement débattue de la théorie du récit[7]. Le lecteur comprend la fonction, au sein de l'écriture du deuil, de l'hypothèse formulée p. 51 : Le roman se passe dans plusieurs mondes possibles. Dans certains, la jeune femme n'est pas morte, tout comme il entend l'audace consistant à poser, à l'encontre de Robert Martin, que Le temps est présent. le temps de chaque monde possible est présent. Seulement, cette exacerbation locale de la fiction des mondes possibles se voit ironiquement annulée par son titre : l'impitoyable syntagme roman-photo renvoie à un genre populaire grossièrement naïf, tout en maintenant par syllepse l'allusion aux photographies (d'Alix) qui relancent la pulsion fictiogène de dénégation. Le texte suivant « Roman, II » (p. 53) recourt à des marqueurs stylistiques du genre romanesque (une prose de facture canonique vouée à la mimesis, découpage en épisodes, narrateur omniscient, discours représentés...) pour faire surgir une scène toute fictionnelle d'un coup de téléphone reçu par un homme abandonné, à cause d'une autre mort. Le ressort fictionnel réside en ce que la correspondante appelle d’un monde possible [...] avec cette seule différence que, dans ce monde, elle n’est pas morte. La suite du poème consiste en une méditation sur l'espace ainsi ouvert du monde possible (l'énallage au singulier atténue subtilement la référence logicienne) et sur les conditions de possibilité de celui-ci : Tant qu'il [le téléphone] ne sonne pas le nouveau monde, le monde possible est encore possible. Le domaine logique du contrefactuel devient pour le poète un espace d'appropriation intime qu'il voudrait presque être le lieu d'une hallucination (Un monde auquel il continuera de penser tout le temps ; Imaginant, dans son imagination). Mais, au futur qui vient balayer d'un revers du morphème le subjonctif du possible précédent (que sonne, que vienne), sa lucidité s'y oppose (se sera une autre voix, une voix quelconque. il l'entendra) en même temps qu'elle l'exile du monde (Cela ne prouvera pas qu'il [l'homme] est vivant).
Le titre « Une logique » (p. 49), certes polysémique, renvoie à l'évidence à la discipline à laquelle le poète doit le concept des mondes possibles, ici encore central bien que non nommé. Le premier vers Une sorte de logique pour laquelle tu aurais construit un sens moi une syntaxe [...] fait allusion à la fois au titre de Robert Martin et à celui de Jean-Claude Milner, hypotexte savant vers deux ouvrages de référence en sémantique formelle. Le texte précède et annonce la série de « romans » en évoquant fictivement, en vertu d'une sorte de logique entre syntaxe et sens (ou « interprétation » de Milner), le monde d'un seul, mais qui aurait été deux. L'important est ici que ce monde est décrit, conformément à la théorie de R. Martin, dans la modalité grammaticale contrefactuelle par excellence, à savoir non seulement au conditionnel mais au conditionnel passé (tu aurais construit ; le monde aurait été ; une [...] distance qui n'aurait pas pu ; la pensée [...] aurait été ; seules auraient existé [...]). Le monde « biispiste », concept roubauldien, est décrit comme monde possible du point de vue purement logique, l'éventualité étant exprimée comme révolue. Mais sa description comme hallucinée, à la fois minutieuse et onirique, n'en révèle pas moins la réserve de l'élaboration poétique qu'offre à Roubaud la notion formelle des mondes possibles.
Le poème « Univers » (p. 128) mobilise quant à lui, sans le citer, un concept connexe : celui des univers de croyance, soit l'ensemble des propositions, explicites ou implicites, que le locuteur tient pour vraies au moment où il s'exprime[8]. Ce concept implique la notion d'anti-univers, c'est-à-dire un ensemble des propositions qui, quoique fausses au moment de l'énonciation, auraient pu être vraies dans un univers contrefactuel. Le vocabulaire du poème engage fortement ce cadre : proposition, un / autre univers, vraie, fausse, vérité, univers fictif, univers de discours... ainsi qu'à ses procédures : la démarche hypothético-déductive si... alors il faut que..., la loi du tiers exclu (toute proposition étant soit vraie soit fausse), le maniement du mode conditionnel au § 6.
Dans le recueil, d'autres expressions sont issues de la théorie sémantico-logique, comme le syntagme sens contingents (p. 123) qui met en cause le dogme saussurien de la stabilité lexicale des unités linguistiques en évoquant la modalité philosophique de la contingence. De même, le SN cette désignation rigide (p. 62) reprend le terme désignateur rigide de Saoul Kripke (1940-2022). Ce descripteur est désormais de rigueur en linguistique pour caractériser le nom propre : Kripke a pu décrire le nom propre comme un désignateur rigide en démontrant que, contrairement à la description définie, il n'a pas de sens, mais seulement désigne[9] (toujours le même individu). C'est pourquoi Roubaud peut affirmer : Il n'y a pas de négation possible de ton nom (p. 88), puisque seules les unités dotées de sens peuvent être niées. L'appariement référentiel d'un nom propre ne passe pas par l'interprétation (soit la compréhension, l'intension) du mot mais repose sur la seule connaissance d'une convention, d'un "acte de baptême", qui veut et qui suffit que X renvoie toujours à tel individu. Ainsi Kripke refuse-t-il la thèse selon laquelle une description définie (comme l'assassin de Henri IV, exemple de Russell) nous livre le sens d'un nom propre comme Ravaillac. Il soutient qu'une description défnie n'est qu'un moyen de fixer la référence du nom propre, mais en aucun cas une expression synonyme du nom propre.
Roubaud n'ignore pas que le modèle des mondes possibles intègre la notion du nom propre. Il y fait allusion dans « Je vais me détourner » : Quand il n'était pas pour moi cette désignation rigide se répétait dans un monde possible (p. 62). Le modèle admet en réalité que des termes correctement quantifiés, et non seulement des noms propres, soient des désignateurs rigides, i.e. qu'ils désignent les mêmes objets dans tous les mondes possibles. D'une manière plus précise, le poète explorera la conception kripkéenne (et milneréenne) dans Poétique en posant que « Un nom commun est le nom propre d'une chose »[10].
« Monde naïf » (p. 130) se rattache également à cette théorie en ce qu'il évoque — et critique — la construction fictionnelle. Les SN montagnes d'or, chevaux ailés renvoient (outre l'allusion à Meinong) à des entités du conte merveilleux, soit d'un monde qui n'est pas nécessaire (réel, le nôtre) mais possible et auquel nous avons accès, puisque nous pouvons comprendre ces expressions. L'absence de déterminant associée au pluriel, le manque de prédicat verbal et la nature stéréotypée des syntagmes produit néanmoins une référence vague, sorte d'ersatz référentiel dévidé de sens. Le SN monde naïf disqualifie sans ambiguïté cet univers. L'expression suspension du refus incrédule reprend un des éléments-clés de la théorie de la fiction afférente, à savoir que l'univers fictionnel repose sur la règle de « faire-semblant de croire » (make-believe ou feintise ludique[11]) propre au jeu, compris aussi bien comme play que comme game, ou encore qu'il se soutient d'une suspension volontaire par le lecteur du critère vériconditionnel[12]. Les quatre derniers vers du poème affirment l'empire inexorable du rien sur des tentatives naïves de construction fictionnelle.
4. Non, la mort est idiote : un dialogue avec Milner
Jean-Claude Milner, dédicataire de Méditation de l'indistinction, de l'hérésie (p. 75), est un important continuateur français de la sémantique des mondes possibles. Le §. 817 de la Poétique le cite en ces termes (la parenthèse appartient à Roubaud) :
« “L’activité grammaticale est supposée par le moindre système de poésie. Car enfin, toute poésie repose sur un retour du même dans la langue [...]. Pourtant, jamais la perception sensible ne suffit à déterminer ce qui comptera ici comme même et comme différent. Il y faut une doctrine autonome, laquelle se fonde nécessairement sur un jugement que le sujet porte sur sa propre langue. Implicite ou explicite, ce jugement, dans son essence, est grammatical. Or, toute langue est capable de poésie ; il s’ensuit que toute langue est capable de grammaire.“ (c’est moi qui souligne) »
Plus loin on peut lire :
« 834. Hypothèse – Tout possible matériel de langue est un possible de poésie.
835. Il y a là une distance à la langue si on admet, avec Milner, que le possible de langue et le possible matériel peuvent ne pas coïncider. Cette distance de la poésie à la langue est fondamentale. »
Le poème en question ouvre la section V qui thématise la difficulté de nommer l'expérience actuelle du deuil. Par ses traits stylistiques qui imitent un raisonnement formel (ex. On conclura à l'impropriété), il se donne dans la perspective de Milner pour un jugement analytique sur la langue, et pour une tentative de grammaire de la poésie. En imitant la méthode d'un problème de logique, il débute par trois suppositions pour enchaîner sur leurs conséquents (se déduisent, sans pertinence, des propositions comme chaîne). Ceux-ci conduisent à la conclusion sur la disparition de tout rapport : [...] on conclura qu'il n'y a que du dissemblable et de là, qu'il n'y a aucun rapport (ce dont une manifestation éloquente est la défection du rapport nodal sujet-prédicat dans le recueil). La progression du poème tend à montrer que les positions de Milner conduisent à s'annuler d'elles-mêmes, puisqu'il peut arriver que le possible matériel de la langue fasse défaut (rien ne saurait se dire), que la non-coïncidence entre la langue et le monde voulue par Milner soit radicale (rien désormais ne lui est semblable souligné par le poète) au point de destitue[r] tout ce qui fait lien. Partant, aucun rapport n'est définissable, à l'encontre de ce qu'affirme la thèse du « jugement grammatical » du linguiste. Il ne peut donc y avoir pour le poète de grammaire entendue comme formalisation du même, comme actualisation calculée d'une règle, sous la forme d'un vers répondant à un autre vers. La mort qu'il s'agit de dire est en effet idiote[13] (p. 35), i.e. radicalement singulière (p. 79) ; si bien qu'on ne peut rien en prédiquer, la rapprocher de rien : la mort même même. identique à elle-même même (p. 16). Faute de même autre que la mort il n'y a que du dissemblable ; faute de répétition, constitutive de la poésie[14], il ne peut y avoir que la mécanique réitération ; les structures linguistiques, les touts, se défont à même le tissu abominable : la réalité. Cette réalité, le lecteur l'a compris dès le premier poème (Je me trouvai devant ce silence), est le moment du constat de la mort d'Alix, l'expérience inassimilable et inénarrable, quelque chose noir qui se referme. et se boucle. sans cesse, déposition pure, inaccomplie (p. 76). Reste que le poème a pu prendre forme, mobiliser un possible matériel, pour dire l'impossibilité du dire dans la langue ; en cela, l'héritage de Milner reste sauf.
5. Comment la destruction fait son œuvre : être lucide avec Jakobson
Principal courant linguistique et intellectuel du XXe devenu le paradigme explicatif transversal en sciences humaines et sociales, le structuralisme ne se manifeste que ponctuellement dans QCN. Le poème « Aphasie » (p. 131) commence par le nom de Jakobson, éminent linguiste russe appartenant au courant structuraliste du cercle de Prague : Jakobson dit que l'aphasie mange la langue à l'envers de son acquisition. Les articulations les plus récentes partent les premières. Ce §. renvoie à l'essai Deux aspects du langage et deux types d'aphasie[15], texte décisif pour le domaine des sciences du langage. Le passage est le suivant (p. 60) :
« La régression graduelle du système phonologique chez les aphasiques montre régulièrement, sous forme inversée, l'ordre des acquisitions phonologiques chez l'enfant [...] le malade retombe dans les phases initiales du développement linguistique du petit enfant ou même au stade pré-linguistique. »
Parmi bien d'autres questions soulevées, pour aborder l'aphasie comme un problème linguistique Jakobson identifie au préalable les « deux modes d'arrangement » de tout signe, distinction désormais célèbre : l'axe de combinaison, paradigmatique (sélection, substitution), et l'axe de sélection, syntagmatique (combinaison, contexture). Sur cette base, le texte du linguiste associe la métaphore à l'axe de substitution, et la métonymie à l'axe de combinaison ; partant, la dichotomie entre les deux procès ou pôles régit pour Jakobson tout développement d'un thème (topic) dans « le comportement verbal et le comportement humain en général » (p. 64, ibidem). Or, le je lyrique de QCN refuse explicitement et obstinément le procès de la substitution ou de la comparaison, perçu comme une facilité : Il pourrait me venir à l'esprit de te comparer à un corps noir, rayonnant [...] qui n'arrête pas de me parvenir [...] Je le pourrais me je ne m'y résigne pas (« Méditation de la comparaison », p. 85), ou Je ne m'exerce à aucune comparaison [...] je m'enfonce par les ongles (« Méditation du 12/5/85 », p. 11). Le refus de substituts fictionnels (cf. supra) participe de ce mouvement. Avec acharnement (Je m'acharne p. 85), le poète choisit le procès métonymique, celui de la contiguïté : à circonscrire [...] avec l'exactitude (p. 85) ; je m'enfonce par les ongles (p. 11). La théorie jakobsonienne est le lieu d'une élaboration puissante bien que ponctuelle.
III. Conclusion
L'œuvre est ainsi irriguée de théories philosophiques et linguistiques centrales de la deuxième moitié du XXe siècle. Plus que de « références », il s'agit des véritables composantes, d'ingrédients souvent implicites du processus d'écriture. La coïncidence entre la problématique personnelle de l'écrivain et les catégories philosophico-linguistiques du nom, du sens, de la vérité ou des modes d'existence au cœur de ces travaux, se présente sans doute comme une promesse de réponse ou de consolation. Il n'est pas étonnant que la problématique même du recueil soit de nature métalinguistique, et qu'elle soit thématisée comme telle. La poésie dans QCN se soutient de ces objets spéculatifs, manière de tenir à distance un lyrisme bon marché.
—
Bibliographie
Jacques Bouveresse, 2003, Wittgenstein & les sortilèges du langage, Marseille, Agone.
Gottlieb Frege, 1971, Écrits logiques et philosophiques, Paris, Seuil.
Roman Jakobson, 1963, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit
Saul Kripke 1972, Naming and Necessity, in D. Davidson & G. Harman (éds), Semantics of Natural Language, Dodrecht, Reidedl : 253-355.
Georges Kleiber, 1999 (1990), La sémantique du prototype, Paris, PUF.
Marta Krol, 2025, « Couple sujet-prédicat dans Quelque chose noir, un “biipsisme” impossible ? », L'Information Grammaticale n° 187, pp. 26-31.
Robert Martin, 1983, Pour une logique du sens, Paris, PUF.
Alexius Meinong, 1999 (1904), Théorie de l'objet, Paris, Vrin.
Jean Claude Milner, 1978, De la syntaxe à l'interprétation, Paris, Seuil.
Jacques Roubaud, 2016, Poétique. Remarques, Paris, Seuil.
Jean-Marie Schaeffer, 1999, Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil.
Ludwig Wittgenstein, 1993 (1922), Tractatus logico-philosophicus, trad. G.-G. Granger, Paris, Gallimard.
Ludwig Wittgenstein, 1969 (1961), Tractatus logico-philosophicus suivi de Investigations philosophiques, trad. P. Klossowski, introduction de Bernard Russell, Paris, Gallimard.
—
[1] Bertrand Russell, disciple de Frege, critique la théorie du maître entre autres à l'endroit des descriptions définies. Le Journal d'Alix Cléo Roubaud mentionne son nom : je suppose une sorte de théorie de la description, à la Russell… (p. 158).
[2] La forme stylistique singulière de cet ouvrage, épuré et d’aphoristique, a fait école ; elle est souvent imitée par Alix.
[3] Le modèle sémantique des CNS, « conditions nécessaires et suffisantes », veut que les catégories lexicales soient discrètes, qu'elles se différencient nettement. Le sens du mot, c'est son intension, le faisceau des traits lexicaux nécessaires et suffisants (ex. [quadrupède], [domestique], [miauler], [+pelage]. Il détermine strictement l'extension, ou la référence (tous les chats). Le concept wittgensteinien de l'air de famille donne lieu en linguistique à la sémantique du prototype. Il propose que les membres d'une même catégorie soient unis non pas le partage de tous les traits, mais par une ressemblance famille, une « structuration qui [leur] permet d'être reliés les uns aux autres sans qu'ils aient une propriété en commun qui définisse la catégorie » (Kleiber 1999 : 54). La forme est donc AB, BC, CD, DE.
[4] Cf. Krol (2025).
[5] Cf. Poétique : « S’il est vrai que les propriétés du langage supposent des mondes possibles — s’il est vrai que le langage participe de l’ordre du monde —, chaque état de langue (qu’il soit approprié par la poésie, le roman, ou autres arts du langage) suppose qu’un parmi ces mondes est spécifié, à l’intérieur duquel s’établir — suppose de s’y établir dans la singularité. »
[6] La logique modale a conduit à affiner la notion en linguistique : les modalités aléthiques se rangent parmi les modalités d'énoncé (à côté de la déontique, boulique, épistémique et axiologique), lesquelles se distinguent des modalités d'énonciation (les quatre types de phrase) et de message (mises en relief, passivation, négation, mode impersonnel, phrase à présentatif).
[7] Cf. J.- M. Schaeffer, 1999, Pourquoi la fiction ? ; F. Lavocat, 2010, La théorie littéraire des mondes possibles ; M. Krol, 2017, Pour un modèle linguistique de la fiction.
[8] Cf. Martin (1983 : 36-44)
[9] La théorie des NP a connu d'importants apports ultérieurs qui nuancent la thèse que les NP n'ont pas de sens ; cf. notamment F. Récanati, « La sémantique des noms propres : remarques sur la notion de “désignateur rigide” », Langue française, n° 57, 1983 : « Grammaire et référence », pp. 106-118.
[10] Cf. Krol (2025 : 26).
[11] Schaeffer (1999).
[12] Cf. Krol (2017 : 211-218).
[13] Il s'agit d'un emploi savant de l'adjectif, à distance du sens courant reçu du latin classique idiota « homme ignorant » dont il est l'emprunt. Dans la mort est idiote, l'adjectif renvoie plutôt à l'origine grecque du mot latin, idiôtês « simple particulier ». Surtout, il rejoint en cela le sens du terme linguistique idiotisme qui « désigne une forme, une locution propre à une langue, impossible à traduire dans une autre langue même de structure analogue ; par extension, le mot se dit (XIXe s.) d'une tournure propre à quelqu'un » (Dictionnaire Historique de la Langue Française d'Alain Rey). Autrement dit, la mort est simple au sens d'irréductible ; elle n'est analogue à rien, n'elle est semblable qu'à elle-même ; la langue ne lui connaît donc pas de paraphrase, de définition ou d'autre équivalent, elle échoue à la nommer.
[14] Ce point est nodal dans la conception roubaldienne de la poésie comme art de la mémoire et comme amour de la langue, cf. Puff (2009).
[15] Jakobson (1963 : 43-67).