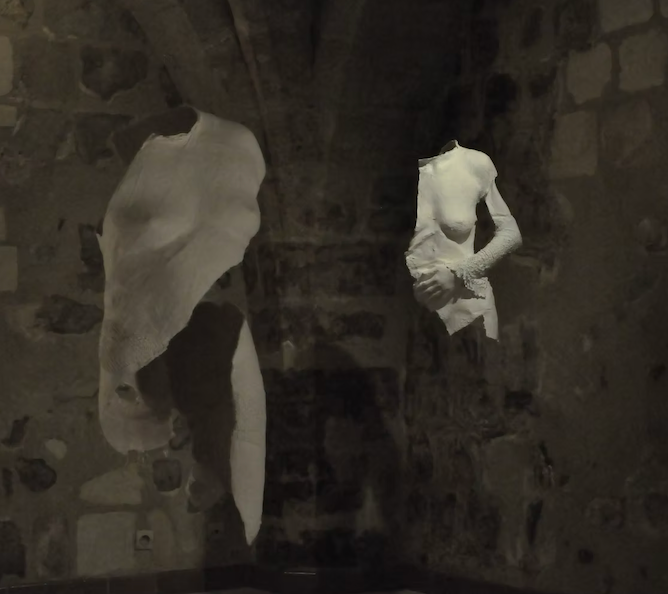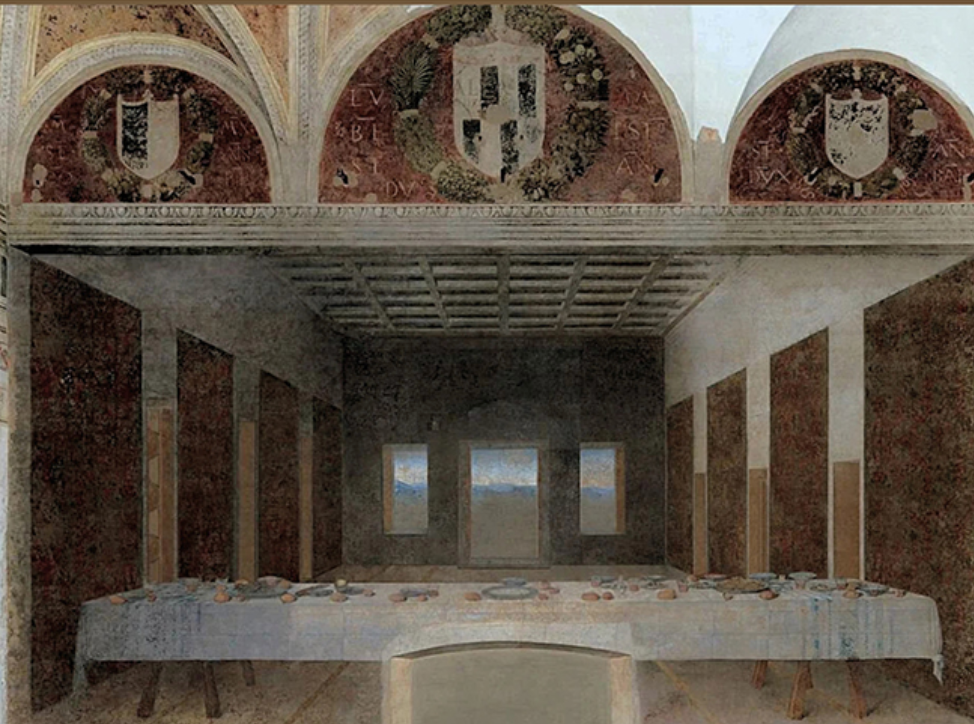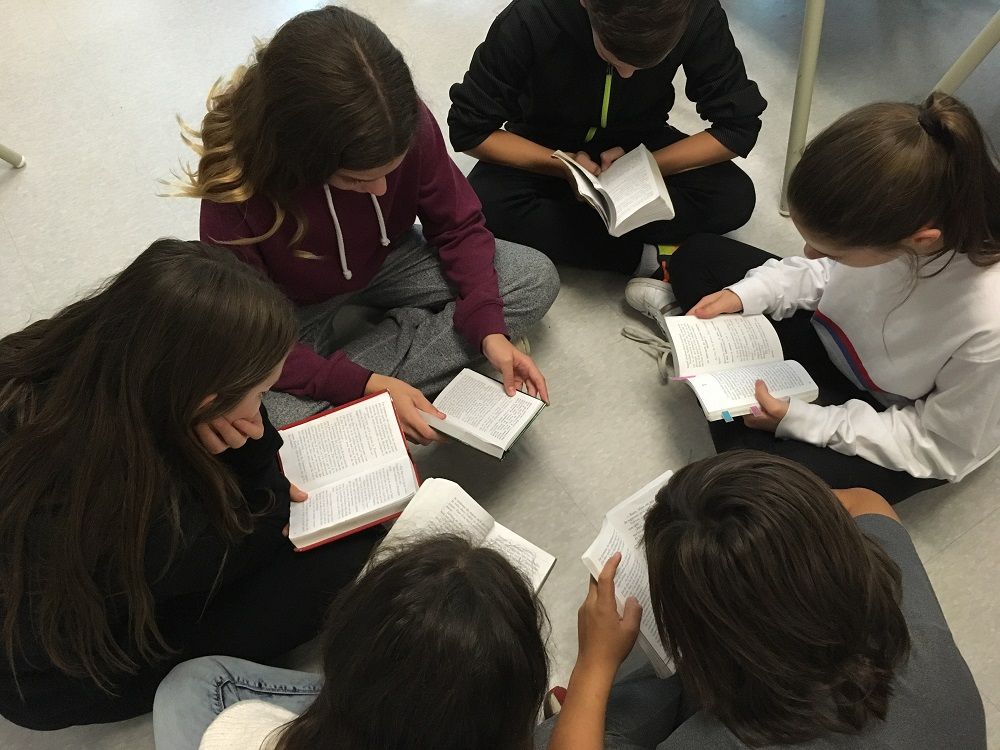Transfuges de classe

Depuis les années 2020, à la faveur de succès de grands noms de la littérature comme celui d’Annie Ernaux, un type spécifique de récit de mobilité sociale, celui du ou de la transfuge de classe, a acquis une visibilité et une stabilité remarquables : le récit de transfuge de classe. À l'initiative de Karine Abiven et Laélia Véron, la revue Contextes, n° 36 | 2025 vient tracer quelques "Perspectives interdisciplinaires sur les récits de transfuge de classe", dans le temps, en privilégiant la longue durée, comme dans l'espace, en s'intéressant à la circulation de ces textes.