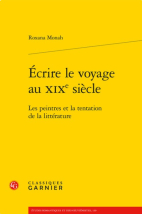
Chronique d’un voyage entre plume et pinceau au XIXe siècle
« Nous dessinâmes ; mais que peuvent les vains efforts d’un crayon devant tant de merveilles ! »
Auguste de Forbin, Souvenirs de la Sicile
« Comment faire sentir par des mots la différence de forme et de couleur de ces pics […] ? »
Théophile Gautier, Les Vacances du lundi. Tableaux de montagne
1La relation des peintres aux écrits viatiques au xixe siècle est un sujet d’un intérêt certain. On connaît l’importance de l’art pictural tout au long du siècle, les tournants et les détours que certains tableaux ont contribué à établir dans l’histoire de la sensibilité artistique — il suffit de penser à La Mort de Sardanapale — ainsi que les riches échanges et influences réciproques entre plume et pinceau au fil des décennies. Les points de croisement entre ces deux arts apparaissent ainsi comme un lieu privilégié pour interroger les imaginaires changeants des pratiques littéraires et picturales, les différences et les continuités quant aux enjeux, aux techniques, aux préoccupations esthétiques et aux points de vue. Cela nous semble d’autant plus vrai dans le cas du récit de voyage, un genre hybride à la croisée des formes, qui, par sa nature même, a « partie liée avec les images », comme le rappelle Roxana Monah dans son ouvrage sur Écrire le voyage au xixe siècle. Les peintres et la tentation de la littérature (p. 256). Peintre ou littérateur, au xixe siècle on part de plus en plus pour « chercher des images1 » : à compter du début du siècle, et progressivement, « le caillou peut avoir plus d’importance que la cathédrale » comme le dit Philippe Antoine2, et l’on voyage pour écrire, pour peindre, ou parfois pour tenter les deux.
Tour d’horizon : les voyages des peintres au xixe siècle
2Dans ce contexte dynamique, l’ouvrage de Roxana Monah s’annonce comme une enquête sur les écrits viatiques des peintres au cours du xixe siècle. Divisé en trois grandes parties, le volume présente d’abord les enjeux liés au fait d’« écrire en peintre » dans l’imaginaire de l’époque ; il aborde ensuite les expériences viatiques des artistes et leurs traces écrites (« Voyager en peintre, écrire le voyage »), pour parvenir, dans la dernière section, aux contours de la figure du peintre-voyageur et aux thèmes récurrents de sa relation avec l’« ailleurs » (« Le peintre aux prises avec le monde »).
3Si la remise en contexte historique sur l’« indétermination vocationnelle » (p. 87) des peintres et leurs revendications d’une prise de parole à l’écrit, remontant au xviiie siècle, aurait pu être condensée, dans la première partie l’autrice montre bien le progressif engouement du xixe siècle pour les profils des peintres. Cela conduit à une « pléthore de biographies » (p. 71) des artistes et à la publication — quasi exclusivement posthume — de volumes de correspondances, particulièrement nombreux dans ce siècle d’éditeurs. On voit bien comment le statut changeant des artistes porte à accueillir avec une considération grandissante la figure du « peintre-qui-écrit » (p. 90), phénomène particulièrement significatif à une époque où l’auctoritas du sujet écrivant contribue à transformer le récit viatique.
4Dans la deuxième partie, une large place est accordée aux dynamiques liées au Prix de Rome, explorées à travers la correspondance — privé ou académique — de peintres pensionnaires tels que Girodet, Papety ou Regnault. De même, l’autrice s’intéresse à la fascination pour l’Orient (fantasmé d’abord et réel ensuite), aux manières dont les peintres s’y rendaient — missions scientifiques, militaires, diplomatiques — et aux retombées de ces voyages dans l’imaginaire et les pratiques artistiques, du mythe héroïque des campagnes napoléoniennes aux dessins de presse nourris par les missions savantes. Dans ce contexte, la catégorisation des formes d’écrits des peintres voyageurs proposée par Monah — lettres, « (micro)récits non autonomes » et récits publiés en revue et en volume — est prise en compte dans le but de « voir comment le voyage […] peut aider à construire une réflexion sur la pratique artistique » (p. 186).
5La dernière section de l’ouvrage s’ouvre sur les autoreprésentations des peintres en « artistes voyageurs », qui se rapprochent des écrivains et se démarquent à la fois de la figure du « savant » et de celle du « touriste ». Le bilan dressé des conditions d’enregistrement du voyage, entre croquis et notes, s’avère d’intérêt : il met en évidence le lien singulier entre le besoin du travail graphique et les voies de la création écrite, et donne à souhaiter une analyse peut-être plus poussée de quelques-uns des cas présentés dans ce tour d’horizon. Le volume se clôt par un approfondissement consacré au « monde comme matière à peindre » : du rôle de l’expérience viatique dans l’affranchissement des modèles et l’hybridation des genres picturaux (la peinture historique, de genre, de paysage) jusqu’à la confrontation avec les lieux visités, entre déception du réel et représentation de certains sujets privilégiés, comme la ville ou les figures féminines dans l’intimité du quotidien.
Écrits et récits, entre composition de la toile et volonté de « faire texte »
6Assurément, il est intéressant de réfléchir à la peinture comme une « activité de la pensée » en lien avec les écrits des artistes-voyageurs. Comme le met en avant Monah (p. 85), à la transition des xviiie et xixe siècles les peintres revendiquent dans leur art la prééminence du travail intellectuel — la composition de la toile — sur l’exécution — relevant, elle, du « métier ». Or, il est significatif d’interroger l’élaboration de l’expérience viatique dans le cas d’un type de voyageur qui, à partir d’un même noyau intellectuel, peut faire jaillir des formes diverses telles que le tableau, le récit, ou encore l’album partagé entre notes et croquis. Certes, il faudrait dès lors distinguer entre les artistes pour qui l’écriture constitue une véritable étape dans la composition de l’œuvre picturale, et ceux pour qui ces formes de création apparaissent comme déliées et coexistantes. C’est le cas par exemple pour Fromentin, avec ses « deux casiers parfaitement distincts3 », ou bien Delacroix, qui, en maturité, comme le rappelle Jan Blanc4 — cité à juste titre par l’autrice (p. 92) — refuse les comparaisons entre peinture et écriture (toujours des « simplifications »), revendiquant tout simplement les « spécificités » des deux.
7Dans ce cadre, le titre de l’ouvrage de Roxana Monah, et son sous-titre surtout, pourrait laisser imaginer une répartition des sujets quelque peu différente, avec une partie prédominante consacrée aux écrits ayant plus explicitement pour visée de « faire récit ». Le volume est en réalité partagé entre les formes variées des écrits des artistes en voyage et l’expérience viatique elle-même, en lien avec les conditions et les démarches de la création picturale. Néanmoins, l’ensemble des données documentaires présentées est d’intérêt : il contribue à restituer l’imaginaire aux multiples facettes dans lequel s’inscrivent certains écrits et certains tableaux, en prenant en considération par ailleurs un nombre significatif d’artistes-voyageurs, des plus commentés — comme Delacroix, Fromentin ou Gauguin — à d’autres sans doute moins souvent cités, comme Charles Yriarte ou Théodore Valerio.
8En particulier, le volume fait émerger, encore une fois, l’épineux problème de l’intention auctoriale en relation avec la définition du genre viatique. Comment, en effet, mettre sur le même plan des écrits n’ayant pas « fait l’objet d’une réelle mise en forme », pour reprendre les termes de Philippe Antoine5, et d’autres intentionnellement conçu comme « littéraires » ? En même temps cependant, on sait qu’il faut se méfier des catégorisations trop nettes, en partie en raison des conditions de réalisation complexes des écrits viatiques (qu’il s’agisse de textes rédigés par des auteurs partis « pour écrire », d’autres produits « sur commission », ou encore d’écrits n’ayant jamais connu d’édition), mais aussi en raison de la nature même de ces récits, qui demeurent liés à l’histoire des chroniques et des relations de voyage des siècles précédents, et qui continuent, même après leur « entrée en littérature6 », à faire de la description un élément non accessoire, à la différence du texte fictionnel7. Du reste, comme l’a souligné Sarga Moussa, la littérarisation du genre viatique au xixe siècle n’implique pas la disparition des formes savantes, ce qui rappelle « l’extrême porosité discursive des Voyages8 ». Qu’on pense seulement au voyage en Égypte, qui attire nombre de peintres au xixe siècle, à la fois sous l’angle de la sensibilité artistique et de la chronique graphique liée aux missions scientifiques.
9Sans aucun doute, le récit viatique apparaît pourtant comme un texte pour quelqu’un, c’est-à-dire une écriture qui prend en compte un lecteur supposé, et qui s’efforce de lui montrer l’« ailleurs ». Dans ce cadre, l’histoire retracée dans le volume de Roxana Monah concernant la publication posthume des correspondances de peintres montre bien à quel point la question est essentielle : sans nier l’intérêt documentaire de ces écrits, dont certains exhibent même la sensibilité d’un « écrivain en puissance » (p. 191), la question de ce que fait un « récit » de voyage se pose, et elle nous semble s’orienter vers une volonté de « faire voir » et, surtout, de « faire texte ». Cela n’empêche pas que la grande attention portée aux profils intellectuels des peintres et à l’écriture de voyage au xixe siècle permette à certains écrits intimes d’artistes d’entrer dans le canon viatique par la voie de la réception, comme dans le cas, cité par l’autrice, des lettres de Horace Vernet préfacées par Sainte-Beuve (p. 193), mais aussi de la correspondance de Poussin, Girodet ou Marilhat.
10À coté de ces écrits, au sein du vaste et hybride pôle lié au désir de « faire texte », il y a place pour des formes très diverses, comme Un Été dans le Sahara de Fromentin d’une part, et, de l’autre, les Aquarelles ethnographiques de Valerio sur la Hongrie et la Bosnie, ou encore le mélange de notations architecturales et d’observations de voyageur dans Les Peintures byzantines et les couvents d’Athos de Papety, où « l’expérience viatique se glisse […] dans des écrits […] dont la visée est plutôt mémorielle ou théorique » (p. 201). D’autres textes en revanche — comme certaines lettres ou notes accompagnées de croquis et « à valeur de memento » (p. 111) — seraient peut-être à explorer sous un angle génétique, en lien avec les voies de la composition picturale, pour revenir à la place de la pratique scripturale dans l’activité intellectuelle du peintre.
Quelles traces d’un regard singulier de peintre-voyageur ?
11Le volume de Roxana Monah fournit d’ailleurs des indications précieuses sur les conditions concrètes d’inscription de l’expérience vécue par les artistes. Celles-ci remettent au premier plan la tension entre observation et notation, déplacement et contemplation lors du voyage — un mouvement tensionnel incarné par l’alternance des rythmes propre à la prose viatique. Cette dynamique semble redoublée dans le cas des peintres voyageurs, dont l’expérience conjugue non seulement regard et prise de notes, mais aussi croquis, recopiage sur le vif ou tête-à-tête avec des modèles.
12Émergent également des stratégies complémentaires d’inscription de l’« ailleurs », comme chez Frédéric Goupil-Fesquet, l’un des premiers peintres à se servir du daguerréotype au lieu du croquis. Pourtant, dans son Voyage en Orient l’artiste fait transparaître l’unicité du pinceau, dans un magnifique passage où, face à la réaction d’une famille à l’« enchantement » du daguerréotype, qui transforme le peintre « en magicien », ce dernier observe : « […] un rayon de soleil tombé sur cette scène vraiment orientale me fait regretter la palette » (cité par l’autrice p. 291-292). Or, si « le voyage impose des modifications profondes des pratiques et des instruments » picturaux, et « le déplacement et l’installation […] commandent deux types de pratiques, l’une en vitesse, l’autre plus posée » (p. 293), il serait fructueux d’approfondir les retombées de ces conditions également dans les écrits des peintres voyageurs, afin de repérer les effets de rythme que le point de vue singulier de l’artiste inscrit dans la textualité.
13Un aspect particulièrement intéressant que Roxana Monah soulève dans son ouvrage est celui de l’autoreprésentation — graphique ou écrite — des peintres en tant qu’artistes-voyageurs. À juste titre, l’autrice détaille les stratégies par lesquelles les artistes du pinceau se distinguent du « savant » et du « touriste », établissant un « nous » commun qui inclut la « petite bande9 » de ceux qui abordent le voyage avec un regard de peintre. Roxana Monah fait remonter les germes de cette sensibilité communautaire au Voyage dans la basse et la haute Égypte de Vivant Denon, voix forte du monde artistique, dont l’ouvrage est rapproché de L’Itinéraire de Chateaubriand par son importance dans l’imaginaire de la subjectivation du récit d’artiste au début du xixe siècle. L’autrice met en lumière, quoique de manière schématique, le jeu des pronoms dans plusieurs écrits viatiques des peintres, révélateur de l’émergence d’une conscience collective d’artistes-voyageurs : du « nous » ambigu d’Auguste Forbin, qui voyage en Orient et en Sicile en qualité de directeur des musées de France, à l’alternance entre le « nous » des expéditions savantes et un « on » restreint au seul contingent artistique, en passant par les formes auto-ironiques du « je » de Paul Lenoir ou Goupil-Fesquet, où l’humour sert à se forger une place parmi les écrivains de voyage. Le thème des autoreprésentations des artistes-voyageurs invite à interroger également les attentes du lectorat des récits de voyage en lien avec le profil du sujet écrivant, et mériterait d’être étudié davantage par une analyse textuelle et stylistique systématiques.
14Dans le cadre des « autoportraits de l’artiste en voyageur » (p. 251), Roxana Monah avance qu’au fil du siècle « on assiste plutôt à une assimilation tacite à la figure de l’écrivain » (p. 272). Cela s’explique sans doute par le besoin du peintre d’affirmer la légitimité de sa prise de parole à l’écrit, l’amenant à faire front commun avec les écrivains, du côté d’une sensibilité esthétique partagée, face à des approches jugées soit trop techniques (le savant), soit trop superficielles (le touriste). À cet égard, l’image évoquée par l’autrice (p. 253) de Charles Yriarte se représentant « sous la tente10 » est particulièrement évocatrice : dessine-t-il ou écrit-il ? « Cette ambiguïté n’est pas dépourvue d’intention ou d’intérêt, car elle rappelle — et scelle — la parenté des deux pratiques, l’écriture et le dessin » (p. 253). Cependant, un enjeu encore plus fécond consisterait à interroger les différences internes au pôle « artistique » des voyageurs. Peut-on identifier des éléments de style propres aux deux figures du narrateur de voyage, écrivain d’un côté, peintre de l’autre ? Quels éléments textuels récurrents font émerger le point de vue singulier du peintre relatant son expérience viatique par le biais de l’écriture ?
15Cette problématique est d’importance, car elle nous ramène, d’une part, aux stratégies textuelles d’autoreprésentation en lien avec les attentes du public supposé : ce mécanisme, dont sont bien conscientes les « grandes plumes » du xixe siècle qui voyagent en écrivains, semble conduire les peintres à valoriser leur posture d’artiste, dans des écrits destinés à un public qu’on suppose désireux de « voir en peintre ». D’autre part, ces questions ouvrent une réflexion sur le rapport particulier à la textualité qu’entretient un scripteur doté d’une sensibilité picturale. Que l’on pense à Delacroix, qui, en 1853, reconnaissait dans l’« unité » l’avantage de la peinture sur l’écriture11. Le fait de présenter simultanément tous les éléments d’une vision, affranchie des contraintes séquentielles du texte, est un pouvoir que plus d’un écrivain a envié aux artistes du pinceau. Comme l’a dit Claude Simon : « Dans la mémoire, tout se situe sur le même plan : le dialogue, l’émotion, la vision coexistent […]. Les peintres ont bien de la chance12 ». Comment, dès lors, les peintres s’approchent-ils de la textualité dans des écrits hantés par les images, y inscrivant un regard d’artiste ? Si ce dernier « a tendance à voir ce qu’il peint plutôt qu’à peindre ce qu’il voit13 », peut-on repérer des schémas picturaux qui orientent à la fois le regard et la description chez les peintres prenant la plume ? Songeons seulement à la « vue de la ville », exemple cité par Roxana Monah : que ce soit dans la description de Tanger par Delacroix ou d’Alger par Fromentin, les textes semblent viser la « distance juste » permettant de cerner la vision, « cette distance que requiert tout tableau afin de montrer sous le meilleur jour » (p. 397).
16Sans aucun doute, on peut retrouver les traces d’un regard singulier dans certains choix lexicaux des peintres voyageurs, qu’il s’agisse de métaphores graphiques ou de références au vocabulaire technique de la peinture ou de la gravure. De ce point de vue, l’aspect peut-être le plus fécond à interroger nous semble le suivant : l’« ailleurs » rencontré en voyage vient-il affiner, déplacer ou remettre en cause les schémas picturaux qui guident le regard du peintre ? Et surtout, que peut exprimer l’écrit, nourri d’un point de vue et d’un lexique d’artiste, qui n’est pas confié à la toile ? Comme le rappelle en effet Fromentin dans la préface de 1874 à la réédition de ses récits, justement citée par Roxana Monah : « Le livre est là, non plus pour répéter l’œuvre du peintre, mais pour exprimer ce qu’elle ne dit pas » (cité p. 372).
*
17Au xixe siècle, écrivains et peintres abordent le voyage avec des sensibilités distinctes, mais font l’expérience de défis et de fascinations souvent similaires. Pensons à l’extrait des Souvenirs de la Sicile de Forbin cité par Roxana Monah dans son ouvrage, que nous avons place en épigraphe de ce compte-rendu à côté de la question posée par Gautier face aux pics dans Les Vacances du lundi : le crayon comme la plume se heurtent à la même aporie en voyage, celle de l’impossibilité à rendre compte de l’inédit, de l’imposant, du beau de l’« ailleurs », par l’image comme par les mots. De même, le problème bien connu de la « bibliothèque » pesant sur l’écrivain-voyageur trouve son équivalent du côté du peintre, confronté à l’héritage des « maîtres ». Leurs œuvres, parfois causes de déception face au réel, deviennent aussi un seuil à franchir : c’est bien souvent par l’épreuve du terrain, face à ces « tableaux vivants » que sont les scènes rencontrées en voyage, que des formes nouvelles s’imposent aux artistes. Les convergences entre le regard du peintre et celui de l’écrivain permettent d’éclairer davantage certains traits propres à l’expérience viatique d’un sujet à la sensibilité esthétique, qui cherche à en « faire récit ».
18Pour ce qui est des peintres, il est frappant de constater à quel point le « drame » du faire-voir se rejoue avec force chez les artistes qui s’essaient à la double opération du pinceau et de la plume et constatent l’insuffisance aussi bien des mots que des « faible[s] croquis14 » face à l’intensité de l’altérité. Dans l’espace textuel souple des Voyages, le réel défie les moyens expressifs, et le cas des peintres voyageurs le manifeste avec acuité. Genre hybride par excellence, où l’écrivain convoque des référents picturaux et où l’artiste prend la plume pour faire « voir » autrement, le récit de voyage se révèle un lieu privilégié de porosité entre arts et écritures. En ce sens, le travail de Roxana Monah encourage des recherches ultérieures, textuelles et intermédiales, sur un sujet d’un grand intérêt, situé à la croisée des formes et des pratiques.

