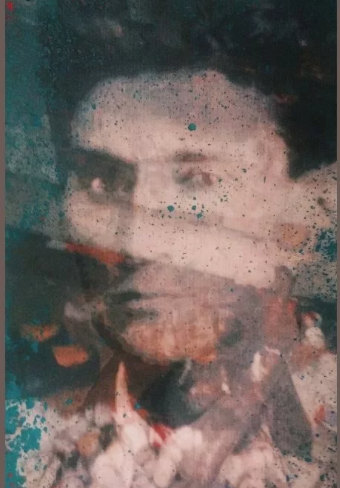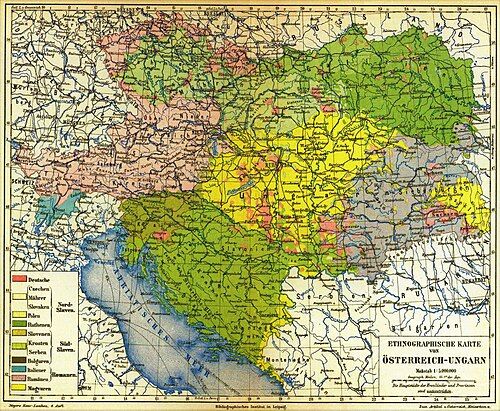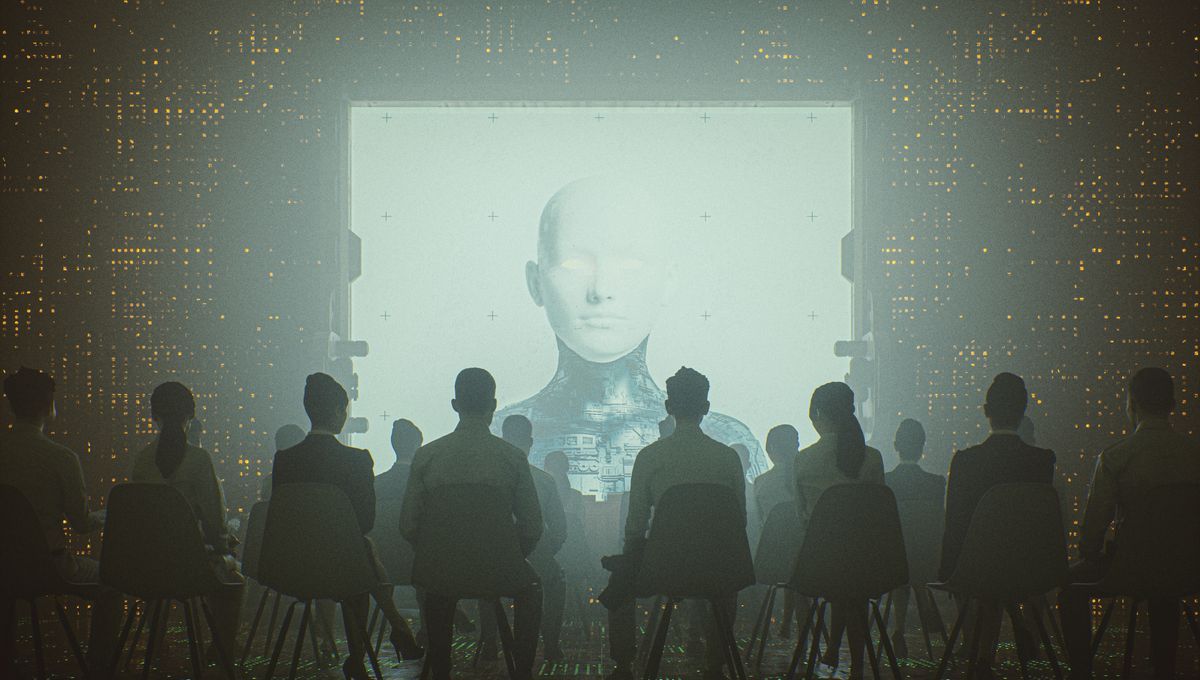À tâtons

Trop souvent réduite à un envers négatif de la clarté et du visible, l’obscurité s’avère remarquablement féconde dans les domaines artistique et littéraire. Le volume À tâtons. L’obscurité dans les arts et la littérature (P.U. Rennes), désormais accessible en ligne sur OpenEdition, explore cette fécondité qui est explorée à partir d’œuvres provenant d’époques diverses, du XVIIIe au XXIe siècle, et dans des aires géographiques et culturelles variées, du Congo à la Suède, en passant par l’Espagne, l’Italie et la France. La perspective adoptée est résolument interdisciplinaire, l’obscurité nourrissant à parts égales la littérature, le théâtre, la philosophie, la musique et les arts visuels. L’obscurité, ou plutôt les obscurités, du flou à la tache d’encre, du clair-obscur à la nuit noire. Ainsi se révèlent sa richesse et sa diversité : elle est non seulement une image ou un symbole (celui d’époques troublées, de traumatismes individuels ou collectifs), mais aussi le lieu d’expériences métaphysiques et esthétiques, de révélations paradoxales, d’égarements et de tâtonnements toujours fructueux.
(Illustr. Joseph le Charpentier, Georges de la Tour, 1642, Musée du Louvre)