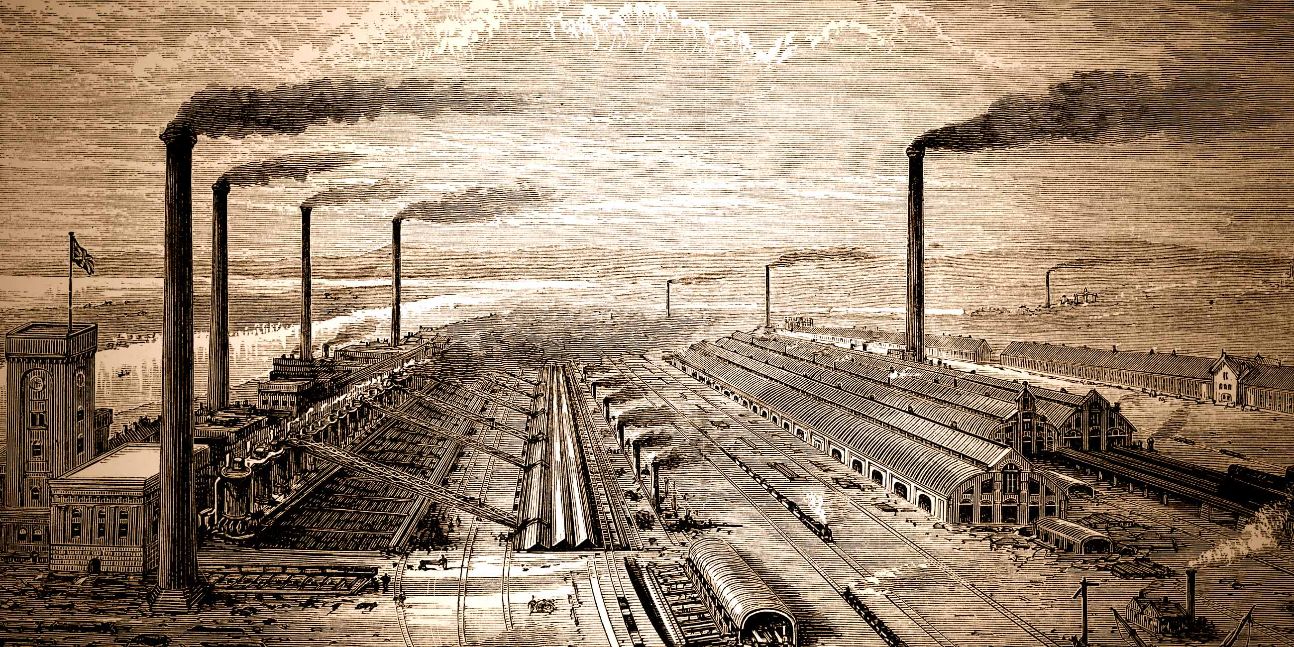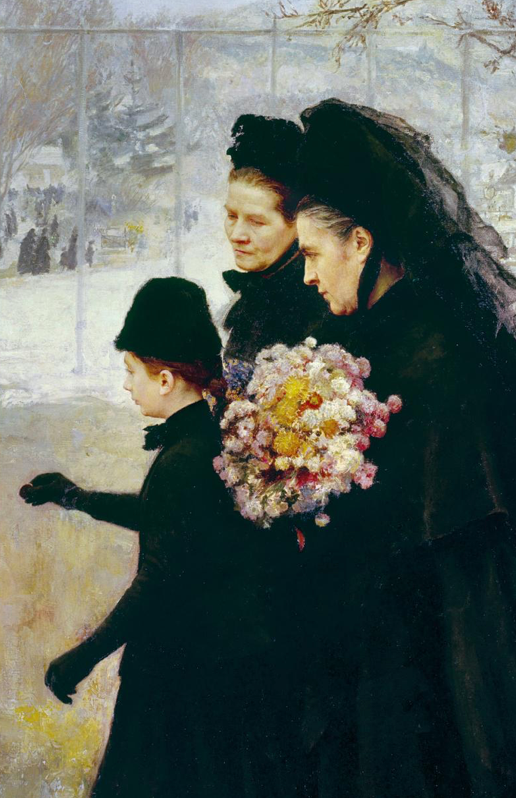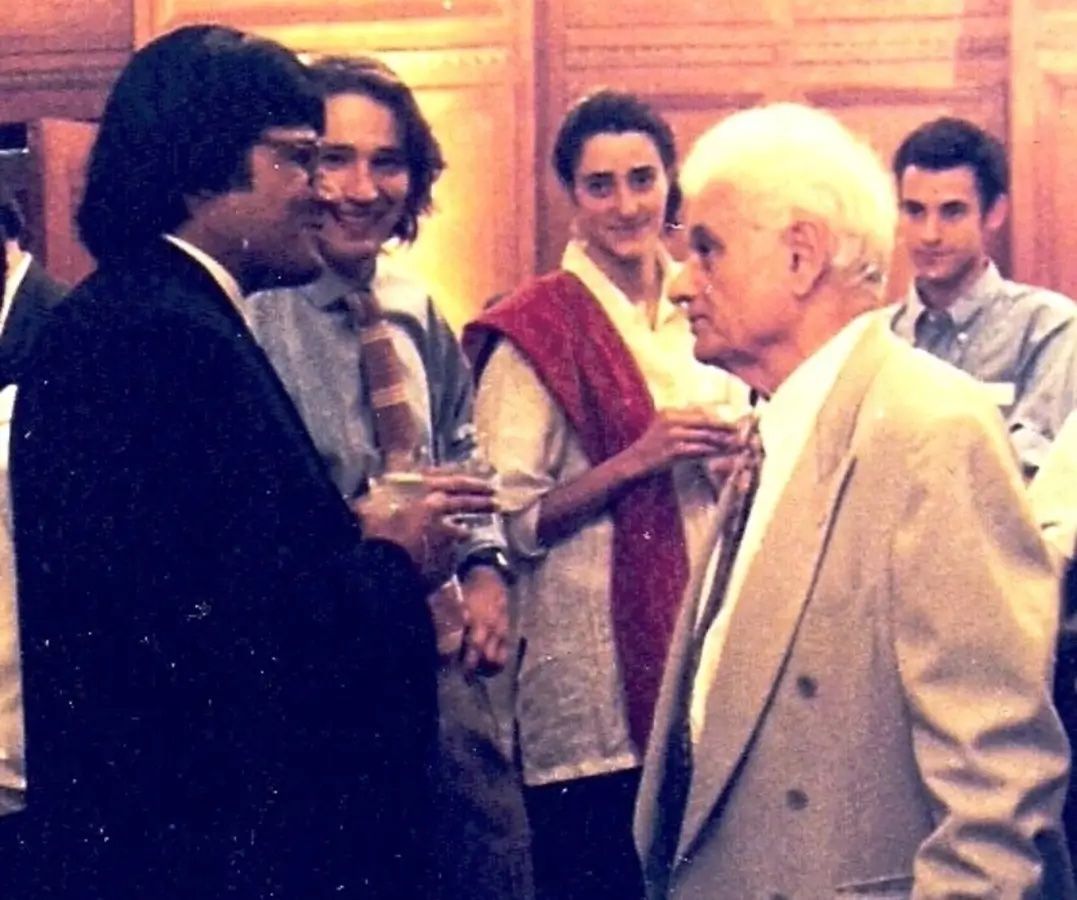La vie des formes conceptuelles

Après La connaissance des autres (Cerf), où il nous entraînait à la rencontre d'une spécialiste des Bantous (J. Roumeguère-Eberhardt), elle-même épouse d’un guerrier masaï ; un pionnier de l’ethnographie européenne (A. Varagnac), en quête de notions conçues dans des régions de France étrangères à la pensée dominante ; ou encore un philosophe (E. Ortigues) qui, après avoir séjourné en Afrique, montre que la logique de la découverte scientifique est indissociable des expériences vécues par les individus et les groupes humains, Frédéric Fruteau de Laclos publie une contre-enquête sur Bruno Latour et l’anthropologie des modernes (Vrin). Faudrait-il vraiment renoncer à la connaissance pour saisir avec les non-modernes les conditions de la "co-naissance" de l’humain et du non-humain ? En retraçant la trajectoire de Latour, aussi bien intellectuelle qu’existentielle, il est possible de lui opposer le contre-modèle d’une théorie de la connaissance qui, pour être ouverte à la diversité moderne et non-moderne des modes de penser, continue d’envisager les savoirs du point de vue de leur cohérence théorique et de leur mise à l’épreuve expérimentale.
(Illustr. Vasily Kandinsky, Skizze für "Komposition II", Musée Guggenheim, NYC)