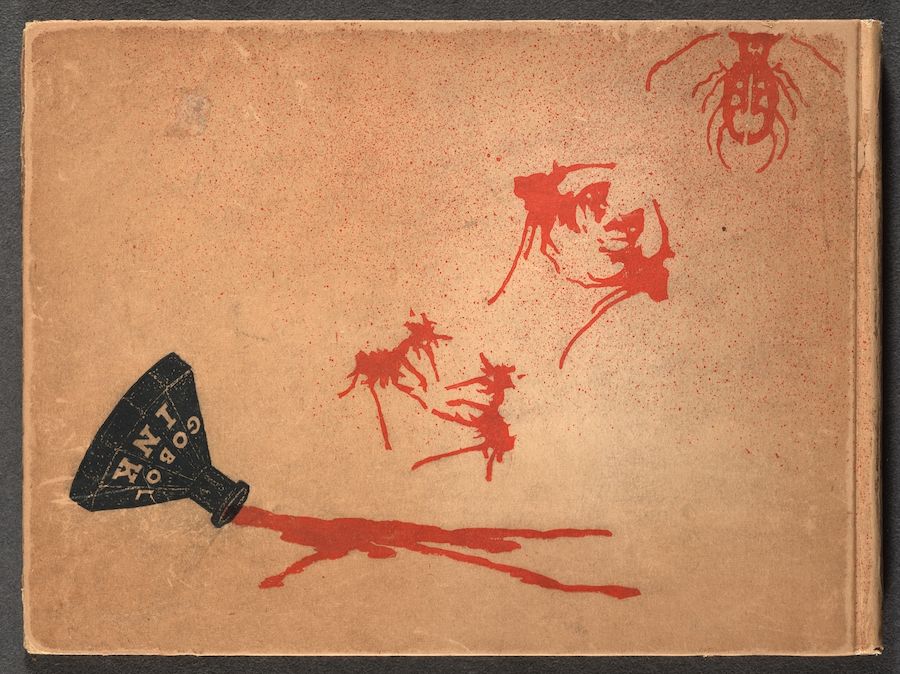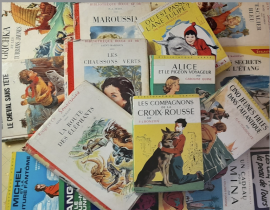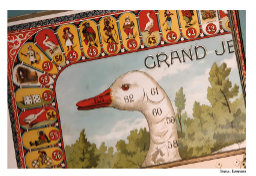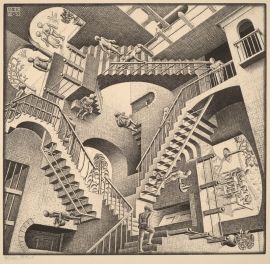"Un morceau flottant d’espace" : les hétérotopies maritimes

Le huis clos des navires, qui réunit pendant un temps limité des hommes — et parfois des femmes — venus d’horizons divers, constitue un espace d’exception, à la fois profondément marqué par les déterminismes sociaux qui ont conduit à ce rassemblement, et partiellement en dehors de la société, situé dans une marge mouvante. Sa représentation ouvre les œuvres littéraires à des enjeux tant sociopolitiques et anthropologiques que métanarratifs, dans la mesure où l’espace-temps du voyage maritime constitue dans les romans ou nouvelles maritimes un motif spéculaire, une mise en abyme du chronotope de la narration. C’est à travers le concept d’hétérotopie, évoqué plus que théorisé par Michel Foucault à la fin des années 1960, qu’une journée d’études tenue à Boulogne-sur-Mer le jeudi 15 juin 2023 a choisi d’étudier la représentation littéraire de l’espace étroit et souvent densément peuplé qui va de la poupe à la proue. La confrontation des différents exemples analysés invite à dresser un panorama des hétérotopies maritimes des littératures française et britannique des XIXe et XXe siècles, tout en apportant une pierre à l’édifice déjà considérable des réflexions suscitées par le concept foucaldien. Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent aujourdh'ui les actes réunis par Julie Gay et Marie-Agathe Tilliette.