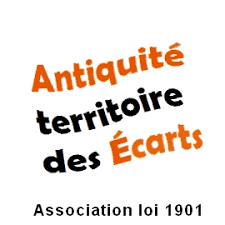
Séminaire d'"Antiquité, territoire des écarts" : Penser et pratiquer le comparatisme après Marcel Detienne (Université Paris Cité)
Penser et pratiquer le comparatisme après Marcel Detienne
« Antiquité, territoire des écarts »
Association ATE– Université Paris Cité
Programme initié par Claude Calame, Cassandre Martigny, Maxime Pierre, Marie Saint Martin
Université Paris Cité, site des Grands Moulins, rue Thomas Mann 75013 Paris
Salle 682 C (Grands Moulins, 6e étage), de 18h à 20h
À partir de l’ouvrage dans lequel Marcel Detienne nous suggérait de « comparer l’incomparable », le nouveau séminaire ATE propose des interrogations épistémologiques et critiques sur les approches comparatistes[1]. Le travail de Detienne sur le comparatisme en anthropologie culturelle et sociale et singulièrement en anthropologie historique fonde une méthode à laquelle les études comparatistes reviennent avec régularité. La comparaison est indispensable en particulier aux historiennes et historiens de l’Antiquité gréco-romaine, dans la mesure où ils se trouvent face à des textes et des images dont le contexte ethnographique (pratiques rituelles, religieuses, politiques) manque : la comparaison leur permet de restituer à l’objet poétique ou iconique l’épaisseur d’une pragmatique.
Vingt-cinq ans plus tard, que sont devenues les propositions de Detienne ? Quelle pertinence et quelles éventuelles limites montrent-elle dans le champ des études de l’Antiquité ? Comment ont-elles été reçues dans le domaine des études littéraires qui intègrent l’Antiquité comme objet ? Et finalement que faire du projet et de la méthode comparatiste aujourd’hui ? L’élaboration d’un « comparatisme différentiel » qui s’attache à distinguer les époques et les lieux, développé notamment par Ute Heidmann en littérature comparée et également défendu par Luciano Canfora pour penser le lien entre « nous et les anciens » en dehors de la recherche d’une prétendue « identité », ou encore d’un comparatisme de l’écart (Florence Dupont), confrontant l’Antiquité gréco-latine à d’autres cultures pour déconstruire les évidences de la pensée européenne, suffit-elle à conjurer dans la pratique l’universalisme que suppose encore trop souvent le geste comparatiste ? Près de dix ans après la parution des actes d’un congrès proclamant « le comparatisme comme approche critique[2] », et notamment du premier volume « Affronter l’Ancien », que sont devenues les pistes ouvertes par ces six volumes représentant un répertoire pour le comparatisme, donnant à lire la variété, mais aussi parfois le bricolage, qui caractérisent les approches comparatistes ? À travers quelles méthodologies les « partages de l’Antiquité[3] » sont-ils pensés aujourd’hui ?
[1] Marcel Detienne, Comparer l’incomparable., Paris, Éditions du Seuil, coll. Points, 2009.
[2]Anne Tomiche (dir.), Le Comparatisme comme approche critique, Paris, Classiques Garnier, 2017.
[3]Véronique Gély, « Partages de l’Antiquité. Les Classiques grecs et latins et la littérature mondiale », Revue de littérature comparée, vol. 344, n° 4, 2012, p. 387–395.
Programme du séminaire :
4 novembre 2025 : Claude Calame (EHESS), « Anthropologie historique de l’Antiquité gréco-romaine : les défis de l’exigence comparative »
2 décembre 2025 : Florence Dupont (Université Paris Cité), « Quand les Romains et les Grecs se comparaient les uns les autres, construisaient-ils des comparables ? »
20 janvier 2026 : Ute Heidmann (Université de Lausanne), « Concepts et plans d’analyse pour un comparatisme différentiel, relationnel et non-universalisant »
10 février 2026 : Cléo Carastro (EHESS), « Expériences collectives de la dissonance : repenser l'exercice comparatiste après Marcel Detienne, Jean-Louis Durand et Michel Cartry »
10 mars 2026 : Alessandro Buccheri (ANHIMA), intitulé à venir
14 avril 2026 : Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre), « Penser le théâtre français de la Renaissance depuis l'anthropologie du théâtre grec »
Mai 2026 : Françoise Lavocat (Université Sorbonne Nouvelle), jour et intitulé à venir