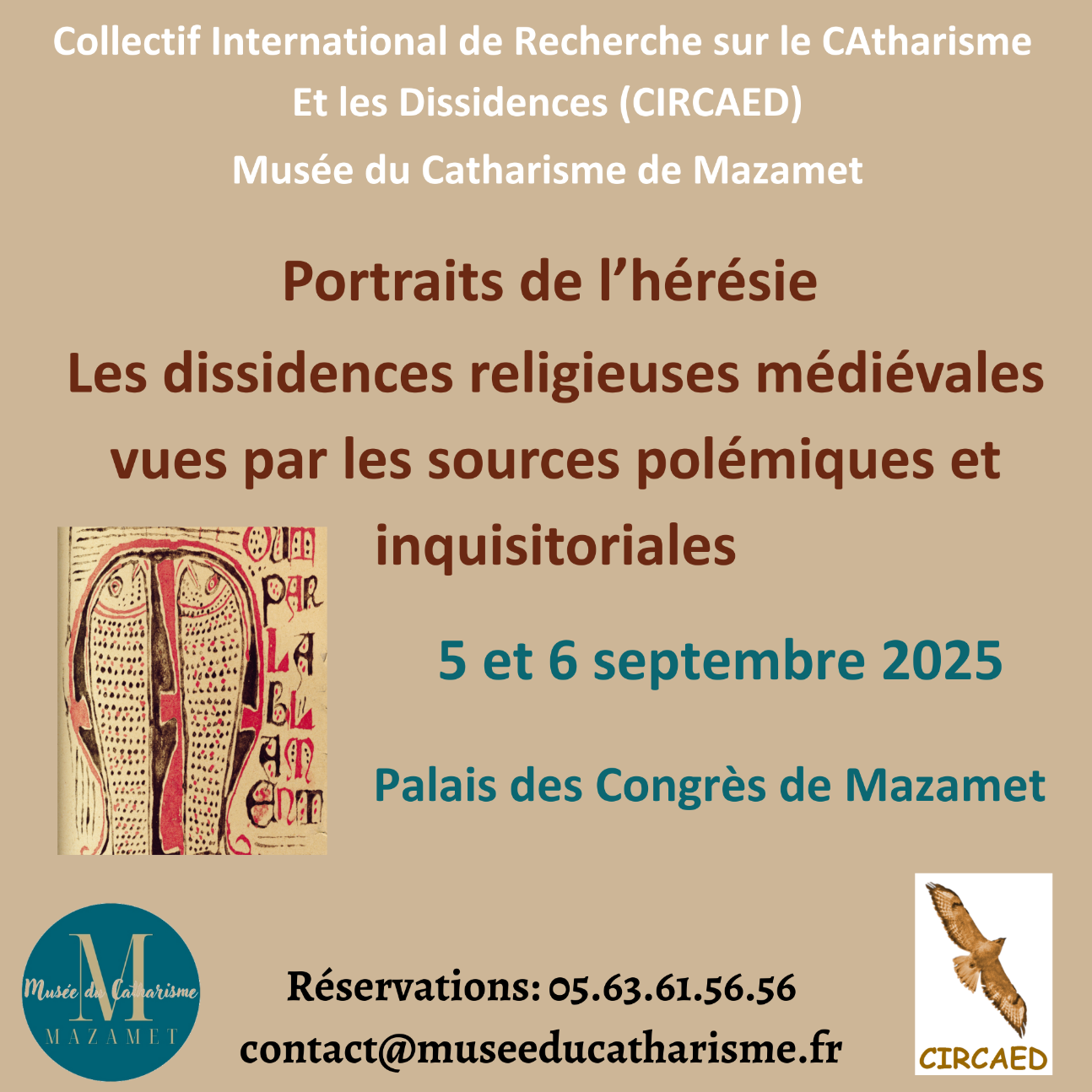
Portraits de l'hérésie. Les dissidences religieuses médiévales vues par les sources polémiques et inquisitoriales (Mazamet, France)
Les représentations de l’hérésie dans les textes polémiques et inquisitoriaux médiévaux sont protéiformes. Elles s’étendent des emprunts textuels faits aux polémiques anti-hérétiques anciennes à des descriptions vivaces des croyances et des pratiques des groupes dissidents par leurs observateurs catholiques jusqu’aux documents inquisitoriaux. Loin de parler d’une voix unifiée ou de représenter un seul programme de controverse, la littérature catholique médiévale sur l’hérésie présente une immense variation interne, appelant notre attention sur la nécessité d’étudier les textes individuels.
Ce colloque international organisé par le Collectif International de recherche sur le catharisme et les dissidences (CIRCAED), avec le soutien du Musée du Catharisme de Mazamet et de Dissident Networks Project (DISSINET, https://dissinet.cz), rassemble des chercheurs de différents pays et positions dans les débats autour des images et réalités de l’hérésie médiévale.
Vendredi 5 septembre
14h30: Robert L. J. Shaw, The Heresy Trial of Bernard-Oth of Niort and His Family, 1234/5: Computing Discourses of Guilt at the Dawn of the Languedocian Inquisition.
En 1234 (ou peut-être en 1235), au moins 114 témoins furent appelés à fournir des preuves concernant les liens de Bernard-Oth de Niort, de sa mère et de trois de ses frères avec les heretici de la région du Lauragais. Le procès-verbal qui en résulta constitue le plus ancien registre conservé d’un procès médiéval pour hérésie. Pourtant, il reste aussi l’un des moins étudiés, sans doute en raison de son apparence assez inhabituelle. Contrairement à la majorité des registres d’inquisition languedociens ultérieurs, la procédure de 1234/1235 représente une collecte ciblée de témoignages contre un ensemble de suspects préalablement définis, avec des inquisiteurs spécialement nommés à cet effet, et les accusations semblent davantage porter sur la réputation que sur les faits. Le processus, de plus, porte la marque d’influences politiques, au premier rang desquelles celle de Pierre Amiel, archevêque de Narbonne.
Cet article montre comment l’analyse computationnelle peut offrir une perspective nouvelle et indispensable, fondée sur la critique des sources, sur ce texte beaucoup trop négligé. Modéliser l’ensemble du texte comme une série d’énoncés de données syntaxico-sémantiques — selon l’approche Computer-Assisted Semantic Text Modelling (CASTEMO) — fournit une base pour éclairer l’une des toutes premières interactions entre l’inquisition et la société languedocienne.
Le processus même de capture des données se révèle être une forme facilitatrice de lecture rapprochée : la reconstruction systématique de chaque proposition du texte sous la forme d’un énoncé de données a mis en lumière des schémas difficiles à percevoir autrement dans le discours textuel et son contexte (c’est-à-dire les réponses des témoins et la
manière dont ces témoins sont caractérisés dans le texte). L’analyse ultérieure des relations entre ces éléments permet de dévoiler les conditions de production du texte et même de restituer l’histoire humaine qui se cache derrière ce procès-verbal.
15h30: Marjolaine Raguin, Des sources littéraires médiévales en langue d’oc qui disent les hérétiques et leur hérésie.
17h: Katalin Suba, Formula and Memory: Consolament Accounts in the FFF Register and the Limits of Inquisitorial Standardization
Le soi-disant Registre FFF (Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds Doat, vol. 22–24), qui contient en grande partie les interrogatoires menés par l’inquisiteur Ferrier et ses collègues en 1243–1244, est particulièrement riche en descriptions de rituels cathares. À première vue, ces récits paraissent stéréotypés, suggérant l’utilisation d’un schéma standardisé. Cependant, un examen attentif des récits de consolament révèle des divergences subtiles mais significatives. Ces variations concernent non seulement des détails mineurs — ajouts, omissions ou déplacements d’accent — mais aussi la présence, l’absence et l’ordre des éléments constitutifs de base du rituel.
On a observé que les inquisiteurs ont probablement utilisé un questionnaire calqué de près sur le texte que nous connaissons sous le titre Forma qualiter heretici hereticant suos, une description anonyme du consolament datant du milieu du XIIIᵉ siècle, puisque l’on constate de fortes parentés textuelles entre ce document et les témoignages du Registre FFF. Pourtant, des questions essentielles subsistent : dans quelle mesure les inquisiteurs se conformaient-ils strictement à ce modèle, et quelle marge laissaient-ils aux témoins pour enrichir ces descriptions stéréotypées par des souvenirs personnels ? La diversité constatée dans ces récits peut-elle être corrélée de façon significative aux contextes variables des initiations elles-mêmes ? L’article vise également à éclairer ce qui constituait, du point de vue des inquisiteurs, un récit du rituel jugé suffisamment complet ou crédible.
Samedi 6 septembre
10h: Katia Riccardo, Dissident Affiliation, Residence, and Occupation in the Inquisition Register of Bologna, 1291– 1310.
Cet article explore la relation entre dissidence, occupation, résidence et conditions socio-économiques telle qu’elle apparaît dans le registre d’inquisition de Bologne (1291–1310). Il examine si la composition professionnelle des suspects d’hérésie reflétait les tendances plus larges du tissu social urbain de Bologne, et si les profils de richesse des paroisses et des groupes professionnels influençaient l’implication dans la dissidence. Alors que l’historiographie antérieure — en Italie comme en Languedoc — a mis en avant les métiers artisanaux, en particulier les travailleurs du textile et du cuir, comme particulièrement enclins au catharisme, cette analyse remet en question cette hypothèse dans le contexte bolonais. En comparant la proportion des groupes professionnels et des paroisses parmi les suspects d’hérésie avec leur proportion dans la population générale (en utilisant l’estimo de 1296– 1297, c’est-à-dire la déclaration fiscale, comme indicateur), l’analyse ne révèle aucune surreprésentation significative de ces groupes professionnels parmi les suspects. Les résultats mettent plutôt en évidence le rôle du zonage professionnel et des dynamiques de voisinage dans la structuration des formes de dissidence religieuse, suggérant que l’hérésie se propageait par les liens communautaires plutôt que d’être liée à des classes économiques ou des professions spécifiques.
11h: David Zbíral, Actions des femmes et des hommes dans les registres d’inquisition : Approche quantitative.
La discussion sur l’importance des femmes et des hommes dans les dissidences religieuses de l’Europe médiévale, ainsi que sur leurs rôles potentiellement différenciés, est restée en suspens. Cette communication propose une réponse d’un point de vue quantitatif, en s’appuyant sur divers registres médiévaux issus des inquisitions contre l’hérésie. À partir d’un corpus en texte intégral représentant environ 2 millions de mots, constitué d’éditions numérisées et nettoyées manuellement de vingt-cinq registres d’inquisition couvrant la période des années 1230 aux années 1520, de l’Italie à l’Angleterre, la communication examine la fréquence d’usage des verbes pour décrire les actions des femmes, en comparaison avec ceux employés pour les hommes, afin de déterminer si certaines catégories d’actions rapportées étaient plus typiques des hommes que des femmes. Elle tentera ainsi d’apporter un éclairage nouveau à la question historiographique classique de l’importance et des rôles spécifiques éventuels des femmes (et des hommes) dans la vie quotidienne des cultures religieuses dissidentes du Moyen Âge. La communication met les résultats en relation avec les
biais de genre potentiels des inquisiteurs.
14h30: Jan Mikołaj Wolski, Best Sources of Knowledge on Heresies: From Oral Investigation to Library Querying. A Few Examples from the Slavo-Byzantine World.
D’où les chasseurs d’hérétiques tiraient-ils leur connaissance des mouvements hérétiques ? La réponse est à la fois évidente et simple : cela dépendait de la situation. Lorsque le but d’une institution ecclésiastique était de réprimer les activités de clercs indignes, ces derniers, ainsi que des témoins, étaient interrogés, et un verdict était rendu sur cette base. Lorsque, par le biais de sermons, on cherchait à affermir les fidèles et à prémunir leurs esprits contre l’enseignement des hérétiques, on invoquait alors l’autorité d’auteurs reconnus. La présentation citera quelques exemples d’application de cette règle, ainsi que de ses transgressions.
15h30: Emmanuel Bain, Autour du manuscrit Florence, BNC, Conv. Soppr. J. II. 44 : Constructions de l’hérésie en Italie du Nord au XIIIe siècle.
Le point de départ de cette communication est une interrogation sur la signification de l’expression « inventer l’hérésie ». Un des défauts du livre de Monique Zerner est qu’elle ne précisait pas vraiment ce qu’elle entendait par là, si bien que beaucoup ont pensé qu’elle soutenait qu’il n’y avait jamais eu d’hérétiques, ce qui n’était pas sa position. Même si, dans le titre, j’ai préféré un plus neutre « constructions de l’hérésie », le but sera de s’interroger sur les processus d’ « invention » de l’hérésie. Pour cela, je partirai du manuscrit Florence, BNC, Conv. Soppr. J. II. 44 parce qu’il contient trois textes qui émanent directement des hérétiques (le Livre des deux principes, le « rituel », et le De persecutionibus) et je comparerai cela avec ce que disent les nombreux traités antihérétiques contemporains afin de montrer comment ceux-ci
déforment les faits et modèlent l’hérésie.
17h: František Novotný, Discernment between Heresy and Orgiastic Conventicles in Stephen of Bourbon’s Tractatus de diversis materiis praedicabilibus.
Les récits concernant des conventicules nocturnes dépravés de hérétiques, incluant des orgies sexuelles et des hommages rendus au Diable, constituaient une part intégrante du savoir hérésiologique des XIIIe et XIVe siècles. Pourtant, de tels conventicules étaient rarement mentionnés dans les dossiers d’enquêtes réelles. Ce décalage a été relevé par les chercheurs, certains d’entre eux, notamment Peter Biller, ayant souligné l’attitude sceptique de certains inquisiteurs pontificaux à l’égard de telles accusations.
Cette communication examine la manière dont le prédicateur et inquisiteur dominicain du milieu du XIIIe siècle, Étienne de Bourbon, non seulement réfuta les récits de conventicules orgiaques, mais alla jusqu’à les dissocier du thème de l’hérésie dans son œuvre majeure, le Tractatus de diversis materiis praedicabilibus. Elle soutient qu’Étienne n’était pas guidé par un scepticisme « éclairé », mais plutôt par une réflexion systématique sur les périls qui menaçaient l’orthodoxie des laïcs, sur la manière de les catégoriser et sur les moyens par lesquels ils devaient être combattus.