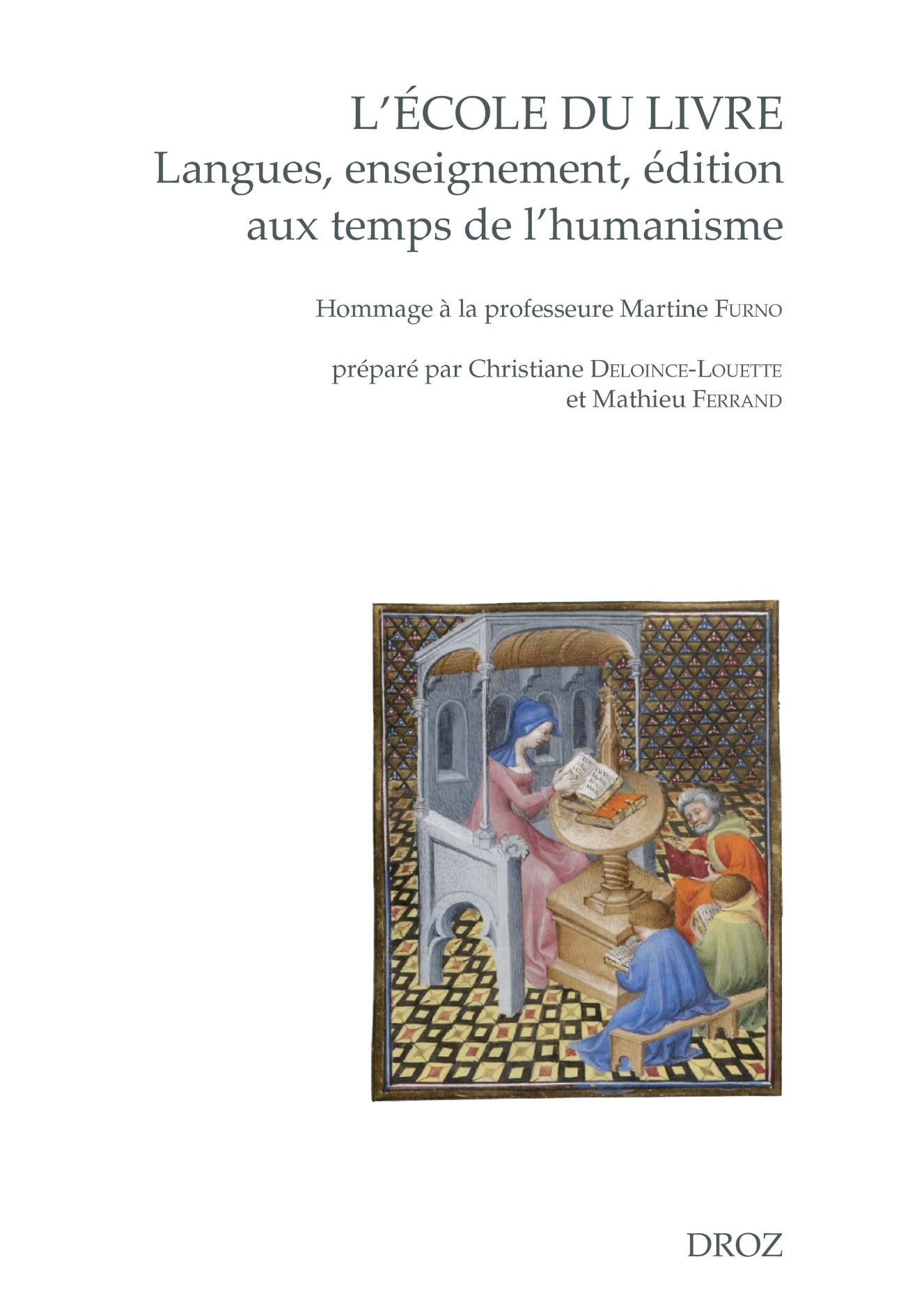
Christiane Deloince-Louette et Mathieu Ferrand, L'école du livre. Langues, enseignement, édition aux temps de l'humanisme
Le latin de la Renaissance est aujourd’hui un objet d’étude bien établi. Qu’il s’agisse d'œuvres littéraires ou scientifiques, de manuels ou de commentaires à vocation pédagogique, le livre en latin intéresse l’Europe entière, juste rétribution pour la place immense qu’il a occupée durant trois siècles. Martine Furno est de celles et ceux qui ont permis de l'étudier en tant que tel, dans les cabinets de travail, dans les écoles et les ateliers d'imprimerie, chez les litterati et les mechanici. Les dix-huit articles ici réunis témoignent de la cohérence de son parcours intellectuel et de la fertilité de ses intuitions. En rapprochant sans cesse seiziémistes et latinistes, bibliothécaires et historiens, Martine Furno a su retrouver les collaborations multidisciplinaires de la Renaissance. Cet ouvrage lui rend hommage, comme à celle qui s'est mise, et nous a mis, « à l'école du livre ».
Table des matières
Max Engammare, Lettre à Martine
Christiane DELOINCE-LOUETTE et Mathieu FERRAND, Avant-propos
Bibliographie de Martine Furno
Première partie. Les langues et leurs usages
Christian Nicolas, Prononciation et élision : que sont la synalèphe et l’ecthlipsis ?
Philippe Selosse, Qui écrit, qui lit et dans quelle langue ? La nomenclature « vulgaire » des plantes dans les années 1530-1540, une notion complexe et opaque
Sabine Lardon, Art et lexique de la vénerie au XVIe siècle. Du De Philologia de Guillaume Budé (1532) au Dictionaire Francoislatin de Robert Estienne (1549), défense de la langue latine et illustration de la langue française
Paul Gaillardon et Smaranda Marculescu, « Si sacra licet conferre profanis » : les références bibliques dans les Adages d’Érasme
Christiane Deloince-Louette, Térence entre deux langues : traduire avec Charles Estienne
Julie Sorba, La magie des livres. Des motifs phraséologiques pour tracer la filiation entre romans d’anticipation et romans de science-fiction ?
Deuxième partie. L’école et ses maîtres
Malika Bastin-Hammou, Lire, écrire, parler le grec ancien à la Renaissance. Les Dialogues grecs d’Henri Estienne
Nathaël Istasse, La Phraseologia Aristophanica (1620) du père Michael Craesbeeck. Un témoin inédit de l’humanisme jésuite dans les anciens Pays-Bas méridionaux (KBR, Ms. 11382)
Tristan Vigliano, Pourquoi Sergius s’intitule-t-il Sergius ?
Sylvie Laigneau-Fontaine, Les Tabellae elementariae pueris ingenuis pernecessariae de Nicolas Bourbon. Un étrange ouvrage de pédagogie renaissante
Virginie Leroux, Un plaidoyer pour l’éducation des femmes. La déclamation pro libertate feminarum d’Erycius Puteanus (1604)
Lucie Claire, À l’école de Muret. Un parcours à travers la fortune scolaire des œuvres de Marc-Antoine Muret (XVIe-XIXe siècles)
Troisième partie. Le livre et ses éditeurs
Malcolm Walsby, Les leçons de la matérialité des livres d’étudiants au milieu du XVIe siècle
Anne Raffarin, Les manuscrits épigraphiques illustrés. Sources et modèles des éditions de livres d’antiquités romaines à la Renaissance ?
Frédéric et Marie-Madeleine Saby, Charles Estienne, Jacques Kerver et les Figures et portraicts des parties du corps humain (1575)
Christine Bénévent, Le Sommaire des livres du Vieil et du Nouveau Testament de Robert I Estienne
Pascale Mounier, Eurial et Lucresse dans l’atelier de Denis de Harsy
Raphaële Mouren, Une édition inattendue ? Un Denys d’Halicarnasse florentin chez Jean de Tournes, 1581
Michel Jourde, « Mes aïeux étaient imprimeurs ». Fabriques de la mémoire familiale des De Tournes (Lyon et Genève, XVIe-XIXe siècles)
Bibliographie
Index nominum