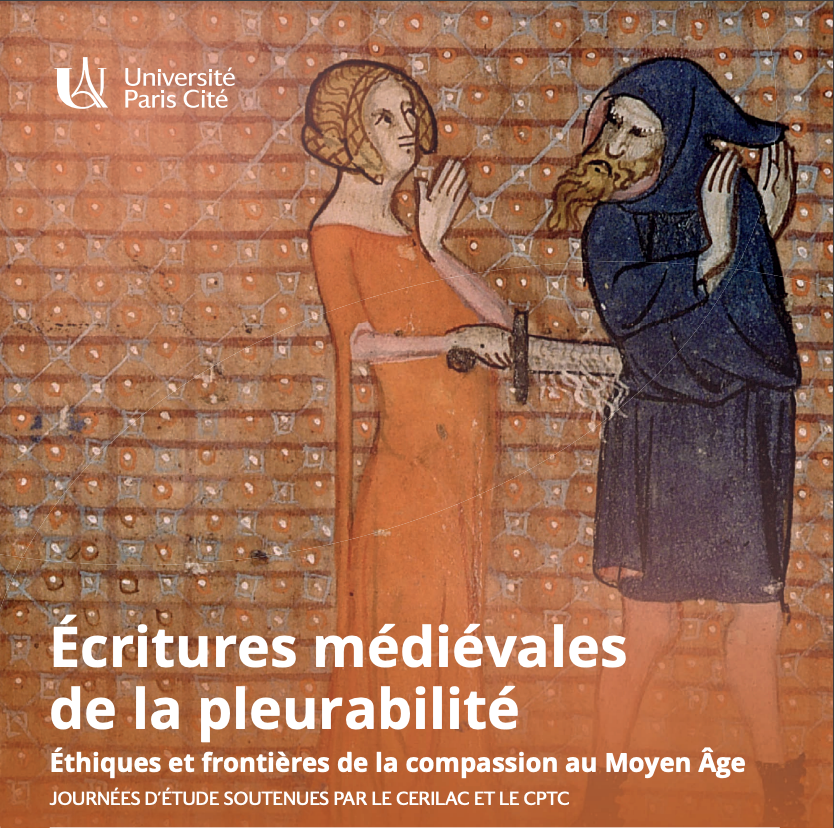
Écritures médiévales de la pleurabilité. Ethiques et frontières de la compassion au Moyen Âge (Univ. Paris Cité)
Écritures médiévales de la pleurabilité.
Éthiques et frontières de la compassion au Moyen Âge
Journées d’études internationales
Université Paris Cité, 15-16 octobre 2025
Si l’on en croit les textes médiévaux, la tristesse et la douleur ne sont pas nécessairement des émotions contagieuses. Les pleurs d’un personnage peuvent certes y inspirer la compassion de ceux devant qui ils sont versés. Mais les infortunes d’autrui peuvent aussi susciter des affects variés chez celles et ceux qui les observent, en une polyphonie des points de vue que les fictions confrontent parfois au sein d’un même texte : la paralysie soudaine du héros éponyme de Renaut de Montauban provoque la pitié de certains mais la raillerie des autres ; la mort des fils de Soliman dans la Chanson d’Antioche entraîne l’hilarité des croisés contre le désespoir du père ; dans Sire Hain et dame Anieuse, les blessures d’Anieuse lors du combat qui l’oppose à son mari affligent sa voisine Aupais sans émouvoir le voisin Simon.
C’est cette conscience du caractère fondamentalement subjectif et variable de la compassion que ces journées d’études se proposent d’interroger. Si le champ bien établi de l’histoire des émotions a déjà longuement exploré, à travers le concept de communautés émotionnelles, la façon dont les normes sociales d’un groupe déterminent qui pleure et comment, ces journées entendent s’intéresser aux conditions, explicites et implicites, délimitant dans les textes médiévaux qui et ce qui peut être pleuré, autrement dit, ce qui est ou non “pleurable”.
En employant cet adjectif, emprunté à la notion de pleurabilité (grievability) forgée par Judith Butler pour penser l’inégale reconnaissance de la vulnérabilité des individus dans les modèles sociaux contemporains, cet appel voudrait proposer une rencontre entre le champ de l’histoire des émotions et celui de la philosophie politique auquel les travaux de Judith Butler se rattachent : alors que les études sur la pitié, l’empathie et la compassion médiévales se sont beaucoup intéressées aux aspects religieux et dévotionnels voire érotiques de la sensibilité aux malheurs d’autrui, notre approche entend se concentrer sur les conditions sociales et politiques de l’émergence et de l’expression de la pitié. Si, comme l’ont montré les travaux de Butler, la capacité d’un sujet à penser les souffrances d’un groupe est étroitement liée à la visibilisation de ce groupe autant qu’à la reconnaissance sociale dont il bénéficie, des recherches récentes témoignent de la conscience que certains auteurs médiévaux peuvent avoir de ces déterminants sociaux.
Fortes de ce constat, ces journées d’études se proposent d’analyser la façon dont les écrits et les représentations médiévales formulent et théorisent, mais aussi interrogent voire déplacent les conditions sociales et littéraires, politiques et poétiques, qui favorisent ou au contraire interdisent l’éveil et l’expression de la compassion à l’égard des individus ou de groupes qui pourraient être définis comme “à la marge” de la norme sociétale. Au-delà de cet examen d’une possible redéfinition des frontières du pleurable au Moyen Âge selon les contexte, ces rencontres seront l’occasion de réfléchir aux mécanismes éthiques et esthétiques ainsi qu’aux dispositifs d’écriture qui permettent la reconnaissance de certaines souffrances, ou au contraire favorisent la minimisation ou l’invisibilisation de certaines peines.
En se situant dans une perspective interdisciplinaire cherchant à croiser les domaines de la littérature, de l’histoire et de la philosophie, il s’agira en fin de compte d’explorer les réponses que les textes médiévaux apportent à la question formulée par Judith Butler pour nos temps d’aujourd’hui : “Quels sont les corps qui comptent, et pourquoi ?”.