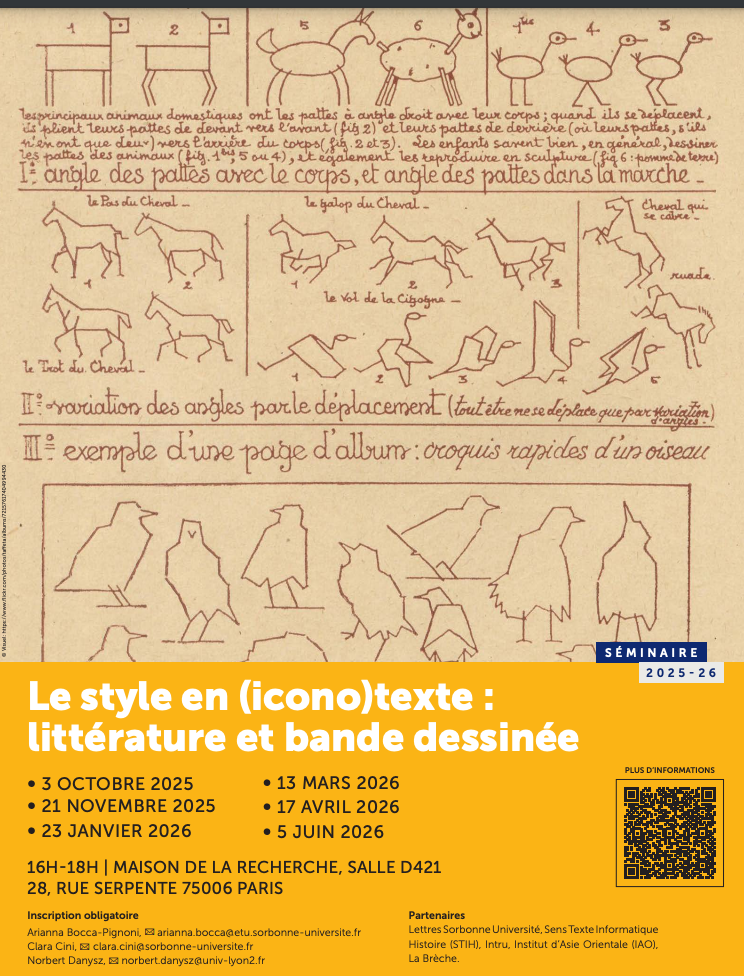
Un style XIXe ? Séminaire Le style en (icono)texte avec Vianney Dubuc et Anastasia Scepi (Sorbonne Université)
Première séance du séminaire de recherche "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée"
L'argumentaire général du séminaire est disponible ici.
3 octobre - 16h-18h
Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente (Paris), salle D421.
__
Vianney Dubuc (ENS de Lyon) - "Des styles en poésie : émergence de l'hétérogénéité stylistique et du plurilinguisme social dans la poésie lyrique versifiée (1870-1885)"
À partir de la décennie 1870, certains poèmes lyriques intègrent de plus en plus fréquemment dans leur énonciation des énoncés en argot ou d’autres traces sociolectales contrastant avec la langue poétique conventionnelle. Ce nouvel usage invite à interroger les effets du mélange des styles dans la poésie lyrique. L’opposition bakhtinienne entre, d’une part, le discours romanesque, marqué par l’hétérogénéité stylistique, et, d’autre part, le discours poétique, défini par l’homogénéité de la langue du poète et par l’uniformité garantie par la régularité du vers, doit être nuancée en repensant les articulations entre style, énonciation, métrique et genre littéraire.
Nous proposons de caractériser cette émergence de l’hétérogénéité stylistique dans la poésie lyrique française, survenue entre 1870 et 1885, comme un moment énonciatif singulier en convoquant les catégories de polyphonie et de plurilinguisme. Nous verrons que cette hétérogénéité stylistique coïncide avec la mise en scène d'une hétérogénéité énonciative, avec la multiplication des emprunts aux discours ordinaires ou à la chanson populaire et enfin avec la reconfiguration des normes métriques.
À travers les exemples de quelques poèmes de Tristan Corbière, de Jean Richepin et de l’ouvrage collectif des Dixains réalistes, nous interrogerons les mécanismes de cette hétérogénéité stylistique et leurs effets aux plans esthétique et poétique. Cette transformation du vers et de l’énonciation lyrique doit aussi être comprise à la lumière du contexte historique des débuts tourmentés de la Troisième République et interprétée comme la marque d’un positionnement socio-idéologique dont la stylistique doit pouvoir rendre compte.
***
Doctorant en cinquième année à l’ENS de Lyon et ATER de langue et littérature françaises à l’Université de Poitiers, Vianney Dubuc rédige actuellement une thèse intitulée « Poétique de l’oblitération (1870-1885) : pour une stylistique de l’énonciation lyrique » sous la direction d’Éric Bordas. Ses recherches croisent les théories linguistiques de l’énonciation à la stylistique du vers et aux enjeux littéraires et socio-politiques des débuts de la IIIe République. Parallèlement, il coordonne la publication d’un double numéro de la revue Itinéraires intitulé « Egologie : ce que je veut dire » (parution prévue au printemps 2026).
__
Anastasia Scepi (Sorbonne Université, STIH) - "Les contes de fées de Cham , « traduction(s) libre(s) de Perrault» : le style à l'épreuve des canons"
Dans le Musée ou magasin comique de Philipon (1842-1843), Cham, caricaturiste prolifique, ayant œuvré pendant des décennies pour Le Charivari, envisage de « nouvelles manières de lire de vieux auteurs » en questionnant le lien texte – image dans un décalage comique. Il apparaît que ses parodies des Contes de fées, publiées dans le Musée Philipon, puis, en 1862, dans Petit Journal pour rire, peuvent être, elles aussi, considérées comme l'une de ces manières, en ce que ce dernier en propose une « traduction libre », comme l'indique le sous-titre du Petit Poucet. Cette communication s'intéresse à la manière dont le dialogue interdiscursif entre Perrault, et Cham, au sens où l'entendent Jean-Michel Adam et Ute Heidmann, participe de ce laboratoire du style que furent les journaux de Philipon. Il s'agira donc de déterminer comment les reconfigurations transmédiales et l'intericonicité créent des transtextes, dont la dérision affectant à la fois l'image et le texte, permet de penser le style de la caricature, « cette langue toute nouvelle en France » (Le Charivari, 1er novembre 1832), à l'épreuve des canons.
***
Agrégée de lettres modernes ayant obtenu la certification complémentaire Arts - Option Histoire de l'art, Anastasia Scepi est doctorante à Sorbonne-Université.
___
Inscription obligatoire aux adresses suivantes :
arianna.bocca[a]etu.sorbonne-universite.fr
clara.cini[a]sorbonne-universite.fr
norbert.danysz[a]univ-lyon2.fr