Le fil perdu. Cinéma et littérature
Par Jean-Louis Jeannelle (Université de Rouen)
«Cinéma et littérature: le fil perdu», introduction à Cinémalraux: essai sur l'œuvre d'André Malraux au cinéma, Paris, Hermann, 2015, p.7-18.
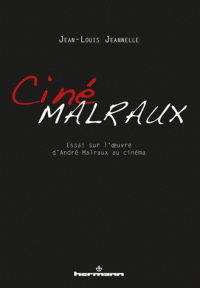
Ce passage est ici reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur et de son éditeur.
Du même auteur, lire également Scénarios possibles pour un film invisible
Dossier Cinéma
Cinéma et littérature
Malraux a écrit un court essai, «Esquisse d'une psychologie du cinéma», initialement paru dans le n°8 de la revue Verve en juin 1940 et très vite devenu incontournable (qui n'en connaît la clausule: «Par ailleurs, le cinéma est une industrie»?), mais resté par la suite étrangement isolé dans son œuvre. Il est l'auteur de Sierra de Teruel, intitulé Espoir lors de sa ressortie en avril 1945 (ou plutôt sa véritable sortie, puisque le film avait été interdit par la censure en septembre 1939), véritable hapax dans l'histoire du septième art mais qui, réalisé dans des conditions dramatiques et condamné à l'inachèvement, ne nous est, aujourd'hui encore, accessible que dans une version mutilée par son distributeur — la version originale se trouve conservée dans deux bibliothèques américaines et à la Filmoteca de Madrid. D'aucun autre écrivain français, on n'a plus souvent écrit que ses romans illustraient, par leur caractère visuel, par leur usage de l'ellipse ou par leur art du montage, l'influence du cinéma sur le roman; pourtant, aucun d'entre eux n'a, jusqu'à présent, été adapté à l'écran par un autre réalisateur que l'auteur de L'Espoir lui-même. Enfin, devenu ministre des Affaires culturelles, Malraux a parachevé la politique de soutien au cinéma amorcée en France durant la guerre, sans que l'attention privilégiée qu'il accordait à cet art ait suffi à contrebalancer le rôle de censeur qu'on lui fit jouer à l'occasion de deux célèbres «Affaires», celle de La Religieuse en avril 1966, puis le renvoi d'Henri Langlois de la Cinémathèque au printemps 1968.
Si, en littérature, Malraux fut un « contemporain capital », au cinéma, il fut tout et ne fut rien.
Tout, car son existence durant, l'écrivain s'est attaché à chacune des dimensions de cet art. Histoire et théorie du cinéma, écriture de scénarios, production et réalisation d'un film, mise en œuvre d'une politique cinématographique, réflexion sur le documentaire d'art, ouverture à l'audiovisuel… Malraux s'inscrit dans une importante lignée d'écrivains français qui ne se sont pas limités à composer des canevas ou à fignoler des dialogues, mais ont su étendre leur style à un art dont les modes de production peuvent pourtant paraître incompatibles avec l'activité littéraire. Resitué à l'intérieur de cette tradition dont l'héritage est aujourd'hui bien négligé, Malraux apparaît, mieux que tout autre écrivain, capable d'établir une continuité entre le texte et l'écran tout en couvrant par la diversité de ses contributions l'ensemble du spectre de la création cinématographique. À ce titre, il est un auteur total.
Et rien néanmoins, car son œuvre cinématographique n'a jusqu'ici pas encore trouvé la place qui lui revient. Moins abondante que celle de Pagnol, de Guitry, de Cocteau ou de Duras, la production de Malraux se réduit selon toute apparence à Sierra de Teruel, unanimement révéré. Or c'est précisément cette unanimité qui fait obstacle. Du cinéma de Malraux, il reste à réévaluer les contributions que nous pensons à tort trop bien connaître (tels les écrits théoriques sur le cinéma ou Sierra de Teruel même), à mettre en valeur des aspects aujourd'hui encore négligés (comme sa réflexion sur le film d'art), enfin à découvrir une dimension totalement inexplorée, à savoir la longue histoire des adaptations (inachevées) de La Condition humaine — cette histoire, qui débute dès 1934 avec le scénario que le romancier co-écrit en URSS avec Eisenstein et se poursuit jusqu'à nos jours, est l'objet d'une étude complémentaires publiée aux Éditions du Seuil sous le titre Films sans images à laquelle je me permets de renvoyer et dont je présente les grandes lignes dans la conclusion de cet essai sur les «inadaptations»[1].
1. Une création continuée
Une telle œuvre reste inséparable de la longue histoire des rapports entre littérature et cinéma, arrière-plan, terrain d'analyse et ligne de fuite de tout ce travail.
Cinéma et littérature: cette question, qui fit autrefois les délices de générations de cinéphiles, de critiques et d'écrivains, passe à présent pour une vieille lune théorique. J'y vois le résultat d'une double solution de continuité, dont il importe de mesurer les effets. Une première rupture s'est produite dans les liens étroits qui avaient longtemps uni la littérature et le cinéma en France, depuis les premières décennies du siècle (Apollinaire, aux yeux duquel le septième art était un symbole de l'«esprit nouveau», anticipait en 1917 le jour où «le phonographe et le cinéma étant devenus les seules formes d'impression en usage, les poètes aur[aient] une liberté inconnue jusqu'à présent») jusqu'à Duras, Robbe-Grillet et Resnais. Ce sont ces liens très étroits qui se sont peu à peu distendus à partir des années 1980, même si l'adaptation de classiques ou de romans à succès alimente toujours l'industrie du cinéma et même si différents écrivains, sans se cantonner à composer des scénarios, se saisissent aujourd'hui encore de la caméra — Catherine Breillat, Christophe Honoré, Eugène Green, ou Emmanuel Carrère assurent ainsi la pérennité d'une tradition nationale en s'illustrant à la fois à l'écrit et à l'écran.
La seconde rupture apparaît d'ampleur plus limitée, mais se révèle tout aussi significative: la publication par Gilles Deleuze de L'Image-mouvement (1983) et de L'Image-temps (1985) a, en effet, marqué la fin de la domination que la théorie littéraire exerçait depuis le début dans le champ de la théorie cinématographique, et cela au profit de la philosophie. Depuis, la relecture des essais de Walter Benjamin ou de Siegfried Kracauer, la traduction des ouvrages de Stanley Cavell ou de Slavoj Zizek, les travaux de Clément Rosset, de Jacques Rancière, de Bernard Stiegler, ou de Marie-José Mondzain[2] ont balayé le dialogue inter-arts qui avait si longtemps occupé Eisenstein («Le cinéma et la littérature (De l'imagicité)»), André Bazin (Qu'est-ce que le cinéma?), Claude Mauriac (Petite littérature du cinéma), Barthélémy Amengual (Clefs pour le cinéma), ou Christian Metz (Langage et cinéma, Le Signifiant imaginaire), puis qu'Étienne Fuzellier, Marie-Claire Ropars, Jeanne-Marie Clerc, André Gaudreault ou François Jost avaient poursuivi dans leurs travaux universitaires.
Les articles, conférences et numéros de revue consacrés à ce dialogue entre littérature et cinéma depuis les années 1910 constituent une grille d'analyse devenue quasi obsolète: qui s'inquiète aujourd'hui de savoir à quelle condition une adaptation est fidèle à l'œuvre originale? Qui ose s'interroger sur l'hypothèse, si longtemps discutée, d'une influence déterminante des films sur le roman américain et, par ricochet, sur le roman français? Qui se demande encore s'il est légitime de parler d'un «langage cinématographique» et ce qu'il faut entendre par là? N'en déduisons pas une quelconque rivalité: il est juste que la philosophie trouve à présent dans le cinéma un terrain privilégié pour penser ses concepts et renouveler la réflexion sur le statut de l'image audiovisuelle. Reste que dans ce cas, un même danger de banalisation menace — on n'est parfois pas loin de voir dans tel mouvement de caméra la traduction concrète d'un concept ou d'un problème philosophique selon un jeu d'équivalence tout aussi naïf et contestable que celui par lequel on repérait dans un roman la traduction linguistique des mêmes mouvements de caméra[3]. Mais il importe plus encore de dénoncer l'abandon d'un paradigme autrefois constitutif de l'histoire même du septième art en France. Car la désaffection des rapports unissant la muse des lettres à celle de l'image en mouvement nous cache ce qui fut la spécificité du cinéma français, à savoir l'importance des cas de double compétence esthétique qu'illustrent, par excellence, les œuvres de Cocteau, de Pagnol, de Guitry, de Malraux, ou de Duras.
Cet essai a pour but de montrer que si Malraux n'a pas la filmographie d'un Guitry ou d'un Pagnol, s'il n'a (semble-t-il) pas exercé sur de plus jeunes réalisateurs une influence aussi directe que celle de Cocteau, auquel Truffaut rendit des hommages appuyés, s'il n'a pas soumis Sierra de Teruel à un commentaire esthétique et théorique aussi poussé que celui qui accompagne les œuvres de Duras ou de Robbe-Grillet, Malraux a du moins pour lui d'avoir rassemblé, serait-ce même de manière ponctuelle, le plus large faisceau de qualités propres à distinguer un écrivain dans le domaine du cinéma.
Or ce qui s'est perdu par notre inattention à de tels cas de cohabitation, situés à l'intermédiaire de deux arts, c'est une manière différente d'être un «auteur», préalable à la grande offensive critique que les «Jeunes Turcs» des Cahiers du cinéma ont menée à partir des années 1950. La figure du réalisateur, désormais pleinement légitimé dans son droit à exercer la maîtrise auctoriale, a depuis éclipsé cette autre acception, jamais directement théorisée, et qui reposait sur l'extension, sans solution de continuité, du statut d'auteur — au sens littéraire du terme — au domaine cinématographique, au nom d'une profonde unité d'inspiration et de formes. La nature de cette unité a longtemps suscité d'importantes polémiques: l'identité même du «septième art» tenait, depuis Canudo (inventeur de cette célèbre formule), à un délicat travail de disjonction, comme si le propre ducinéma dépendait en partie de ce qui le reliait à son aînée et de ce qui l'en distinguait. Il n'est pas question ici de rouvrir un tel dossier. Simplement de suggérer que si la recherche d'une essence — ce que Louis Delluc nommait «photogénie» ou Élie Faure «cinéplastie» — a été l'un des principaux aiguillons de la critique cinématographique, peut-être a-t-elle aussi masqué la possibilité de ce que j'appellerai ici une création continuée, où l'extension d'un domaine à l'autre n'implique aucunement que l'art des images en mouvement se soumette à celui des mots.
Le moment est venu de s'installer à nouveau dans cet entre-deux, déserté en France depuis les années 1990, alors même qu'il continuait à susciter d'importants travaux dans le domaine anglo-saxon, où le concept d'adaptation n'a cessé d'être renouvelé[4]. Quelques très récentes publications indiquent le besoin de repenser ce qui se crée d'une sphère à l'autre, dans ce que Bernard Vouilloux nomme une «relation transesthétique» à la faveur de laquelle littérature et cinéma partagent une même communauté de destin[5]. Le coup d'envoi de ce renouveau théorique n'est autre que le premier chapitre d'Hollywood à l'écran, intitulé: «Pour une poétique des films[6]», dans lequel Marc Cerisuelo, se situant dans la continuité des formalistes russes, d'Albert Laffay, de Christian Metz ou de Käte Hamburger, a clairement réaffirmé que «le cinéma est un art littéraire», thèse qu'il a depuis reformulée dans Fondus enchaînés (sous-titrés «Essais de poétique du cinéma»):
« La fausse fenêtre de l'adaptation avait ouvert par malchance sur un ensemble de débats pipés dès l'origine où le film se retrouvait tantôt en situation de vassalité à l'égard du texte, tantôt dans la revendication d'une autonomie débouchant à son tour sur l'impasse de la «spécificité» du cinéma[7].»
Contre les tenants de la lecture du film, Marc Cerisuelo rappelle qu'un film se voit, même s'il ne se réduit pas à un «pur fait visuel ou optique», mais implique de saisir des significations, plus précisément de «voir le sens[8]»; contre les «tenants du Tout-Image», il insiste sur le fait qu'étant «mise en mouvement du monde fondée sur le primat du temps» («les images filmiques racontent autant qu'elles représentent»), le cinéma est un art de la fiction qui «obéit nécessairement aux deux grands régimes qui gouvernent la représentation des histoires: l'épique et le dramatique[9]». Élargie à l'esthétique grâce à la relecture par Gérard Genette des théories de Goodman dans L'Œuvre de l'art, la poétique ouvre ainsi la possibilité de penser autrement le lien ontologique unissant le cinéma et la littérature comme arts du temps et de la fiction.
À l'impulsion théorique décisive de Marc Cerisuelo répondent deux autres phénomènes convergents. Le premier concerne le développement d'une génétique du cinéma, initiée par Jean-Loup Bourget et Daniel Ferrer dans le cadre d'un séminaire tenu à l'ITEM[10], grâce auquel il est désormais possible de penser le film non comme un objet clos réduit à la somme de ses photogrammes, mais comme un processus de création complexe, dont la phase d'écriture scénaristique constitue l'une des étapes essentielles. Plus encore, la perspective génétique permet également d'envisager l'inaboutissement (par abandon, censure ou mutation radicale) non comme un simple échec, mais comme un phénomène constitutif de la création cinématographique et appelant, à ce titre, à être pris en compte en tant que tel[11]. Seconde mutation: aux marges de l'histoire littéraire et de l'histoire du cinéma émerge parallèlement une réévaluation critique des «affinités électives[12]» longtemps entretenues par les deux arts, en particulier grâce à l'existence de toute une sociabilité cinéphile où se mêlaient les deux sphères artistiques[13] et d'une tradition d'entrecroisement continuel propre aux avant-gardes ou à certains milieux littéraires[14].
Ces efforts convergents, venus à la fois de la poétique, de la génétique et de l'histoire, ouvrent désormais la voie à un réexamen approfondi.
2. Pour une «histoire partagée»
Mais comment rendre compte de la continuité observée? L'étude conjointe des deux arts s'est trop longtemps cantonnée à celle de l'adaptation, pensée comme processus de transposition. Caution recherchée par le cinéma des premiers temps, en quête de légitimité, puis modèle de fabrique national, dont le couple «AurenchetBost» est devenu le symbole depuis que Truffaut a dénoncé une «certaine tendance du cinéma français» en 1954, enfin source aussi bien des échanges les plus fructueux (Alain Resnais) que du recyclage le plus indigent […], l'adaptation fait de la littérature une inépuisable source d'histoires dont on ne voit plus bien l'intérêt théorique, réduit à un lassant exercice de lecture comparée.
On a jusqu'ici envisagé les rapports établis essentiellement sous leur angle monographique (les œuvres de Cocteau et de Duras sont, de ce point de vue, les mieux servies, celle de Guitry ayant bénéficié d'une juste réhabilitation en 2007), générique (si le couple cinéma/roman n'intéresse plus grand monde, sa variante cinéma/théâtre suscite, quant à elle, un intérêt renouvelé), parfois également poétique (puisque l'adaptation, bien que négligée par Gérard Genette, a pu être assimilée à ce que celui-ci nomme dans Palimpseste: «transmodalisation», c'est-à-dire au changement du mode de représentation par dramatisation ou à l'inverse par narrativisation[15]). J'aimerais défendre l'hypothèse suivante: toute la difficulté de telles approches tient à ce qu'on y reste indifférent à l'histoire que la littérature et le cinéma ont longtemps partagée, une histoire qui, loin de se dérouler dans un espace homogène et uniforme, se révèle discontinue, fragmentaire et souvent déroutante, chacune des instances se voyant dépouillée, une fois sur le terrain adverse, de la crédibilité dont elle jouit dans son champ de prédilection, contrainte ainsi de remettre en jeu les modalités de création qui sont les siennes. Une histoire partagée, voire à certains moments d'intenses échanges comme dans les années 1930 ou les années 1960, une cohistoire, dont il s'agit de comprendre le fonctionnement très particulier.
Car la littérature et le cinéma ne relèvent ni des mêmes lieux d'exercice ni surtout des mêmes temporalités. À l'histoire longue, multiséculaire de la première, où l'ancien saisit sans cesse le nouveau, répond l'histoire condensée de la seconde, limitée à un siècle («Le cinéma est le seul art dont on connaisse le jour de naissance», notait Béla Balász), mais dont l'évolution est d'autant plus fulgurante que celle-ci se déploie conjointement dans différents espaces nationaux grâce à la rapidité de ses moyens de reproduction et à l'universalité de ses vecteurs de diffusion. Les bornes historiques du cinéma se voient ainsi compensées par cette formidable capacité d'extension, certes géographique et culturelle mais aussi esthétique, à travers son dialogue avec les autres formes de création — Canudo n'y voyait-il pas une vaste synthèse des arts de l'espace comme l'architecture ou la peinture, et des arts du temps, comme la musique et la danse?
Ce sont, plus profondément, les rythmes mêmes de production et de consommation qui diffèrent. Le temps de la création d'un film obéit, en effet, à des facteurs d'ordre économique, technique et pratique totalement étrangers au temps de la création littéraire, relatif au tempo propre à chaque créateur, et de ce fait relativement autonome — du moins jusqu'au moment où s'enclenche le processus de publication. De même la nature par définition collaborative du cinéma impose-t-elle un éclatement de l'invention en différentes phases (écriture, réalisation, montage…), elles-mêmes soumises à des rythmes distincts. De telles conditions de production ont d'importantes conséquences aussi bien sur les cadences auxquelles obéit la fabrication des produits cinématographiques que sur le format des œuvres concernées, dont la longueur dépend de critères de rentabilité justifiant les sommes engagées. Pour ne rien dire du temps de la diffusion (exploitation en salle ou sur tout autre support) qui offre peu de rapports avec la manière, plus longue et plus aléatoire, dont un livre rencontre son public.
L'histoire même des deux arts, telle que l'élabore la tradition critique, se structure dès lors selon des repères différents — ainsi des catégories de siècle ou de mouvement en littérature, qui présentent peu d'intérêt au cinéma. Les moyens même d'identifier les œuvres ne sont pas tout à fait semblables, étant donné que les films ont beau être classés par nom de réalisateur dans la plupart des histoires du cinéma, rien n'empêche en théorie (ni en pratique) de parcourir l'histoire passée en fonction des scénaristes, des producteurs, des acteurs ou de toute autre instance impliquée, contrairement à ce qui se passe en littérature où, en dépit des coups de boutoir apportés par la théorie, la sociologie ou l'histoire de l'édition, l'auteur reste toujours une voie d'appréhension quasi exclusive.
Le temps partagé dont il sera ici question se nourrit donc des intersections, recouvrements ou courts-circuits entre ces deux arts aux rythmes si différents et néanmoins étroitement liés l'un à l'autre des années 1910 jusqu'aux années 1980, au point d'avoir donné naissance à une histoire faite de créations continuées d'une sphère à l'autre et formant une même durée par conjonction, où alternent pas de deux et à-coups. Quelle mesure s'applique à ce temps partagé? Y dominent avant tout les variations de cadence (pensons par exemple à l'urgence chez Guitry qui finit par tourner les pièces en même temps qu'il les joue sur scène, ou au remord chez Pagnol qui réalise en 1936 une nouvelle version de Topaze, adaptée quatre ans plus tôt par Louis Gasnier, puis revient en 1950 sur son propre auto-remake) et les enchaînements par lesquels une œuvre littéraire bascule soudain dans cet espace conjoint, connaissant alors un nouveau cours, indépendant et néanmoins indissociable de son destin en tant que livre. L'attention doit s'y porter aussi bien sur les effets de convergence que sur les différences de rythme ou sur les échappées libres des adaptations inabouties, destinées à rester longtemps secrètes mais qui hantent la sphère rivale, esquissant une histoire potentielle, inaboutie mais riche de ressources inexploitées.
3. Cinq propositions et une ouverture
De cette histoire partagée, la carrière de Malraux dans le domaine du septième art constitue un jalon essentiel, trop souvent réduit à quelques formules tirées de l'Esquisse d'une psychologie du cinéma ou au commentaire de Sierra de Teruel. Cinq plans seront ici distingués: le premier concerne le jeu d'équivalences systématiques noué entre roman et cinéma. Viennent ensuite deux plans où domine l'action pratique: le passage à la réalisation à la fin de la guerre d'Espagne sous forme d'une auto-adaptation à ce point autonome de sa source que le film apparaît en réalité comme une suite du roman, puis la conduite de la politique cinématographique à la fin des années 1950 et dans les années 1960. Parallèlement, Malraux a exploré deux autres plans plus proprement littéraires: d'un côté l'invention de formes scénaristiques destinées à subsister sous une forme exclusivement écrite, notamment au sein du Miroir des limbes, de l'autre l'élaboration, à la fois théorisée et mise en œuvre (pour partie) grâce à la collaboration de Clovis Prévost ou de Jean-Marie Drot, d'un Musée imaginaire audiovisuel issu des écrits sur l'art.
À chacun de ces plans se joue de manière singulière l'articulation entre le temps des textes et le temps des films. Celle-ci appelle, afin que soient respectées les différences de rythme auquel obéissent les deux médiums, une entrelecture, attentive aux croisements opérés, mais respectant l'intervalle qui existe entre les domaines en présence, où la réciprocité esquissée ne s'épuise ni en une confrontation stérile ni en un jeu d'équivalences terme à terme, mais permet à une œuvre de se poursuivre d'une sphère à l'autre.
Il s'agira d'écarter quelques faux débats. Ainsi la contribution théorique de Malraux au septième art est-elle souvent obérée par l'inévitable question du «roman cinématographique». Il convient d'écarter l'hypothèse longtemps débattue mais sans véritable fondement théorique d'une convergence quasi naturelle du roman et du cinéma durant l'entre-deux-guerres, observable dans leur échange permanent d'intrigues et de techniques narratives. Si Malraux a lui-même alimenté ce postulat, élevé au rang de dogme par Claude-Edmonde Magny, nous verrons que son œuvre offre un autre modèle pour penser les rapports entre les deux arts: moins une convergence spontanée qu'une série de croisements ponctuels, manifestes lorsque l'on se place à l'intermédiaire des deux arts, et que l'on s'attache, par exemple, aux emprunts concrets à la faveur desquels la projection cinématographique devient, dans certaines conditions, un moyen de donner forme au cinéma mental d'un personnage abandonné à lui-même. C'est dans l'écart entre les deux médiums que se négocient les échanges rendus possibles.
Dès lors, l'unique réalisation de l'écrivain, Sierra de Teruel, ne peut se réduire à une confrontation entre le texte-source et son transfert à l'écran. Replaçons ce film au sein de l'œuvre romanesque et mémoriale de Malraux, et l'on constate qu'en son centre se trouve l'expérience, fondamentale pour l'écrivain depuis le milieu des années 1930 et sur laquelle il reviendra souvent par la suite, d'un contact renouvelé avec le monde — expérience grâce à laquelle Sierra de Teruel, d'ordinaire rattaché à la tradition politique du cinéma soviétique, fait signe vers la modernité du néo-réalisme italien qui triomphera quelques années plus tard. C'est à la fois comme scène matricielle de l'imaginaire malrucien, où le cinéma donne corps à ce que les textes ne cessent de réécrire, et comme point de rencontre entre l'histoire d'une œuvre littéraire et celle du cinéma qu'il est possible de lire l'unique film réalisé par Malraux.
Les responsabilités politiques exercées par l'écrivain ont, en ce qui concerne sa contribution au développement d'un cinéma d'auteur, donné lieu à un malentendu persistant: à son arrivée au pouvoir, en 1958, l'ancien compagnon de route du parti communiste devenu le héraut du général de Gaulle est, un temps, apparu comme une figure tutélaire de la nouvelle génération de cinéastes, ce que ses premières mesures en ce domaine ont confirmé. Honni ultérieurement par cette même génération qui fit de son combat contre l'homme de l'«antimémoire courte» un signe avant-coureur de mai 68, Malraux n'a pu faire valoir ce que sa réflexion apportait de nouveau, à savoir l'inscription du cinéma dans une sphère bien plus large, dont l'essayiste anticipait les développements à venir: dans La Métamorphose des dieux et dans L'Homme précaire et la littérature, la littérature et le cinéma sont ainsi confrontés au temps de l'«audio-visuel», envisagé par Malraux de manière antinomique à la fois dans ses effets les plus ravageurs (comme temps soumis au diktat de l'actualité) et sous sa forme la plus utopique (comme «quatrième révolution culturelle»).
Un tel travail d'entrelecture met en jeu différents modèles textuels. Comme Cendrars, Fondane et bien d'autres écrivains, Malraux voyait dans le scénario une forme littéraire en soi, dont les possibles peuvent être explorés indépendamment de la production d'un film. Or l'écriture scénaristique se mêle plus particulièrement, chez lui, à la veine farfelue, jusqu'à présent limitée à l'analyse de ses premiers récits et de La Condition humaine, voire à ses résurgences dans Le Miroir des limbes. Comme le révèle la lecture d'un projet de film que le personnage de Clappique soumet à Malraux au beau milieu des Antimémoires, l'inspiration farfelue trouve dans ce faux scénario du Règne du Malin (véritable échec romanesque de l'écrivain) une voie où s'épanouir, passant d'un art à l'autre afin de permettre à l'antimémorialiste de liquider toute une dimension de son passé.
Mais la confrontation poussée du texte et de l'écran peut également déboucher sur une contestation inattendue. Paradoxalement, alors même qu'il s'est fixé pour horizon à sa réflexion sur l'art l'entrée dans un vaste domaine audio-visuel, encore imprévisible dans ses développements, Malraux semblait tenir à distance le modèle du film d'art, dont il examine les modalités, mais auquel il n'accorde qu'une importance limitée. Or — et Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot ou Les Statues meurent aussi d'Alain Resnais et Chris Marker le prouvent —, c'est précisément du film d'art que proviennent à la fois les défis et les critiques auxquels le Musée imaginaire malrucien doit répondre de la manière la plus directe: peut-être est-ce là, plus que dans cet audiovisuel imaginé par l'essayiste, que se trouvent les premières pierres de ce que l'on peut appeler un «ciné-musée».
En guise d'ouverture vers Films sans images, consacré aux tentatives d'adaptation de La Condition humaine, je proposerai d'envisager l'ensemble des scénarios existants non comme ce qui subsiste de réalisations échouées, mais comme un vaste réseau de textes, accessible par fragments seulement, mais formant un espace médian, qui n'appartient ni tout à fait à la littérature (les scénarios conservés ne sont pas lus comme des hypertextes du roman) ni tout à fait au cinéma (inaboutis, ils ne sont pas non plus reçus comme des films, par conséquent n'apparaissent pas comme des formes légitimes d'adaptation), mais de ce fait comme un véritable point de jonction entre les deux médiums. Il y a là une manifestation étonnante mais également très féconde de la cohistoire ici esquissée et qui fait l'objet de cet autre essai, Films sans images.
Université de Rouen
Mars 2015
Pages de l'Atelier associées: Cinéma, Dehors de la littérature, Adaptation.
[1]. Jean-Louis Jeannelle, Films sans images: une histoire des scénarios non réalisés de «La Condition humaine», Éditions du Seuil, coll.«Poétique», 2015.
[2]. Sur l'approche philosophique du cinéma, voir, dans le domaine anglo-saxon, Philosophy of Film and Motion Pictures: an Anthology (dir. Noël Carroll et Jinhee Choi, Blackwell Publishing, 2006) et, dans le domaine français, Cinéma et philosophie de Dominique Château (Armand Colin, 2005) ou «Cinéphilosophie» (Critique, n°692-693, janvier-février 2005).
[3]. Ainsi par exemple de la lecture qu'Ollivier Pourriol fait de Collatéral, de Michael Mann, dans Cinéphilo, Hachette littératures, coll.«Haute tension», 2008, p. 47-52.
[4]. Voir, entre autres références, T. Jefferson Kline, Screening the Text: Intertextuality in New Wave French Cinema, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1992; Brian McFarlane, Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation, Oxford, Clarendon, 1996; Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text, dir.Deborah Cartmell and Imelda Whelehan, London-New York, Routledge, 1999; Film Adaptation, dir.James Naremore, New Brunswick-London, Rutgers University Press, 2000; Sarah Cardwell, Adaptation Revisited: Television and the Classic Novel, Manchester, Manchester University Press, 2002; Kamilla Elliott, Rethinking the Novel/Film Debate, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; Robert Stam, François Truffaut and Friends: Modernism, Sexuality and Film Adaptation, New Brunswick-London, Rutgers University Press, 2006; Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York-London, Routledge, 2006; Thomas Leitch, Film Adaptation and its Discontents, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2007; Simone Murray, The Adaptation Industry: the Cultural Economy of Contemporary Literary Adaptation, New York-London, Routledge, 2012.
[5]. Voir Bernard Vouilloux, Langage de l'art et relations transesthétiques, Éditions de l'Éclat, coll.«Tiré à part», 1997.
[6]. Marc Cerisuelo, «Pour une poétique des films», Hollywood à l'écran: essai de poétique historique des films, l'exemple des métafilms américains, Presses de la Sorbonne nouvelle, coll. «L'œil vivant», 2001, p.17-71.
[7]. Id., Fondus enchaînés: essais de poétique du cinéma, Éditions du Seuil, coll.«Poétique», 2012, p.47.
[8]. Ibid., p.184.
[9].Ibid., p.186.
[10]. Voir le texte programmatique fondamental de Jean-Loup Bourget et de Daniel Ferrer, «Genèses cinématographiques», dans Genesis, n°28, juillet 2007.
[11]. Sur ce point, je renvoie à Films sans images: une histoire des scénarios non réalisés de «La Condition humaine», op. cit.
[12]. Voir Jean Cléder, Entre littérature et cinéma: les affinités électives – échanges, conversions, hybridations, Armand Colin, coll.«Cinéma/arts visuel», 2012.
[13]. Voir Cinématisme: la littérature au prisme du cinéma, dir.Jacqueline Nacache et Jean-Loup Bourget, Berne, Peter Lang, 2012 (en particulier Jacqueline Nacache, «Virgile cinéaste: le pré-cinéma comme utopie pédagogique», p.167-186).
[14]. Voir Quand les écrivains font du cinéma: instantanés critiques, dir.Valérie Berty et Marc Cerisuelo, Archives Karéline, 2012, et Mireille Brangé, La Séduction du cinéma: Artaud, Pirandello et Brecht entre littérature, cinéma et théâtre, Champion, coll.«Bibliothèque de littérature comparée», 2014.
[15]. Voir par exemple Robert Stam, «Beyond fidelity: the dialogics of adaptation», dans Film Adaptation, op. cit., p.54-76.