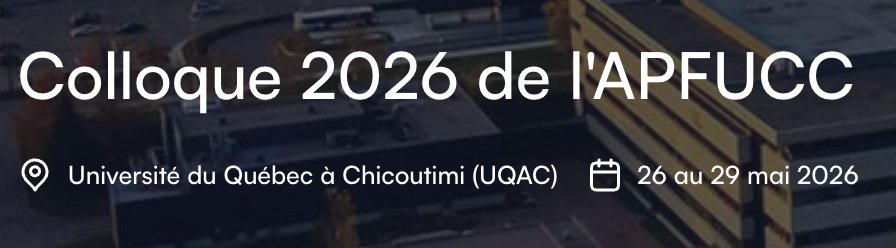
Honte et écriture: entre stigmate et transformation
Atelier 2, colloque de l'APFUCC, Université de Chicoutimi, 26-29 mai 2026
Responsables: Emmanuelle Tremblay et Andréane Frenette-Vallières
Inscription : https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2026/pages/87968538-fab0-4ca7-ba5a-c1b461e8829d
Date limite: 15 janvier 2026
Depuis les deux dernières décennies, et dans le sillage de #metoo, la honte traverse les écrits des femmes comme expression d’un vécu à partager pour la faire changer de camp par la dénonciation des « sans-honte » (Cyrulnik). Selon Didier Huberman, l’émotion qui agit sur la personne la dépasse en même temps. Elle peut aussi être considérée comme un « mouvement affectif qui nous possède ». C’est dans cet esprit que nous invitons à réfléchir sur la prise en charge par l’écriture de la honte personnelle et collective, que ce soit en fonction de l’identité de genre ou de l’appartenance à un groupe minorisé culturellement et linguistiquement. Plus précisément, les études rassemblées dans cet atelier porteront sur les écrits de femmes en Amérique francophone (allochtones et autochtones) ou sur le processus de création d’une œuvre qui s’articule à l’émotion dans une perspective autothéorique.
De nombreux travaux dans les domaines de la philosophie, la psychologie, la psychanalyse et la sociologie ont mis en valeur l’aspect intersubjectif de la honte, car cette dernière provient à la fois du corps du sujet et de l’omniscience d’un regard extérieur — et honnisseur —, souvent intériorisé. La honte rappelle donc un système de valeurs conformistes qui excèdent le sujet de toutes parts. Dans cette optique, dire la honte équivaut à la traduire comme on le fait d’un cas en justice, conformément à une double exigence : une exigence de vérité (par l’exposition du sujet dans sa condition subalterne et dans la souffrance qui lui est reliée); une exigence de reconnaissance de la vulnérabilité qui définit le sujet dans son rapport aux autres.
Comment vivre avec la honte? Quelles sont les réactions à celle-ci? Peut-on lui donner un sens? Quel récit de soi pour le sujet honteux? Dans l’optique où la littérature constitue une vaste « entreprise d’éhontement » (Martin) par la mise à nu à laquelle elle engage, la honte n’a pas de valeur morale en soi. Ni du côté du mal ni du côté du juste (Ogien), elle marque plutôt un seuil où l’intégrité — menacée — est mise en jeu. D’une part, l’émotion peut mener à la destruction de soi ou au stigmate. De l’autre, la « honte-signal » (Janin) favorise la préservation d’un espace à soi. Il y aurait donc une « bonne » honte dont l’expression est dès lors assimilable à un « appel aux devenirs », voire à une émotion révolutionnaire (Gros) ou à « une littérature de combat » (Lafontaine).
Ainsi, une attention pourra être accordée à la fonction critique de la honte, tout comme à ses sources et à ses types (moral, traumatique, narcissique ou social). Plus largement, il sera pertinent de se demander comment la honte, dans son alliance avec d’autres émotions (ou affects, comme la peur et la pudeur, par exemple) oriente l’expérience qui fait l’objet du récit et quelles sont les stratégies narratives et esthétiques qui lui donnent forme. En l’occurrence, les approches pourront être aussi variées que les sujets abordés dont témoigne cette liste partielle :
· Héritage de la honte et filiation; traumatisme personnel, familial et intergénérationnel
· Violences physiques et psychologiques, négation de soi et cas d’abus
· Perceptions du corps genré, images de soi, stéréotype et pouvoir de l’image
· Vulnérabilité corporelle et psychique, vieillissement, maladie et discours médical
· Frontières de l’humanité; extériorité et animalité
· Instrumentalisation politique, sociale et culturelle de la honte; rapport aux pouvoirs technologiques et aux discours hégémoniques
· Écriture, tabou et horizon de la réception
—
Bibliographie
Anne-Braun, Alexis, « L’entremêlement de la théorie et de la vie », Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, 53, 2023. En ligne : http://journals.openedition.org/cps/6676
Agamben, Giorgio (1998 [1988]), « Idée de la honte », dans Idée de la prose, Paris, Christian Bourgois, p. 66-70.
Ahmed, Sara (2015 [2004]), The cultural Politics of Emotion, New York, Routledge.
Dargent, Fanny et Françoise Neau (2017), La honte. Écouter l’impossible à dire, Paris, Presses Universitaires de France.
Bergoffen, Debra (2018), « The misogynous politics of shame », Humanities, vol. 7, no 3, p. 1-9.
Boudreau, Annette (2022). Dire le silence. Insécurité linguistique en Acadie. 1867-1970, Sudbury, Prise de parole.
Bourdieu, Pierre (1998), La domination masculine, Paris, Seuil.
Butler, Judith (2009 [1993]), Ces corps qui comptent: De la matérialité et des limites discursives du « sexe », traduit par, Paris, Amsterdam.
-------- (2005a), Humain, inhumain. Le travail critique des normes. Entretiens, traduit par Jérôme Vidal et Christine Vivier, Paris, Éditions Amsterdam.
Ciccone, Albert et Alain Ferrant (2009), Honte, culpabilité et traumatisme, Paris, Dunod.
Cyrulnik, Boris (2012), Mourir de dire, Paris, Odile Jacob.
Despentes, Virginie (2007), King Kong théorie, Paris, Le livre de poche.
Didi-Huberman, Georges (2023), Brouillards de peines et de désirs, Paris, Les Éditions de Minuit.
-------- (2013), Quelle émotion! Quelle émotion? Paris, Bayard Éditions.
Dolezal, Luna (2016), « Body Shame and Female Experience”, dans Hilge Landweer et Isabella Marcinski (dir.), Dem Erleben Auf Der Spur: Feminismus und Phänomenologie / Discovering Lived Experience: Feminism and Phenomenology, Transcript Press, p. 45-67.
Elster, Jon (1995), « Rationalité, émotions et normes sociales », dans Patricia Paperman et Ruwen Ogien (dir.), La couleur des pensées. Sentiments, émotions, intentions, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, p. 33-64.
Eribon, Didier (2013), La Société comme verdict. Classes, identités, trajectoires, Paris, Fayard.
Federici, Silvia (2020), Par-delà les frontières du corps, Paris, Éditions Divergences.
Fournier, Lauren, Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism, Cambridge, MIT Press, 2022, 320 p.
Gaulejac, Vincent de (2008 [1996]), Sources de la honte. Paris, Desclée de Brouwer.
Gregg, Melissa et Gregory J. Seigworth (2010), The Affect Theory of Reader, Durham, Duck University Press.
Gros, Frédéric (2021), La honte est un sentiment révolutionnaire, Paris Albin Michel.
Janin, C., (2007), La honte, ses figures et ses destins, Paris, Presses Universitaires de France.
-------- (2003), « Pour une théorie psychanalytique de la honte (honte originaire, honte des origines, origines de la honte) », Revue française de psychanalyse, Paris, PUF, vol. 67, p. 1657-1742.
Johnson, Erica A et Patricia Moran (2013), The Female Face of Shame, Bloomington, Indiana University Press.
Lafontaine, Marie-Pier (2022), Armer la rage. Pour une littérature de combat, Montréal Héliotrope.
Lehtinen, Ullaliina (1998), « How Does Know What Shame Is? Epistemology, Emotions and Forms of Life in Juxtaposition”, Hypatia, vol. 13, no 1, p. 56-77.
Lévinas, Emmanuel (1994), « Une éthique de la souffrance », dans Jean-Marie von Kaenel (dir.), Souffrances. Corps et âme, épreuves partagées, Paris, Éditions Autrement, p. 127-137.
Martin, Jean-Pierre (2017), La honte : réflexions sur la littérature, Paris, Éditions Gallimard.
Massimi, Brian (2015), Politics of affect, Cambridge, Polity Press.
Montandon, Cléopâtre (1982), « Un mécanisme de contrôle social. La honte. Analyse d’un concept négligé », Revue européenne des sciences sociales, tome 20, no 62, p. 23-61.
Nathanson Donald L. (1992), Shame and pride. Affect, sex and the birth of the self, New York, W. W. Norton & Company.
Ogien, Ruwen (2005), Pourquoi tant de honte? Paris, Éditions Pleins Feux,
-------- (2002), La honte est-elle immorale? Paris, Bayard.
Paperman, Patricia et Ruwen Ogien (dir.) (1995), La couleur des pensées. Sentiments, émotions, intentions, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Papillon, Joëlle. 2023. « Autothéorie ». In Emmanuel Bouju, éd. Nouveaux fragments d’un discours théorique. Un lexique littéraire. Québec : Codicille. https://codicille.pubpub.org/pub/papillon-autotheorie/release/1 [10.03.2025].
Probyn, Elspeth (2010), « Writing shame », dans Melissa Gregg et Gregory J. Seigworth (2010), The Affect Theory of Reader, Durham, Duck University Press, p. 71-90.
-------- (2015), Blush: Faces of Shame, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Preciado, Paul B. (2008), Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle.
Sartre, Jean-Paul (1995 [1939]), Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Hermann.
Thorgeirsdottir, Sigridur (2020), « Shame, Vulnerability and Philosophical Thinking », Sophia, no 59 (1), p. 5-17.
Tisseron, Serge (2010), Ces désirs qui nous font honte. Désirer, souhaiter, agir : le risque de la confusion, Bruxelles, Éditions Faber.
(2006), « De la honte qui tue à la honte qui sauve », Eres, no 184, p. 18-31.
-------- (1992), La honte, psychanalyse d’un lien social. Paris, Dunod.