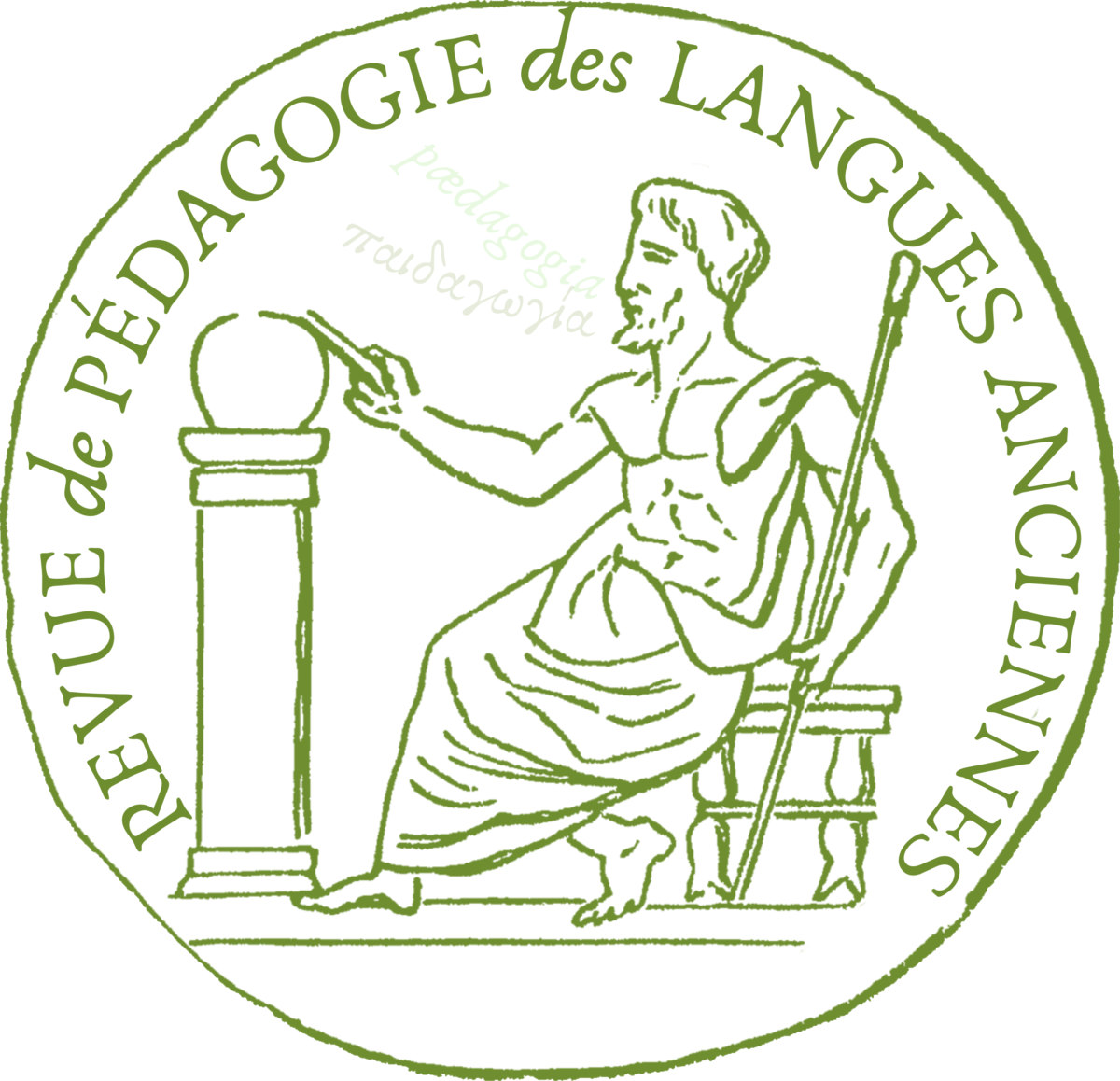
L'image en cours de langues et cultures de l'Antiquité (Revue de pédagogie des langues anciennes)
Revue de pédagogie des langues anciennes, n°4
« L’image en cours de Langues et Cultures de l’Antiquité »
Le quatrième numéro de la Revue de pédagogie des langues anciennes comportera un dossier thématique intitulé « L’image en cours de Langues et Cultures de l’Antiquité ». Il est également possible de proposer des contributions sur d’autres sujets qui prendront place dans une section intitulée Varia.
Présentation du thème principal de ce numéro :
Le recours à l’image dans le cours de LCA repose sur un paradoxe. Bien qu’il semble aller de soi et faire partie des pratiques enseignantes de convoquer et d’utiliser des images, aucune recherche didactique d’ampleur n’est cependant consacrée spécifiquement à l’image[1], contrairement à la lecture, la traduction, le lexique, l’accès aux textes littéraires, l’écriture… Les ressources proposées aux enseignants font certes la part belle à l’image, sans qu’elle soit cependant abordée dans sa dimension didactique : on en trouve de nombreux exemples sur Odysseum[2].
L’utilisation la plus courante de l’image en cours de Langues et Cultures de l’Antiquité consiste à l’étudier en ouverture ou prolongement de l’étude d’un texte, dans une perspective proche de l’Histoire des arts. Cet aspect est d’ailleurs le seul présent dans les programmes de lycée de 2019[3]. Quant aux programmes de collège de 2016, toujours d’actualité, ils ne mentionnent qu’une seule fois le mot image (« Analyse propédeutique de corpus de textes et/ou d’images pour faciliter l’entrée dans le texte d’étude en langue ancienne »).
Si cette perspective somme toute classique a naturellement son intérêt, le projet de programme de LCA de 2025 pour le Collège[4] donne en revanche à l’image une place qui suppose un réel questionnement didactique : la lecture d’image est ainsi devenue une sous-entrée de la compétence Lire, comprendre, traduire, interpréter : « Lire, comprendre et interpréter des textes, des images et des documents ». De plus, le mot image est convoqué à plusieurs reprises dans des objectifs et des situations d’apprentissage explicites :
- L’élève doit être capable de « mobiliser ses connaissances et s’appuyer sur ses émotions pour interpréter des images […] en lien avec les textes antiques ».
- « [L’élève] identifie les cas auxquels [les formes nominales] sont employées grâce à : […] des images favorisant la compréhension de la notion de nombre ».
- « Il manipule les groupes syntaxiques grâce à […] la description d’images, notamment d’œuvres d’art, de cartes géographiques, d’affiches de film, de premières de couverture, etc. ».
- « Il remobilise le lexique acquis pour nommer ou décrire un document iconographique (images, cartes, affiches) ».
Dans une autre perspective, étudier différents types d’images, fixes et animées, en cours de LCA, permet d’éduquer nos élèves aux médias. La recherche actuelle s’intéresse également de près aux lectures de l’Antiquité opérées par les médias modernes. On peut citer par exemple le colloque « Immortel péplum. Présences et renouvellements d’un genre transmédiatique » (Nîmes Université et musée de la Romanité, février 2025)[5]. Or, les croisements avec l’éducation aux médias et à l’information sont explicitement mentionnés dans ce projet de programme[6].
Un rapide tour d’horizon montre l’omniprésence de l’image dans nos pratiques pédagogiques en cours de langues anciennes.
La nature de l’image peut être variée :
- témoignages des traces laissées par l’Antiquité : photographies de ruines, de monuments et bâtiments, de statues, de mosaïques, de pièces de monnaie, de graffitis… ;
- créations artistiques postérieures inspirées de manière plus ou moins directe par l’Antiquité : reconstitutions, représentations d’anastyloses, mais aussi bandes dessinées, tableaux, fresques, dessins, gravures, tapisseries… ;
- images fixes (notamment les photogrammes) ;
- images mobiles : documentaires, clips vidéos, extraits de séries ou de films.
Plusieurs fonctions peuvent être accordées à l’image. Elle peut être étudiée en tant que telle (tout particulièrement dans une démarche d’histoire des arts) ou comme illustration et support plus ou moins direct (d’un texte, d’une séance, d’une notion…). À cet égard, l’image permet aussi d’aborder des textes sans traduction dans le cadre de méthodes actives d’apprentissage des langues anciennes (Lingua Latina per se illustrata, Logos…).
L’image est aussi parfois créée par les élèves (cartes mentales, schémas de scènes de batailles, storyboards de textes narratifs, créations iconographiques ou plastiques faisant écho à des éléments culturels travaillés en cours…), plus fréquemment par les enseignants, notamment grâce aux outils de génération d’images par intelligence artificielle.
L’ambition de ce numéro est donc de dresser un panorama, le plus large possible, des diverses utilisations de l’image en cours de LCA et d’ouvrir les perspectives, les plus vastes possibles, à nos lecteurs et lectrices.
—
Bibliographie et sitographie indicatives :
· AUMONT, Jacques & MARIE, Michel, L’analyse des films, coll. Cinéma & visuel, Armand Colin, 4e éd., 2020.
· ARASSE, Daniel, Le détail, Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion, 1992.
· BARTHES, Roland, « Rhétorique de l’image », in Communications, 1964, p. 40-61 [en ligne] : disponible sur : https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1964_num_4_1_1027 (consulté le 04 octobre 2025).
· ECO, Umberto, « Sémiologie des messages visuels », in Communications, 1970, p. 11-51 [en ligne] : disponible sur : https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1970_num_15_1_1213 (consulté le 04 octobre 2025).
· JOLY Martine, L'image et son interprétation, Armand Colin, 2005.
· JOLY Martine, Introduction à l'analyse de l'image, Armand Colin, 3e éd., 2015.
· MULLER, Catherine, « L’image en didactique des langues et des cultures : une thématique de recherche ancienne remise au goût du jour », in Synergies Portugal n° 2, 2014, p. 199-130 [en ligne] : disponible sur : https://gerflint.fr/Base/Portugal2/muller.pdf (consulté le 04 octobre 2025).
· MUTH Susanne, NEER Richard, ROUVERET Agnès, WEBB Ruth, « Texte et image dans l’Antiquité : lire, voir et percevoir », Perspective 2, 2012, 219-236.
· SQUIRRE Michael, Image and Text in Graeco-Roman Antiquity, Cambridge, 2009, notamment p. 15-89.
—
Modalités de soumission :
Quelques recommandations pour la rédaction des articles, qu’ils soient ou non en lien avec le dossier thématique :
Les articles pourront aussi bien être la description et l’analyse d’une expérience pédagogique que des travaux de recherches théoriques ou des comptes-rendus de recherches (cf. ligne éditoriale de la revue).
Pour la description et l’analyse d’expériences pédagogiques, on peut envisager les questions suivantes :
— Pourquoi le choix d’une image (et de cette image particulière) a-t-il été privilégié dans cette activité ?
— Pourquoi le choix d’un support iconographique précis, ou pourquoi le choix d’un ensemble de supports, qu’ils soient de type identique (ex : fresques, ou vases), ou de type différent (ex : mise en parallèle d’un vase et d’une peinture murale) ?
— Quels étaient les objectifs visés, la méthodologie suivie ?
— Qu’est-ce qui est en jeu dans ce type d’activité, de pratique ?
— Quels ont été les éventuels obstacles rencontrés ?
— Quels sont les résultats effectifs ?
— Quel retour sur expérience ?
— Quelles seraient les pistes pour favoriser le transfert à d’autres niveaux ?
—
Consignes pratiques :
— Longueur de la contribution : 50 000 caractères maximum, espaces et notes comprises (c’est-à-dire environ 15 pages dactylographiées suivant nos normes typographiques.
— Normes typographiques et bibliographiques accessibles sur le site de la revue.
— Délai : pour ce numéro, les propositions de contributions sont attendues dès que possible et jusqu’au 4 mai 2026. Les articles sont destinés à une publication en ligne, sur le site de la revue, au fur et à mesure de leur validation par le comité de lecture puis de leur édition par le comité de rédaction.
Pour toute question et pour l’envoi des contributions, contacter : pedagogie-langues-anciennes@mailo.com
—
Notes:
[1] Comme contre-exemple, on peut citer la journée d’études Images, mythologie et enseignements de l’académie de Lille.
[2] Cf. https://odysseum.eduscol.education.fr/ressources-cycle-4 (section « Étude de l’image, histoire des arts »), https://odysseum.eduscol.education.fr/une-image-une-histoire, https://odysseum.eduscol.education.fr/search?keys=film…
[3] EDUSCOL, Programme de littérature et langues et cultures de l’Antiquité de terminale générale, « Littérature, civilisation, culture, histoire », p.4 : « Aussi souvent que possible, ils ouvrent des perspectives culturelles en faisant appel à toutes les formes d’expression artistique (peinture, sculpture, musique, cinéma, bande dessinée…), aux ressources du numérique, aux visites – réelles ou virtuelles – de grands musées nationaux et internationaux comme de grands sites mondiaux du patrimoine antique. »
[4] Projet de programme de Langues et cultures de l’Antiquité du cycle 4 (mai 2025) ; disponible sur : https://www.education.gouv.fr/media/227322/download (consulté le 04 octobre 2025).
[5] Antiquipop – l’Antiquité dans la culture populaire ; disponible sur : https://antiquipop.hypotheses.org/16626 (consulté le 04 octobre 2025).
[6] Projet de programme de Langues et Cultures de l’Antiquité du cycle 4 (mai 2025), « Acquérir des éléments de culture littéraire, historique et artistique », p.15 : « La dernière entrée, “Héritages, dialogues et écarts” offre aux enseignants un cadre pour mener avec leurs élèves un projet qui articule Antiquité, latine comme grecque, et monde moderne. Destiné à favoriser le dialogue entre l’étude des langues et cultures de l’Antiquité et l’ensemble du parcours scolaire des élèves, ce projet s’inscrit dans l’une des éducations transversales (éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité, éducation aux médias et à l’information, éducation au développement durable, etc.) ».