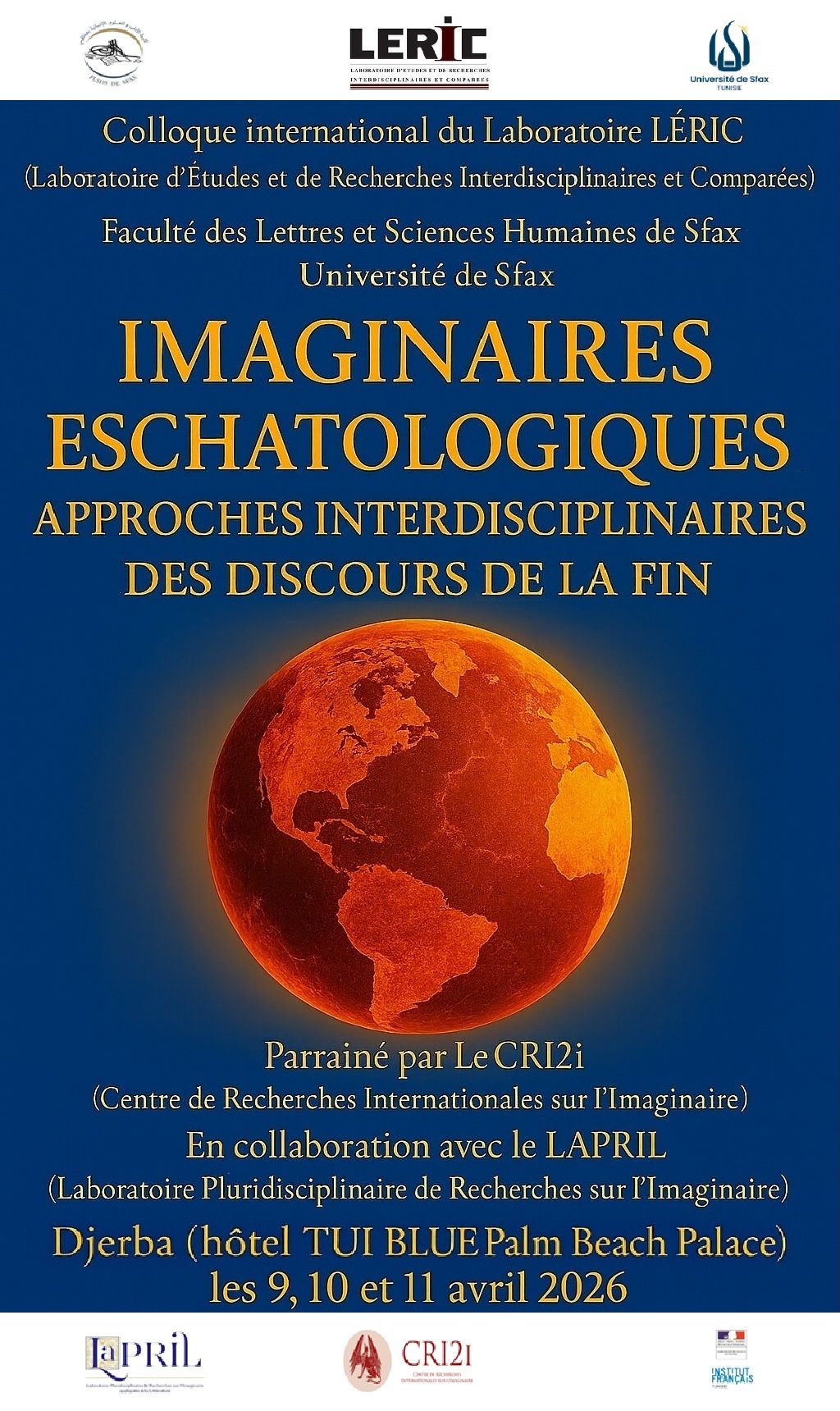
Imaginaires eschatologiques : approches interdisciplinaires des discours de la fin (Djerba, Tunisie)
Colloque international du Laboratoire LÉRIC
(Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires et Comparées)
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax – Université de Sfax
Imaginaires eschatologiques : approches interdisciplinaires des discours de la fin
Parrainé par Le CRI2i
(Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire)
En collaboration avec le LAPRIL
(Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l’Imaginaire) de l’Université Bordeaux Montaigne
Djerba (hôtel TUI BLUE Palm Beach Palace), les 9, 10 et 11 avril 2026
—
Un quart de siècle après l’an 2000, l’idée de la fin des temps – voire celle de la fin du monde – n’a rien perdu de son acuité, attisant une inquiétude qui ne cesse de croître. Une inquiétude qui, loin d’être l’apanage de la modernité, ravive une longue tradition eschatologique où la fin se donne à voir comme une phase amalgamant révélation et destruction. Le temps, tel qu’il est perçu par les sociétés et les cultures, esquisse les contours de cette inquiétude qui s’impose à la conscience humaine. Dans les traditions monothéistes, le temps est linéaire, tendu vers une fin rédemptrice. À l’inverse, de la cosmologie chinoise à celle grecque, en passant par les traditions indienne et bouddhique, le temps revêt un caractère cyclique : la fin y précède un nouveau commencement, chaque disparition prépare un retour. Cette polarité dans la représentation du temps empêche de penser la fin comme une simple clôture. Elle devient seuil, métamorphose, prélude à un recommencement ; elle se fait pluralité appelant à distinguer deux figures : la fin définitive – associée à la mort, à l’effacement, au néant – et la fin médiatrice, qui se lit en termes de déclin, de crise et de renaissance. Cette distinction commande depuis l’Antiquité la pensée occidentale : Vico conçoit l’histoire comme une alternance de progrès et de décadences, tandis que Hegel, dans sa dialectique, fait de la fin le moteur du devenir. Dans cette double figuration du temps, la disparition ne constitue jamais une pure négation ; elle prépare, au contraire, l’avènement d’un nouvel ordre du monde.
À travers ces configurations religieuses et culturelles, transparaît l’influence profonde des imaginaires temporels sur le regard que l’homme porte sur lui-même et sur le monde qui l’entoure. Tout semble indiquer que l’histoire humaine se joue dans une oscillation constante entre emprise sur le monde et vulnérabilité face à ses lois profondes. Le paradoxe prométhéen – celui d’une création en dialogue constant avec sa propre ruine – traverse les siècles et trouve dans notre contemporanéité technologique son paroxysme : une époque fascinée par l’ultime, qui s’acharne à précipiter sa propre disparition. Penser la fin, c’est dès lors interroger la temporalité, la condition humaine et le devenir collectif – entre apocalypse et renaissance, entre épuisement du monde et promesse d’un nouveau commencement.
Les discours actuels sur l’effondrement des civilisations, des modèles économiques et des équilibres géopolitiques s’inscrivent dans cette tension entre constat et projection – la fin annoncée de la mondialisation en étant l’un des emblèmes. Ces récits traduisent une inquiétude protéiforme, qui traverse les champs de la pensée et vient ébranler, entre autres, les fondements mêmes de l’enseignement. La généralisation des cours à distance durant la pandémie a mis en cause les modalités de transmission et les formes de médiation, révélant une crise amplifiée par l’irruption de l’intelligence artificielle. Plus largement, on peut s’interroger sur le risque que cet imaginaire façonné par la machine fasse peu à peu reculer, voire disparaître, la part proprement humaine de notre imagination.
Dans ce climat de perplexité où le progrès technoscientifique se fait menace, et où les crises médicales, écologiques et planétaires laissent entrevoir l’image d’un monde au bord d’un basculement catabatique, nous proposons d’interroger la notion de fin, en la replaçant au cœur des questionnements contemporains. Il s’agit d’en examiner les multiples manifestations – historiques, idéologiques, philosophiques, culturelles – et d’en observer les prolongements sensibles dans la littérature et dans les arts. Bertrand Gervais a bien résumé cette prolifération des discours de la fin : « Quand ce n’est pas l’histoire ou les idéologies qui sont réputées finies, c’est la littérature ou le roman, la musique, la peinture, le livre ou l’imprimé, la culture, l’auteur qui sont déclarés morts, après l’homme, après Dieu.[1]» Ces déclarations répétées de la fin ne traduisent pourtant pas une disparition pure et simple. Elles signalent, au contraire, un moment de basculement : la persistance de formes anciennes qui se réinventent et se relisent à la lumière des enjeux actuels. On pourrait y voir les signes d’une mutation profonde, d’un déplacement des repères symboliques, à l’instant même où la modernité semble atteindre son point culminant. Jean-Jacques Wunenburger offre une clé de lecture précieuse en rappelant que « l’apogée apparaît une catégorie usuelle très opératoire qui permet de découper les parcours spatio-temporels selon deux phases montantes et déclinantes, proches de l’expérience ordinaire du monde.[2] » L’apogée, conçue comme ce seuil fragile entre l’accomplissement et le déclin, marque le passage d’un ordre à un autre. Dans ce mouvement, chaque « fin » ouvre paradoxalement sur un recommencement, selon une logique cyclique que de nombreuses traditions – de l’Inde ancienne à la Grèce classique – ont conçue comme la respiration même du cosmos.
L’écologie, à elle seule, donne à voir un monde au bord de l’effondrement, et participe pleinement à l’installation d’un discours marqué par l’urgence, l’alerte et la crainte d’un seuil irréversible. Les atteintes environnementales majeures se présentent comme les prodromes d’un basculement global, susceptible de transformer en profondeur notre manière d’imaginer l’avenir. Pourtant, les discours catastrophistes, loin de se réduire à une anticipation pessimiste, exercent une action performative sur le présent. Leur ambivalence réside dans leur capacité à exprimer simultanément l’angoisse d’un monde en crise et l’espérance d’un recommencement. Ils ouvrent ainsi un espace de projection où l’effondrement, paradoxalement, devient la condition d’une renaissance. Rejouant le grand mythe de la régénération, ces discours figurent la mort pour mieux en annoncer le dépassement.
La fin ne se présente donc plus seulement comme un horizon métaphysique ou religieux, mais comme une réalité tangible, déjà inscrite dans la trame du présent. Elle mobilise nos émotions, en particulier celles liées à l’angoisse, et nous exhorte à la réflexion comme à l’action. Face au tumulte du monde, elle agit comme un repère dans le vertige, permettant à l’imaginaire d’assumer une fonction à la fois herméneutique et thérapeutique face à l’incertitude qui domine les esprits.
Ce colloque entend ainsi interroger la diversité des formes et des significations que revêtent aujourd’hui les discours de la fin, à la lumière des grandes conceptions du temps et de leurs transformations historiques. Il s’agira d’articuler l’évolution des représentations eschatologiques aux mutations contemporaines des imaginaires collectifs, en examinant notamment leur portée utopique. Dans les périodes de crise, les discours ne se contentent pas de traduire les bouleversements : ils les accompagnent, les amplifient et participent parfois à leur orientation. Certains cherchent à préserver un ordre existant, d’autres contestent ses fondements ou ouvrent des perspectives vers un avenir possible. C’est dans cette tension entre clôture et recommencement que les imaginaires eschatologiques trouvent leur véritable force, en faisant de la fin non pas une disparition, mais un passage, une médiation, une promesse de transformation. L’utopie, envisagée sous cet angle, ne relève pas seulement du rêve social ou politique. Elle s’inscrit souvent en continuité avec les récits de la fin, comme réponse à la crise et comme projection d’un horizon de renouveau. Héritière des structures eschatologiques – attente, révélation, renversement –, elle les transpose dans l’histoire et leur confère une dimension temporelle et collective. L’utopie messianico-révolutionnaire, incarnée par des figures de rédemption, établit un lien entre l’idéal et l’action, orientant l’espérance vers un avenir en construction. Jean-Jacques Wunenburger rappelle à ce propos que « le millénarisme […] a ainsi souvent exercé, depuis le Moyen Âge, une puissante attraction sur l’utopie, qui s’est vue, à travers lui, embrayée sur l’histoire révolutionnaire [3]».
Cette thématique appelle des regards multiples, issus de la littérature, de la philosophie, de l’histoire, des sciences sociales, des études religieuses, anthropologiques, culturelles ou didactiques. Elle invite à croiser les œuvres, qu’elles soient artistiques, médiatiques ou théoriques, pour nourrir une réflexion commune.
Au cœur de cette démarche : une interrogation sur la manière dont les sociétés contemporaines pensent la fin – ou leur propre fin – dans un monde où chaque effondrement semble contenir, en creux, la promesse d’un recommencement.
Les problématiques explorées dans ce colloque s’organisent principalement autour des axes suivants :
1- Origines et formations des imaginaires eschatologiques
En amont des systèmes philosophiques, ce sont les récits mythiques et les textes sacrés qui ont façonné les imaginaires de la fin. En conjuguant destruction et renaissance, ces récits traduisent des visions du temps et de la condition humaine propres à chaque culture. Cet axe propose d’explorer les figures, les croyances et les narrations qui ont circulé dans diverses sociétés autour de la fin des mondes, du jugement dernier ou de la métamorphose ultime. Il ne s’attache ni à une époque ni à une aire culturelle en particulier, mais cherche à saisir les déplacements de ces représentations à travers les contextes historiques, politiques et symboliques.
2- Imaginaires eschatologiques, art et création littéraire
Les imaginaires de la fin ressurgissent dans les moments de crise, porteurs à la fois d’effroi et de désir de recommencement. Ils traversent les formes artistiques et littéraires, se déclinant en visions mystiques, récits tragiques, fictions anticipatives ou critiques des dérives contemporaines. Dans les arts visuels, la ruine devient un motif récurrent, entre mémoire des civilisations disparues et beauté fragile des vestiges. Le cinéma, lui, explore souvent la fin comme seuil, comme vacillement du sens, mais aussi comme lieu d’une espérance possible. La littérature, de son côté, interroge la chute et ses prolongements : elle met en scène des mondes en décomposition, des sociétés en mutation, des subjectivités en quête de sens. La dystopie y devient outil de lucidité, révélant les tensions d’un monde menacé par la perte, la domination ou l’effacement. Cet axe propose d’examiner comment les artistes et les écrivains donnent forme à la fin – non comme terme, mais comme passage. Derrière les figures d’apocalypse, c’est souvent une question plus intime qui affleure : comment continuer à vivre, à créer, à croire, dans un monde en transformation ?
3- Ruines, sépultures et mémoire : penser la fin des cités antiques entre histoire, archéologie et anthropologie
Dans la pensée antique, la disparition des cités relève autant du drame que du symbole. Les textes historiques et poétiques ne cessent de rejouer la scène de leur effondrement – remparts brisés, sanctuaires souillés, peuples effacés – non pour en consigner les faits, mais pour interroger la logique des fins. Cette attirance pour la ruine s’incarne d’abord dans le destin de Troie, matrice fondatrice des destructions à venir. Troie ne se réduit pas à une ville perdue : elle devient le point d’origine d’un autre récit, celui d’Énée et de Rome. La ruine, ici, clôt un cycle pour en faire naître un autre. Les Anciens ont souvent pensé la destruction comme une étape du renouveau. La ville anéantie n’est pas effacée : elle survit dans la mémoire, dans les chants, dans les pierres mêmes qui demeurent. Ces traces transforment l’effondrement en héritage et font de la ruine un lieu où s’enracine l’identité collective. Détruire, c’est aussi transmettre, paradoxalement.
Dans cette perspective, les pratiques funéraires s’imposent comme des actes fondateurs. Elles ne sont pas seulement des gestes de survie ou de désespoir face à la destruction : dans la plupart des civilisations, elles relèvent d’un ordre rituel stable, associé à une conception spirituelle de la mort comme passage vers une autre vie. L’ensevelissement, la crémation, les offrandes ou les repas rituels participent d’une pensée de la continuité : la mort n’y marque pas la fin, mais un départ, une transition vers un autre plan d’existence. Ce rapport ordonné à la mort se trouve toutefois bouleversé dans les contextes de guerre et de ruine. Lorsque la cité s’effondre, les rites se désagrègent : les morts sont jetés dans des fosses communes, privés de sépulture individuelle et de toute médiation symbolique. Le chaos efface les gestes du sacré. La chute d’une cité ne signifie pas seulement la disparition de ses pierres ou de ses monuments ; elle brise aussi le fil qui reliait les vivants à leurs morts, en effaçant les gestes qui donnaient sens au souvenir.
Penser les ruines antiques, c’est alors se demander comment les civilisations ont donné forme à la fin, comment elles ont su inscrire la perte dans une trame symbolique ou rituelle capable d’en préserver la mémoire. Comment ont-elles transformé l’effondrement en récit fondateur ? Et comment ont-elles, malgré la destruction, tenté de préserver le geste rituel comme ultime résistance face à la disparition ? Ces questions dépassent le seul cadre de l’Antiquité. Elles rappellent combien la mémoire des ruines, des sépultures et des renaissances habite encore nos imaginaires contemporains.
4- Les eschatologies modernes : post-humanisme, transhumanisme et collapsologie :
L’aggravation de la crise écologique révèle une transformation profonde des récits apocalyptiques, qui se fondent désormais sur des données scientifiques et des éléments techniques. L’apocalypse contemporaine devient un scénario plausible, nourri par les sciences du climat, les données écologiques et les technologies. Par-delà les scénarios environnementaux catastrophiques, la conquête spatiale et les aspirations transhumanistes participent également à la redéfinition de nos imaginaires du futur. L’imaginaire eschatologique se rationalise, se densifie, et s’inscrit dans une logique de preuve – modifiant en profondeur notre manière d’envisager l’avenir. Cet axe invite à interroger la manière dont ces visions contemporaines, nourries par les sciences, la technologie de pointe, la philosophie environnementale et la science-fiction, prennent forme. Il s’agit également d’examiner l’évolution des conceptions traditionnelles de l’apocalypse face aux enjeux actuels, tout en réfléchissant sur les théories modernes qui envisagent la fin et une possible renaissance de la civilisation, afin de repenser l’avenir autrement.
5- Figures du désenchantement contemporain : reconfigurations des imaginaires post-historiques :
Depuis la chute des grands blocs idéologiques, certains ont voulu voir dans le modèle démocratique occidental l’aboutissement de l’histoire politique. Mais cette prétendue clôture révèle surtout les fragilités d’une époque désenchantée en quête de repères et de sens. Les tensions identitaires, le retour des croyances, l’émergence de nouveaux conflits et la montée des populismes viennent sans cesse en contester l’évidence. Cet axe propose d’interroger les représentations littéraires, philosophiques et médiatiques d’un présent qui se pense comme « après-historique ». Figures de l’attente, de l’immobilité, du désœuvrement : ces imaginaires mettent en question notre manière d’habiter le temps, et invitent à penser les formes possibles d’un avenir à réinventer.
6- Du déclin de la didactique à la reconfiguration de l’apprentissage : vers de nouveaux imaginaires pédagogiques :
L’essor de l’enseignement à distance et des cours en ligne a, certes, bouleversé les fondements de la pédagogie ; mais c’est peut-être l’intelligence artificielle qui va sceller le destin d’un mode éducatif ne correspondant plus aux attentes et aux réalités de la société actuelle. Nous assistons en effet au déclin d’un enseignement fondé longtemps sur la présence physique, la transmission vivante de l’enseignant et l’évaluation cyclique. La montée d’une logique d’apprentissage à la demande qui accompagne l’avènement de l’intelligence artificielle semble reconfigurer les finalités mêmes de l’apprentissage. Et c’est surtout la figure de l’enseignant – longtemps perçu comme référent pédagogique – qui se trouve ébranlé. Aujourd’hui, ce qui gagne du terrain c’est plutôt un apprentissage plus horizontal, personnalisé et autogéré. Cet axe invite à interroger les représentations et les discours qui accompagnent le déclin annoncé de la didactique et de l’apprentissage, à mesure que la technologie gouverne le paysage de l’enseignement. Que devient l’imaginaire lorsque l’enseignement se trouve privé de la transmission vivante et du lien intersubjectif qui fondait l’expérience pédagogique ? Nous souhaiterions réfléchir sur les mutations qui traversent le champ éducatif, ainsi que sur les résistances qu’elles suscitent.
—
Principales échéances et droits d’inscription
Les propositions définitives de communication (titre, résumé – une vingtaine de lignes –, 5 mots clefs) seront accompagnées d’une courte notice bibliographique et envoyées au plus tard le 20 février 2026 aux adresses suivantes :
1er mars 2026 : notification de la liste des communications acceptées.
Un droit d’inscription forfaitaire de :
350 € sera demandé aux participants étrangers. Ce droit d’inscription inclut :
le programme du colloque ;
les pauses-café ;
l’hébergement en chambre demi-double, en formule pension complète, pour une durée de quatre nuitées.
700 DT sera demandé aux participants locaux. Ce droit d’inscription inclut :
le programme du colloque ;
les pauses-café ;
l’hébergement en chambre demi-double, en formule pension complète pour une durée de trois nuitées.
Frais de participation (hors hébergement) : 250 TND. Ce tarif inclut les pauses-café et le déjeuner.
Les frais de déplacement restent à la charge des participants.
—
Comité scientifique
Jean-Jacques Wunenburger (CRI2i, Université Jean Moulin Lyon 3, France)
Abdelwahed Mokni (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Corin Braga (CRI2i, Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie)
Ali Toumi Abassi (Université de la Manouba, Tunisie)
Ana Tais Martins Portanova Barros (CRI2i, Universidade do Rio Grande do Sul, Brésil)
Mohamed Jerbi (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Anna Caiozzo (CRI2i, Université de Paris VII, France)
Hédia Abdelkefi (Université Tunis El Manar, Tunisie)
Hugo Bauzà (CRI2i, Universita degli Studi dell’Insubria, Argentine)
Blanca Solares (UNAM, Mexique)
Paolo Bellini (CRI2i, Università degli Studi dell’Insubria, Italie)
Géraldine Puccini (LAPRIL, Université Bordeaux-Montaigne, France)
Mercedes Montero (CRI2i, Universidad de granada, Espagne)
Elisabeth Magne (LAPRIL, Université Bordeaux-Montaigne, France)
Véronique Adam (CRI2i, Université Toulouse II, France),
Renato Boccali (CRI2i, Chaire UNESCO – IULM Milan, Italie)
Joël Thomas (CRI2i, Université de Perpignan, France)
Gisèle Vanhese (CRI2i, Università della Calabria, Italie)
Philippe Walter (CRI2i, Université Stendhal, Grenoble 3, France)
Basarab Nicolescu (CRI2i, Romanian Academy, Roumanie)
Salem Mokni (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Hichem Ismail (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Comité d’organisation
Mouna Sessi (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Wafa Elloumi Nasri (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Faten Masmoudi (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Salem Mokni (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Hichem Ismail (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie)
Coordinateurs du colloque
Salem Mokni
Hichem Ismail
[1] « En quête de signes : de l’imaginaire de la fin à la culture apocalyptique », Société n° 84, Édition De Boeck Supérieur, 2004/2, p.13.
[2] « Les rythmes du temps, Pathos et Logos de l’Apogée », L’Apogée, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. Eidôlon, 2005, p. 9.
[3] « L’utopie, variations autour d’un mot », Les utopies, édité par Éric Letonturier, CNRS Éditions, 2013, p. 45.