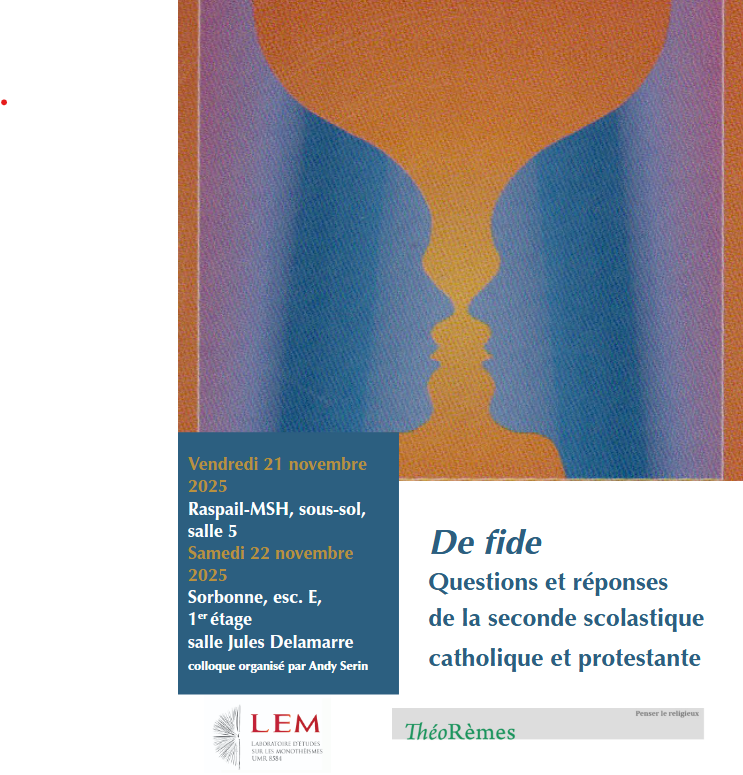
Dans un article fameux où il s’intéresse aux mutations intellectuelles de la foi et de la croyance qui s’opèrent du Moyen-Âge à la Modernité, Jean Wirth avait souligné le fait que « la fides perd sa spécificité épistémologique ». Comme il l’avait expliqué, la fides médiévale, celle dont la scolastique du XIIe-XIIIe siècles parachève l’élaboration théologique, s’était auparavant elle-même épistémologiquement distinguée de la fides du latin classique et de l’Antiquité. Dans un paradigme épistémologique qui la situe entre deux extrêmes, l’opinio et la scientia, la fides du christianisme médiéval s’est caractérisée par l’attribution d’une propriété aléthique exclusiviste à portée sotériologique : l’adhésion à la vérité, unique et donc universelle, est condition nécessaire du salut. À cela s’ajoute la construction théologico-cléricale de la fides explicita/implicita du xiiie siècle, laquelle allège certes le contenu de ce qui peut être demandé de croire aux « simples », mais aussi consacre le monopole et l’autorité de l’institution ecclésiale en matière religieuse : la foi repose sur une confiance (fiducia) en l’Église qui en est la garante. Qu’est-ce alors qui caractérise la fides moderne ? Outre que la « fides a perdu son rapport nécessaire à la vérité, parce que ce rapport n’était plus garanti par les pratiques sociales et par une hiérarchie homogène », Wirth, en s’appuyant sur Pascal, met en lumière un certain divorce de la foi et de la croyance : la première entendue comme la transcendance de la vérité par un don divin face à la seconde de plus en plus utilisée pour qualifier péjorativement la religion des autres.
Au fil de la riche étude de Wirth qui en vient à souligner le rôle de l’humanisme, de la Réforme et même de la tradition du scepticisme moderne, notamment avec Montaigne, on peut se demander ce qu’il en a été de la seconde scolastique. En effet, celle-ci est loin d’avoir été un acteur secondaire dans la production intellectuelle de l’époque moderne. Selon Rafael Ramis Barceló, cette catégorie historiographique vise à désigner l’« expression de la pensée scolaire catholique de l’époque moderne (xvie-xviiie siècles) », s’étant développée en écoles et sous-écoles qui se livraient à des débats ad intra (entre thomistes par exemple) et ad extra (des thomistes avec les scotistes, nominalistes, jésuites, etc.) au sein d’un paradigme épistémologique commun. Ce qui définit la seconde scolastique, poursuit Barceló, c’est avant tout sa « catholicité » : en se posant dans la continuité de la première scolastique, le travail de la seconde scolastique ne s’est toutefois pas limité à une simple répétition, mais plutôt à une reconsidération et adaptation de l’héritage scolastique, voire à la modification et au dépassement de celui-ci, afin de résoudre les diverses crises auxquelles s’est heurtée la scolastique médiévale surtout à partir du xve siècle, e.g. nominalisme, humanisme, Réforme, sans oublier les Grandes Découvertes. Notons qu’il existe pourtant une seconde scolastique « protestante » qui se pense elle aussi dans un rapport avec la scolastique médiévale. L’hypothèse de travail de ce colloque est que la seconde scolastique ne se fait pas le dernier bastion de la fides médiévale et ainsi une force réactionnaire à l’émergence de la foi moderne, communément et spontanément entendue aujourd’hui au sens de la croyance personnelle et intériorisée, mais que la seconde scolastique (catholique et protestante) a pu elle aussi contribuer « positivement » à la mutation de la foi.
Programme:
Vendredi 21 novembre 2025 : salle 5 à Raspail-MSH
14h : Accueil des participants
14h15 : Ouverture du colloque par Andy Serin
Session 1 : Seconde scolastique protestante. Présidence: Hubert Bost (EPHE-PSL, LEM)
14h30 : Ueli Zahnd (Université de Genève, Institut d’histoire de la réformation): « Scolastique et anti-scolastique au début de l'orthodoxie protestante : le De fide de Castellion et ses antipodes »
15h : discussion
15h15 : Pierre-Olivier Léchot (Institut protestant de théologie): « La foi dans la haute scolastique protestante : l’exemple de François Turrettini (1623-1687) »
15h45 : discussion
16h : pause café
16h30 : Andy Serin (EPHE-PSL, LEM), « De fide justificante chez William Ames, un scolastique puritain »
17h : discussion
Samedi 22 novembre 2025 : salle Jules Delamarre à la Sorbonne
Session 2 : Seconde scolastique catholique. Présidence: Marco Toste (University of Coimbra)
9h : Christophe Grellard (EPHE-PSL, LEM), « Foi implicite et gestion de l'hétérodoxie chez Francisco de Vitoria »
9h30 : discussion
9h45 : José Luis Egío García (Universidad Complutense de Madrid, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory), « Les païens Amérindiens et les débats sur la foi, la justification et le salut au sein de l'École de Salamanque »
10h15 : discussion
10h30 : pause café
11h : Lidia Lanza (CFUL, Universidad de Lisboa), « The human dimension of faith: Luis de Molina’s reflection on faith as an obligatory and just act »
11h30 : discussion
11h45 : Sylvio de Franceschi (EPHE-PSL, LEM), « Le traité De fide chez les thomistes du XVIIIe siècle »
12h15 : discussion
12h30 : Conclusions du colloque par Ueli Zahnd
Colloque organisé par Andy Serin, avec le soutien du Laboratoire d'études sur les monothéismes et la revue ThéoRèmes