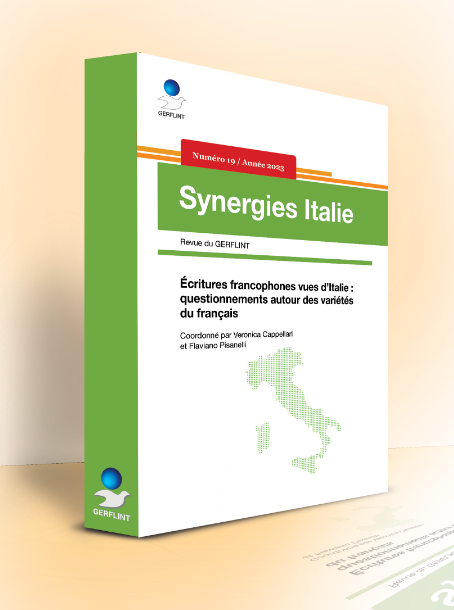
Quand les mots s’habillent : approches linguistiques et culturelles du lexique vestimentaire (revue Synergies Italie)
APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LE N°23 / 2027 de Synergies Italie
Date limite de soumission des résumés : 15 janvier 2026
La revue Synergies Italie, revue francophone indexée dans de nombreuses bases de revues scientifiques dont ERIH PLUS, Scopus et Anvur lance un appel à contributions pour la publication du n°23 sur le thème suivant :
Quand les mots s’habillent : approches linguistiques et culturelles du lexique vestimentaire
Numéro coordonné par
Maria Teresa Zanola (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) & Maria Margherita Mattioda (Università di Torino)
—
La mode a été étudiée selon une approche humaniste, en fonction de périodes historiques (Levi Pisetsky 1964 ; Bailleux & Remaury et al. 1995 ; Boucher 2008 [1965]), elle a été analysée dans les formes vestimentaires à travers le temps, pour la vie privée, institutionnelle et professionnelle. La mode a fait l’objet d’études littéraires (cf. Modenesi et al. 2015), d’approches psychologiques et sociologiques (cf. Godart 2010), d’analyses d’aspects sémiotiques et psychosociologiques spécifiques (Simmel 1895 ; Barthes 1967). Elle a été également étudiée comme symbole de l’identité d’une société ou pour l’influence de la société occidentale européenne au cours des XIXe et XXe siècles ; enfin, la mode a été analysée comme histoire des silhouettes, des comportements, des objets et des créations artistiques. Il existe une vaste production scientifique relative à la mode et à ses marques dans les stratégies de marketing et de publicité pour les réseaux de distribution national et international.
Il s’agit d’un secteur polyvalent, interdisciplinaire et transdisciplinaire, qui se présente dans toute sa complexité réticulaire et nécessite toujours l’identification de l’axe temporel et socioculturel de référence afin de pouvoir avancer dans la description et l’analyse des études de cas. La première étape dans l’étude de la mode consiste donc à définir précisément l’espace géographique et chronologique que l’on entend considérer, autour duquel regrouper l’ensemble des sources pouvant fournir la documentation linguistique, visuelle et encyclopédique nécessaire à l’exploration de ce système, très riche aussi de sous-domaines (ex. la mode masculine, la mode enfantine, la mode sportive, etc.).
La complexité de ce domaine reflète celle du système de ses sources : le projet de recherche FLATIF (https://centridiricerca.unicatt.it/otpl-progetti-prin-2020-flatif) propose une contribution incontournable de reconnaissance et d’orientation, en s’appuyant sur la richesse des sources recensées – manuels, traités, revues de mode, catalogues, dictionnaires, encyclopédies spécialisées : autant de ressources linguistiques, encyclopédiques et visuelles, auxquelles s’ajoutent les supports audiovisuels et médiatiques (D’Achille, Zanola dir. 2025). D’ailleurs, la recherche linguistique dans une perspective diachronique permet la reconstruction de la définition conceptuelle et linguistico-terminologique, afin de permettre un accès aussi complet que possible aux informations relatives à cet univers linguistique, culturel et sémiotique si riche (Zanola 2014, 2015a, 2015b, 2020a, 2020b, 2021; Grimaldi 2025, Calvi 2023, Calvi, Dankova 2025).
La mode est un langage. Ses objets — vêtements, accessoires, tissus, ornements — s’accompagnent toujours de mots qui les désignent, les décrivent, les classent et les valorisent. Le lexique vestimentaire est ainsi un lieu de rencontre privilégié entre langue, culture et société : il reflète des pratiques et savoir-faire, révèle des imaginaires et témoigne des circulations entre langues et cultures (Concilio, 2025; Bullich, 2025). La complexité du domaine oblige à tenir compte de coordonnées précises, en plus de l’ensemble des sources éligibles pour l’identification définitoire et conceptuelle du lexique de la mode, que nous résumons en quatre points (Zanola 2025):
a) le terme et la périodisation chronologique considérée : le terme et sa définition sont liés à la période de sa présence et de sa diffusion, qui peut donner lieu à des évolutions de sens, à ramener donc à une scalabilité chronologique à établir ;
b) un ensemble de sources nécessaires, au sein duquel aucune ne domine, mais où chacune joue un rôle indispensable dans la collecte exhaustive des données utiles (Bouverot 1999) ;
c) la perspective plurilingue et pluriculturelle : l’évaluation relative au terme et à ses équivalents dans d’autres langues, dans un contexte marqué par l’évolution rapide des technologies et l’émergence de l’IA (Mattioda, 2024);
d) le type de destinataire/utilisateur de ce lexique : de la production à la distribution, le même noyau conceptuel s’exprime en des termes différents, et la variation peut s’étendre si le terme est utilisé par des experts du secteur ou se diffuse auprès du grand public (Zanola 2016, 2018a, 2020a; Mattioda, Vittoz 2016; Mattioda, Civico 2025).
—
Ce numéro de Synergies Italie se propose d’explorer le lexique de la mode dans ses dimensions linguistiques et terminologiques, discursives et culturelles. Les contributions, qui porteront sur le français ou l’italien ou bien sur les deux langues en perspective comparative ou contrastive, devront reposer principalement sur des sources inédites (archives, collections, corpus jusque-là inexplorés, ego-documents) et approfondir les questions suivantes:
● l’étude historique du lexique de la mode et de ses évolutions ;
● les emprunts, les calques, les allers et retours et la circulation des mots de la mode entre langues ;
● les métaphores et images liées au vêtement dans les discours ;
● la terminologie professionnelle et de la commercialisation ;
● les usages sociaux et culturels du vocabulaire de la mode ;
● la traduction et la médiation linguistique du lexique vestimentaire ;
● la dimension sémiotique et discursive des mots de la mode dans les médias, la publicité, les blogs ou les réseaux sociaux.
—
Références
Bailleux, N., Remaury, B. 1995. Modes et vêtements. Paris : Gallimard.
Barthes, R. 1967. Système de la mode. Paris : Seuil.
Boucher, F. 2008 [1965]. Histoire du costume en Occident de l’antiquité à nos jours. Paris : Flammarion.
Bouverot, D. 1999. Le vocabulaire de la mode. In Antoine, G., Martin, R. 1999. (dir.), Histoire de la langue française 1880-1914. Paris : CNRS, p. 193-206.
BULLICH, V. (2025). Des « machines à faire la mode » ? Dispositifs d’intelligence artificielle générative et récits de création en mode. Interfaces numériques, 14(1). https://doi.org/10.25965/interfaces-numeriques.5521
Calvi, S. 2023. « La fraise : histoire d’un accessoire et de sa terminologie ». Philologica Jassyensia, nº 38/2, p. 141-151.
Calvi, S., Dankova, K. 2025. Comunicare il tessuto al XX e XXI secolo: il caso di velours. In D’Achille, P., Zanola, M. T. (dir.), La moda francese e italiana (1880-1980). Fonti, strumenti e metodi. Firenze : Cesati Editore, p. 113-137.
Concilio, C. (2025). From Art Nouveau to Green Design: Fashion, Décor, Fashion Writing. ZoneModa Journal, 15(1), iii-ix. https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/22110
D’Achille, P., Zanola, M. T. (dir.) 2025. La moda francese e italiana (1880-1980). Fonti, strumenti e metodi. Firenze : Cesati Editore.
Godart, F. 2010. Sociologie de la mode. Paris : La Découverte.
Grimaldi, C. 2025. Scrivere di moda. Per una ricostruzione storica delle riviste francesi (XVIII-XX secolo). In D’Achille, P., Zanola, M. T. (dir.), La moda francese e italiana (1880-1980). Fonti, strumenti e metodi. Firenze : Cesati Editore, p. 49-64.
Levi Pisetsky, R. 1964. Storia del costume in Italia. Milano : Treccani.
Mattioda, M.M. (2024). La terminologie de la mode durable : quels défis pour la traduction des anglicismes Fast Fashion et Slow Fashion ?, in Rossi Micaela (éds.), Néologie, terminologie et variation - Neología, terminología y variación – Neologia, terminologia e variazione, Lausanne, Peter Lang, pp. 367-391.
Mattioda, M.M., Vittoz M.B. (2016). Des tissus dans tous les sens : d’une terminologie didactique à la communication professionnelle du projet « Voce del verbo moda », in E. Bricco, I. Torre, S. Torsani (a cura di), Du labyrinthe à la toile/Dal labirinto alla rete, Mélanges en l’honneur de Sergio Poli, Publif@rum, n. 26/2016 URL : http://www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?art_id=343
Mattioda, M.M., Civico, M. (2025). Framing Sustainability in Ethical Fashion: A Lexicometric Analysis of French Brand Communication, ZoneModa Journal, 15(1), 137–152. https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/21929
Modenesi, M., Collini, M. B., Paraboschi, F. (dir.) 2015. La grâce de montrer son âme dans le vêtement. Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Milano : LED, 3 voll.
Simmel, G. 1895. « Zur Psychologie der Mode. Soziologische Studie ». Die Zeit. Wiener Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft, Wissenschaft und Kunst, nº 54/5, 12/10/1895, p. 22-24.
Zanola, M. T. 2014. Arts et métiers au XVIIIe siècle. Études de terminologie diachronique. Paris : L’Harmattan.
Zanola, M. T. 2015a. Le feutre, du caudebec au borsalino: hommage au chapeau. In : Modenesi, M. et al. (dir.), La grâce de montrer son âme dans le vêtement. Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Milano : LED, vol. II, 433-443.
Zanola, M. T. 2015b. Narration et figure d’un objet du quotidien: le parapluie. In : Galazzi, E. et al. (dir.), “Tout le talent d’écrire ne consiste après tout que dans le choix des mots”. Mélanges d’études pour Giuseppe Bernardelli. Berna : Peter Lang, p. 271-282.
Zanola, M. T. 2016. L’espace du concept, la parole de l’image : pour une typologie des représentations non-verbales dans la terminologie des tissus. In : Lervad, S. et al. (dir.), Verbal and non-verbal representation in terminology: Proceedings of the TOTh 2013. Copenhague : DNRF’s Centre for Textile Research, Institut Porphyre, Savoir et connaissances, p. 65-80.
Zanola, M. T. 2018a. « La terminologie des arts et métiers entre production et commercialisation : une approche diachronique ». Terminàlia, nº 17, p. 6-23.
Zanola, M. T. 2020a. « Francese e italiano, lingue della moda: scambi linguistici e viaggi di parole nel XX secolo ». Lingue Culture Mediazioni, nº 7/2, p. 9-26.
Zanola, M. T. 2020b. Évolution et néologie sémantique dans le domaine de l’habillement: le cas des “gilets jaunes”. In Tallarico, G. et al. (dir.), Nouveaux horizons pour la néologie du français. Hommage à Jean-François Sablayrolles. Limoges : Lambert-Lucas, p. 153-164.
Zanola, M. T. 2021. Derrière un éventail: un accessoire de mode et son réseau terminologique. In Battistini, A. et al. (dir.), L’Europa o la lingua sognata. Studi in onore di Anna Soncini Fratta. Città di Castello : Odoya, p. 599-609.
Zanola, M. T. 2025. Descrivere la moda italiana e francese, fra lingua, cultura e terminologia. Il caso della marinière. In D’Achille, P., Zanola, M. T. (dir.), La moda francese e italiana (1880-1980). Fonti, strumenti e metodi. Firenze : Cesati Editore, p. 15-47.
—
NB : Les doctorants et chercheurs francophones italiens menant leurs travaux dans un autre domaine couvert par la revue (Ensemble des Sciences Humaines et Sociales, culture et communication internationales, sciences du langage, littératures francophones, didactique des langues-cultures, éthique et théorie de la complexité) sont également invités à participer dans la limite de l’espace éditorial disponible et selon les étapes d’évaluation décrites dans les consignes aux auteurs.
—
Consignes, format de soumission et sélection
L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra consulter directement en ligne :
⮚ la politique éditoriale générale de l’éditeur
http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
⮚ la politique éditoriale de la revue
http://gerflint.fr/synergies-italie/politique-editoriale
⮚ les 25 normes éditoriales et rédactionnelles
http://gerflint.fr/synergies-italie/consignes-aux-auteurs
⮚ la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur
http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
⮚ la politique de l’éditeur en matière d’accès libre et d’archivage
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1724-0700/
—
Les propositions d’articles seront présentées sous forme d’un résumé de deux pages maximum (format A4, police Times taille 10), incluant 5 mots-clés et les éléments essentiels de bibliographie, et envoyées par courriel à l’adresse suivante : synergies.italie@gmail.com Elles seront transférées pour évaluation au comité scientifique de la revue.
—
Calendrier :
Date limite de l’envoi des résumés : 15 janvier 2026
Retour des avis aux auteurs : 15 février 2026
Envoi des articles : Avant le 31 mai 2026
CONTACT: synergies.italie@gmail.com