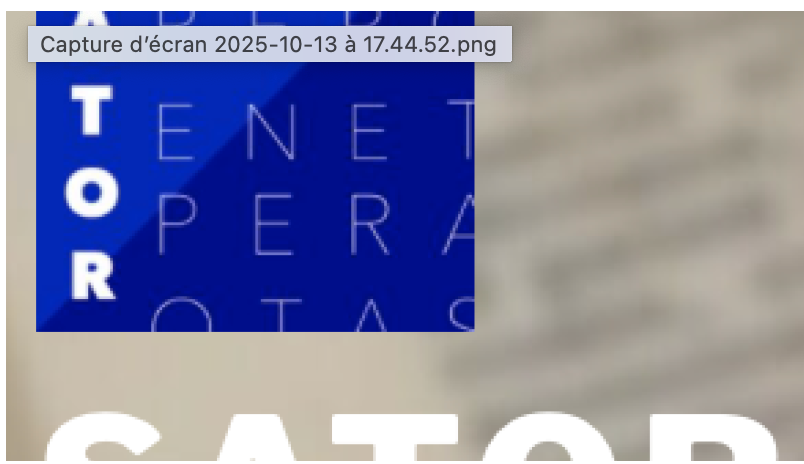
Lieux communs, stéréotypes et clichés du voyage. XXXVIIIe colloque international de la SATOR (Arras)
XXXVIIIe colloque international de la SATOR, Arras, 18-19 juin 2026
Université d’Artois / Textes et Cultures
Université Paris Cité / CERILAC
Université Sorbonne Nouvelle / CERC
À l’occasion de son XXXVIIIe colloque international, la SATOR invite les chercheuses et les chercheurs au décentrement afin d’envisager les liens complexes, aussi paradoxaux qu’évidents, entre topoi et discours du voyage, que ce discours soit issu ou non d’une expérience viatique concrète. Le voyage est banalement défini comme un déplacement plus ou moins long dans l’espace, occasion de découverte(s) et de transformation intérieure pour la voyageuse, le voyageur qui sort de sa zone de confort, et la logique commune voudrait que l’écriture du voyage s’en trouve également transformée. C’est pourtant bien le topos qui caractérise cette dernière, au point de fournir aux théoriciennes, théoriciens spécialistes des écrits viatiques un outil et une grille de lecture particulièrement opérants pour penser la littérarité de ces corpus « sans loi » (R. Le Huenen) : les travaux de Christine Montalbetti ont montré combien le voyage se fait et s’écrit à l’ombre d’une bibliothèque, celle-ci doublant l’expérience viatique quand elle ne s’y substitue pas totalement.
Si la SATOR concentre traditionnellement son intérêt sur le corpus des fictions de langue française d’Ancien Régime, soit antérieures à 1800, on souhaiterait, dans le cadre du présent colloque, étendre cet empan au long XIXe siècle, ainsi qu’aux corpus européens et, le cas échéant, extra-européens de fictions, mais aussi de relations de voyage. Élargir la réflexion au « siècle du voyage » – pour reprendre le titre d’une étude collective éditée en 2006 par Sylvain Venayre – revient tout d’abord à prendre acte de l’« entrée en littérature » (R. Le Huenen) du récit de voyage à l’époque romantique, ce qui en fait un objet pertinent pour la SATOR. Plus particulièrement, ceci doit nous inviter à penser le discours viatique dans toute sa complexité, à l’interface des littératures de fiction et des littératures référentielles, mais aussi les interactions et les contaminations génériques à double sens entre ces deux ensembles et, enfin, la manière dont les topoi s’en trouvent construits, déconstruits ou reconfigurés. C’est à cette même fin qu’est utile l’ouverture du propos aux corpus extra-européens, ces derniers nous incitant plus encore à interroger notre définition du fait littéraire par la confrontation à d’autres cultures de l’écrit – et de l’oral – que la nôtre.
Plusieurs études existent d’ores et déjà sur la place et le rôle du topos dans les écrits viatiques, qu’il s’agisse d’envisager sa phénoménologie sur un plan micro- et macrostructural (S. Venayre et A.-G. Weber, 2010), d’étudier sa fabrique, à l’interface de la littérature et des sciences naturelles (A.-G. Weber, 2013) ou encore d’éclairer l’équilibre subtil qui le génère dans l’écriture, entre répétition(s) et variation(s) (V. Magri et O. Gannier, 2020). Le présent colloque entend poursuivre cette investigation, non seulement en se donnant pour tâche d’éclairer et de mettre en ordre la terminologie mouvante dont nous nous emparons souvent pour penser le caractère topique des écrits viatiques – lieu(x) commun(s), stéréotype(s), cliché(s) – mais aussi en offrant à la réflexion collective l’opportunité d’un tournant poéticien : il s’agira de dépasser la tentation d’une analyse strictement thématique ou imagologique de ce corpus. Nous gageons que l’objet de recherche de la SATOR, le topos narratif, constitue une voie opératoire pour ce faire, autant qu’il est le creuset d’un possible dialogue interdisciplinaire sur la question : « configuration narrative récurrente d’éléments pertinents, thématiques ou formels », « assez récurrent[e] pour être perçu comme topique » (voir la présentation générale des outils théoriques de la SATOR), elle appelle les analyses de spécialistes de littérature française, étrangère et comparée, de linguistique et de stylistique, d’histoire culturelle ou encore d’histoire et de théorie des arts.
Les contributions peuvent s’inscrire dans les axes suivants, sans toutefois s’y limiter :
- État des lieux : quelles perspectives ouvertes aux études viatiques par l’étude de la topique narrative ? Quelles sont les nuances sémantiques, en langue et en discours, qui existeraient entre les notions de topos, lieu commun, stéréotype ou cliché pour désigner ces constantes définitoires de l’écriture viatique ? Qu’y apporte l’approche satorienne du mini-canevas narratif récurrent, notamment lorsqu’on la mobilise pour lire les écrits viatiques ?
- - Fabrique des lieux : quels sont les différents types d’occurrence d’une topique narrative dans les écrits viatiques ? Peut-on les nommer et les classifier ? Esquissent-ils un séquençage du récit du voyage au même titre qu’un itinéraire balisé ? Façonnent-ils ou révèlent-ils, par leur récurrence voire leur répétition, des constantes génériques pouvant être abstraites de la variété des corpus viatiques ? Inversement, que produisent la variation et l’écart par rapport à la répétition ?
- Retour sur les lieux : comment les autrices, auteurs de voyages réels et / ou fictifs se positionnent-elles / ils par rapport à la topique narrative ? À quel degré la conscience d’une topicité se situe-t-elle et, le cas échéant, par quel(s) moyen(s) s’exprime-t-elle ? Peut-on identifier les éléments d’un discours réflexif, voire les prémices d’un geste de théorisation ? Ont-ils leur place désignée dans la trame diégétique de l’écrit viatique, ou est-ce entre les lignes qu’il faut les traquer, ou est-ce notre relecture qui les institue ?
- Lieux multidimensionnels : dans quelle mesure le sémantisme tant rhétorique que spatial et géographique de la notion de lieu, particulièrement porteur pour penser l’écriture des voyages, trouve-t-il un écho dans l’acception d’abord photographique, puis discursive, de l’une des variantes du lieu, le cliché ? Qu’apporte l’étude des voyages illustrés, de la gravure à la photographie, à notre objet ? La notion de topique narrative peut-elle s’ouvrir à une perspective d’étude intermédiale et, inversement, de quelles manières peut-elle enrichir cette dernière ?
—
Les propositions de communication d’environ 300 mots, accompagnées d’une courte bio-bibliographie, sont à envoyer à agaelle.weber@univ-artois.fr, mathilde.morinet@univ-artois.fr, yen-mai.tran-gervat@sorbonne-nouvelle.fr et marie.mosse@u-paris.fr avant le lundi 12 janvier 2026.
Une réponse sera envoyée après délibération du comité scientifique au plus tard le lundi 16 mars 2026.
—
Bibliographie indicative
Amossy, Ruth et Anne Herschberg Pierrot, Stéréotypes et clichés. Langue, discours, société, Paris, Armand Colin, coll. « 128 Tout le savoir », 2015
Amossy, Ruth et Elisheva Rosen, Les Discours du cliché, Paris, CDU et SEDES, 1982
Antoine, Philippe et Marie-Christine Gomez-Géraud (dir.), Roman et récit de voyage, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Imago mundi », 2001
Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1979
Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1984
Chupeau, Jacques, « Les récits de voyage aux lisières du roman », Revue d’Histoire littéraire de la France, mai-août 1977, p. 536-553
Curtius, Ernst Robert, La Littérature européenne et le Moyen Âge latin (1948), traduit de l’allemand par Jean Bréjoux, 2 vol., Paris, Presses universitaires de France, 1956 (réimpression 1986)
Debaene, Vincent, La Source et le Signe. Anthropologie, littérature et parole indigène, Paris, Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle », 2025
Dubost, Jean-François, « Introduction. De la topique à la topographie : retour critique sur nos outils théoriques », Topique et topographie, Topiques, études satoriennes, vol. 3, 2017
Ferrand, Nathalie et Michèle Weil (dir.), Homo narrativus. Recherches sur la topique romanesque dans les fictions de langue française avant 1800, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2017
Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982
Jeay, Madeleine et Jean-François Dubost (dir.), Réfléchir le topos narratif, Topiques, études satoriennes, vol. 2, 2016
Gannier, Odile et Véronique Magri (dir.), Variations et répétitions dans le récit de voyage, L’Analisi linguistica e letteraria, n°28/1, 2020. URL : https://www.analisilinguisticaeletteraria.eu/index.php/ojs/issue/view/64
Le Huenen, Roland, Le Récit de voyage au prisme de la littérature, Paris, PUPS, coll. « Imago Mundi », 2015
Linon-Chipon, Sophie, Véronique Magri-Mourgues, Sarga Moussa (dir.), Miroirs de textes. Récits de voyage et intertextualité, Nice, Publication de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de Nice, Nouvelle série, n°49, 1998
Magri-Mourgues, Véronique, Le Voyage à pas comptés. Pour une poétique du récit de voyage au XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, 2009
Montalbetti, Christine, Le voyage, le monde et la bibliothèque, Paris, PUF, coll. « Ecriture », 1998
Pasquali, Adrien, Le Tour des Horizons. Critique et récits de voyage, Paris, Klincksieck, 1994
Rajotte, Pierre, Le récit de voyage, aux frontières du littéraire, Montréal, Éditions Triptyque, 1997
Samoyault, Tiphaine, L’Intertextualité. Mémoire de la littérature, Paris, Nathan Université, coll. « 128 Tout le savoir », 2001
Venayre, Sylvain (dir.), Le Siècle du voyage, Sociétés & Représentations, 2006/1, n°21
Venayre, Sylvain et Anne-Gaëlle Weber (dir.), Lieux communs du voyage, Les Cahiers du XIXe siècle, n°5, Montréal, Éditions Nota bene, 2010
Weber, Anne-Gaëlle, A beau mentir qui vient de loin. Savants, voyageurs et romanciers au XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, 2004
Weber, Anne-Gaëlle, Les Perroquets de Cook. De la fabrique littéraire d'un lieu commun savant, Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n°20, 2013.
—
Comité scientifique
Hélène Cussac (Université Toulouse Jean-Jaurès / SATOR)
Mathilde Morinet (Université d’Artois)
Marie Mossé (Université Paris Cité)
Sylvie Requemora (Aix-Marseille Université)
Marta Teixeira Anacleto (Université de Coimbra / SATOR)
Yen-Maï Tran-Gervat (Université Sorbonne Nouvelle / SATOR)
Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois)