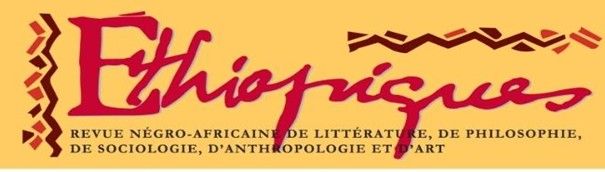
Ethiopiques n° 116
1er semestre 2026
Regards croisés sur la question féminine
Les problématiques émergentes
Depuis des décennies les écrits des /sur les femmes connaissent un essor remarquable sur tous les continents. En effet, les études féministes et postcoloniales ainsi que les réflexions sur le genre ont favorisé le renouvellement des corpus et ouvert de nouvelles perspectives à leur analyse. Relevant de plusieurs domaines de la littérature, des arts et des sciences sociales, les écrits des femmes comme les écrits sur les femmes s’inscrivent dans des traditions et des théories diverses et variées.
Par ailleurs, les approches intersectionnelles permettent aussi de saisir la complexité plurielle des expériences féminines et des discours sur les femmes. Qu’elles aient pour auteur(e)s des femmes ou des hommes, ces productions invitent à renouveler l’analyse d’une catégorie de productions souvent enfermée dans des stéréotypes et à envisager de sortir d’un déterminisme ontologique essentiellement
centré sur la vie et les expériences de la femme.
Pendant longtemps, les productions écrites ou artistiques des femmes n’ont pas été analysées d’abord comme des objets esthétiques mais ont été placées sous le signe de la subversion. D’ailleurs, le concept même de « littérature féminine » est à réinterroger parce que « l’acte de nommer ‘’la littérature’’ est lui-même un geste théorique dépendant en partie de catégories extérieures à la littérature. Ce que l’histoire nomme “littérature” oublie ainsi quantité d’“écritures” » (Marie-Jeanne Zenetti, « Situer la théorie », 2022 & « Théorie, réflexivité et savoirs situés », 2021). La critique
littéraire a, dès le début, positionné la parole des écrivaines dans une démarche d’opposition (à la parole des hommes) et de remise en cause (d’une organisation sociale patriarcale). Elle se serait voulue une affirmation de ce qui est nié, une volonté de montrer une présence de ce que l’on cherche à cacher et une revendication d’une autre forme de présence au monde. Aujourd’hui, de multiples vocables servent à désigner les œuvres littéraires produites par les femmes : « écriture(s) féminine(s), littérature(s) féminine(s), « écriture(s) de femme(s) », « écriture(s) féministe(s), « l’écrire-femme », etc. Cette inflation terminologique traduit non seulement la difficulté à cerner la spécificité (ou non) d’une littérature essentiellement féminine mais aussi la nécessité d’orienter la réflexion vers l’existence de cette catégorie et sur comment l’aborder. N’est-il pas envisageable de parler d’une écriture féminine ou une autre forme de création dans laquelle les auteures surmontent « la spécification millénaire
qui les cantonne dans leur féminité » (De Beauvoir). Autrement dit, pour avoir une liberté de création et produire une littérature, essentiellement, ne devrait-elle pas commencer par « un refus d’être femme » pour s’exprimer, quel que soit le moyen, en tant que créatrices ?
Aujourd’hui, le combat pour le droit des femmes leur a donné davantage la possibilité d’accéder à des instances de décision telles que l’Assemblée nationale, les collectivités locales, etc. Il serait donc intéressant de renouveler le regard porté sur les modes de présence des femmes (la femme-sujet, la femme-objet, la femme-voix, la femme-corps, etc.) dans l’actualité des lettres et des arts mais aussi dans la réflexion
en sociologie, en philosophie, etc.
Ce numéro d’Éthiopiques entend susciter une exploration transversale et multidisciplinaire des enjeux contemporains ayant partie liée aux questions féminines en Afrique, et/ou à partir de l’Afrique. Il s’agira de donner corps aux réflexions sur les situations diverses et les expériences multiples des femmes dans le monde actuel, sur les nouveaux chemins d’émancipation frayés par elles, leur place et leurs fonctions dans la société contemporaine, mais également sur leur sensibilité particulière, leur imaginaire spécifique, leur vécu intime et les impensés.
Les contributeurs sont invités à questionner les stéréotypes en relisant les écrits des/sur les femmes. Les contributions peuvent être d’ordre épistémologique, herméneutique, heuristique, historiographique, etc. pour permettre de répondre à certaines questions :
- Que signifie être écrivaine aujourd’hui ? - - - - - - - -
- En dehors de celles traditionnelles, quelles catégories permettent aujourd’hui de dire la femme ?
- Quels sont les dynamiques de l’évolution des représentations des figures féminines ?
- Comment parler des femmes/ Parler en femmes ?
- Comment se construisent, se déconstruisent, se reconstruisent des stéréotypes du genre dans la littérature dite féminine ?
- Existe-t-il une nouvelle esthétique dans les littératures et les arts pour dire la femme ?
- Quelles sont les formes émergentes d’héroïsation des femmes ?
- Quelles sont dynamiques actuelles de réception des productions des femmes ?
—
Bibliographie indicative
BAZIE, Isaac et NAUDILLON, Francoise (dir.), Femmes en Francophonie: Écritures et lectures du féminin dans les littératures francophones, Montreal, Memoire d’encrier, 2013.
Cahiers d'études africaines n°2025/3, « Agency féminine, agir féministe », Éditions de l'EHESS.
HARPIN, Tina et RAYNAUD, Claudine (dir.), (Re)lire les féminismes noirs, Etudes littéraires africaines, n°51, 2021.
NAUDIER, Delphine (dir.), "Genre et activité littéraire. Les écrivaines francophones", Sociétés contemporaines, n° 78, 2010.
RAMOND, Michele, Quant au féminin, Paris, L’Harmattan, 2011.
ZENETTI, Marie-Jeanne, BUJOR, Flavia, COSTE, Marion, PAULIAN, Claire, RUNDGREN, Heta et TURBIAU, Aurore, (dir.) « Situer la théorie : pensées de la littérature et savoirs situés (féminismes, postcolonialismes), Fabula-LhT n° 26, Octobre 2021.
—
Les propositions seront envoyées avant le 31 mars 2026 à : senghorf@orange.sn et sakhosi2002@yahoo.fr