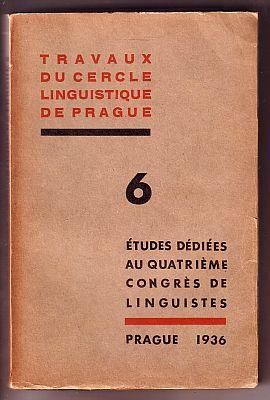
Linguistique de l’écrit
Écrit et écriture au Cercle linguistique de Prague
Appel à contributions
Patrick Flack (Université de Fribourg) & Pierre-Yves Testenoire (Université Sorbonne Nouvelle / Histoire des Théories Linguistiques)
À l’occasion du centenaire de la fondation du Cercle linguistique de Prague, la revue Linguistique de l’écrit souhaite consacrer son numéro thématique de 2026 à la contribution de ce groupe de recherche aux approches linguistiques de l’écrit.
Les thématiques de l’écrit et de l’écriture ne sont pas spontanément associées aux activités du Cercle linguistique de Prague. Elles contreviennent même à l’image habituellement véhiculée du Cercle, qui reste attachée à l’invention de la phonologie – son « cri de guerre » selon l’expression de son président, Vilém Mathesius (1966 [1936] : 144). Le travail du Cercle excède cependant la description et la théorisation des systèmes phonologiques. Les principales synthèses consacrées au CLP (Fontaine 1974, Viel 1984, Raynaud 1990, Mahmoudian & Sériot 1994, Toman 1995, Procházka, Malá & Šaldová 2010, etc.) ont mis en évidence la diversité des champs explorés par les Pragois : morphophonologie, syntaxe, lexique, études grammaticales, poétiques, sémiotiques… Rares sont celles qui mentionnent l’écrit et l’écriture parmi les thématiques importantes du Cercle. Pourtant deux de ses participants et acteurs majeurs de la transmission de la mémoire du Cercle – Josef Vachek et Roman Jakobson – ont insisté sur l’importance qu’y occupait cette problématique. Ainsi Vachek (1966 : 101-103) compte les « Problems of written language and orthography » parmi les domaines majeurs d’intervention du CLP et Jakobson attire l’attention des concepteurs du numéro de la revue Change consacré au Cercle (1969) à la place qu’y occupait l’écriture. Sur la base du témoignage de Jakobson, Jean-Pierre Faye y écrit que « la question de l'écriture était fréquemment évoquée et discutée dans le Cercle de Prague » (Faye & Robel 1969 : 85). Cette affirmation est confirmée par l’ensemble des sources et documents aujourd’hui disponibles. Elle s’observe par exemple dans les programmes des séances du Cercle où la thématique de l’écriture revient très souvent (Čermák, Poeta & Čermák 2012). Elle est abordée dans des communications de Troubetzkoy[1], Karcevski[2], Artymovyč[3], Novák[4], Trnka[5], etc. Les questions liées à la réforme de l’orthographe du tchèque, de sa langue écrite et de sa standardisation sont un pan important, bien que méconnu, des activités du Cercle (Sinzelle Poňavičová 2022). Ces problèmes sont abordés dans les Thèses de 1929, de même qu’y sont thématisés la dualité de la « manifestation orale » et de la « manifestation écrite » du langage ou encore la « forte action sur le langage littéraire parlé » qu’exerce le langage écrit. Si ces questions ne reçoivent pas de traitement unifié au sein de l’approche fonctionnelle développée à Prague, elles sont au cœur de plusieurs textes – par ex. Havránek (1937) – dont plusieurs se rejoignent pour espérer une « science » ou « théorie de l’écriture » à venir (Troubetzkoy 1969 [1935], Vachek 1945). Elles donnent également lieu à des travaux d’envergure, en particulier de Vladimir Buben, Influence de l’orthographe sur la prononciation du français moderne (1935), et de Joseph Vachek : « Contribution au problème de la langue écrite » (1985 [1939]), « Langue écrite et langue imprimée » (1948). Ce dernier a poursuivi, longtemps après la dissolution du Cercle en 1952, sa réflexion sur le statut de la langue écrite (Vachek 1973, 1989). Son travail, ainsi que les remarques sur les « procédés graphiques » de Mukařovský (1969 [1931]) et les prises de position autonomistes d’Artymovyč (1932a, 1932c), attestent que le traitement de l’écriture au sein du CLP ne se réduit pas au phonocentrisme généralement attribué aux Pragois (et par ailleurs bien attesté, cf. Jakobson 1976 : 77-78). Cette diversité doit aussi se lire à l’aune des approches de l’écrit développées dans d’autres écoles – genevoise, danoise, américaine – comme l’illustre le dialogue entre les textes d’Uldall (1944), de Vachek (1945) et de Pulgram (1951). À ce titre, la place de l’écriture dans le développement de la phonologie pragoise mérite d’être interrogée. Ainsi en va-t-il des comparaisons avec les systèmes d’écriture qui traversent les écrits phonologiques de Troubetzkoy (1936 : 8, 11, 1949 [1939] : 70). Elles résonnent avec les analyses d’Albano Leoni (2014) qui pointent la prégnance du modèle alphabétique à l’œuvre dans la phonologie structurale.
La problématique de l’écriture a rencontré les préoccupations des membres du Cercle linguistique de Prague car elle engage les différentes dimensions du langage – fonctionnelle, sociale, sémiotique – qu’ils cherchaient à appréhender. Écrit et écriture étaient difficilement contournables pour une école qui s’efforçait de mener de front théorie de la langue et théorie de la littérature. La diversité des questions que ces objets ont suscitées ou qu’ils sont à même de susciter aujourd’hui seront au cœur du prochain numéro de Linguistique de l’écrit. Celui-ci s’inscrit à la suite des contributions fondatrices de Hall (1960), Arrivé (1983), Chiss & Puech (1983), Anis (1984, 1988) sur l’émergence des approches structurales de l’écriture. Son ambition est d’éclairer, à la lumière des recherches récentes, cet aspect méconnu des idées et des travaux menés au sein du Cercle linguistique de Prague, ainsi que leur productivité un siècle après sa fondation.
Il s’agit aussi d’élargir l’analyse à la manière dont les propositions du CLP se sont articulées ou confrontées à d'autres traditions intellectuelles et artistiques. Les avant-gardes tchèques et russes, en particulier, ont fortement travaillé sur la matérialité graphique et l’expérimentation scripturale, offrant un terrain de dialogue fécond avec les réflexions pragoises. De même, les débats postérieurs sur le phonocentrisme – qu’ils soient nourris par les approches philosophiques de Derrida ou par les perspectives de la linguistique de l’énonciation développées par Bachtin/Vološinov et Benveniste – constituent un espace où l’héritage du Cercle a été repris, discuté, voire contesté. Cette ouverture permettra de situer l’apport du CLP dans une histoire élargie des théories de l’écriture et de son rôle dans le langage.
Envisagés de façon large, les problèmes de l’écrit et de l’écriture pourront être abordés soit dans les travaux du Cercle de Prague, soit à partir d’eux. À titre d’exemples, les contributions pourront porter sur :
· Le rôle de l’écriture dans la théorie pragoise (phonologie, poétique, esthétique, etc.)
· Les définitions, statuts et usages de notions : écrit, écriture, langue écrite, langue littéraire, culture linguistique, etc.
· Les problèmes d’orthographe, du rapport oral/écrit, phonème/graphème ;
· Les questions de normes, de standardisation linguistique, de langue littéraire, de culture linguistique ;
· La place du fait scripturaire dans la société, la littérature, l’enseignement ;
· L’analyse des travaux de membres du CLP (Artymovyč, Buben, Havránek, Vachek…) et de leur héritage ;
· Les sources des idées du CLP sur l’écrit et l’écriture, leur réception et leur transmission ;
· La confrontation avec des approches de l’écrit développées dans d’autres centres (par ex. avec l’école de Copenhague) ;
· Les apports du CLP pour la linguistique de l’écrit ;
· Les liens et dialogues entre le Cercle et les avant-gardes tchèques et russes, qui ont accordé une place essentielle aux expérimentations graphiques et aux pratiques scripturales ;
· La réception ultérieure des thèses pragoises sur l’écriture dans les débats théoriques sur le phonocentrisme, qu’ils soient philosophiques (Derrida) ou issus de la linguistique de l’énonciation (Bachtin, Benveniste).
—
Modalité de soumission et d’évaluation
Les projets d’article et l’ensemble des contributions sont à envoyer à : redaction@linguistique-ecrit.org
Les projets d’article (d’une page) seront évalués par les coordinateurs du numéro, puis les articles feront l’objet d’une double expertise en conformité avec la politique éditoriale de la revue indiquée sur son site (https://linguistique-ecrit.org/pub-188266, onglet Instructions / Soumettre un article). Les articles peuvent être rédigés en anglais ou en français.
—
Calendrier
Réception des projets de soumission (une page + bibliographie) : 01 décembre 2025
Notification d’acceptation : 15 décembre 2025
Réception des articles : 31 mars 2026
Retour des évaluations : 31 mai 2026
Réception des articles après réécriture : 31 aout 2026
Parution : automne 2026.
—
Bibliographie
Albano Leoni, Federico (2014). Des sons et des sens. La physionomie acoustique des mots, Lyon : ENS Éditions.
Arrivé, Michel (1983). « Les Danois aux prises avec la substance de l’encre », Langue française 59, p. 25-30.
Anis, Jacques (1984). « La construction du graphème et ses enjeux théoriques », Archives et documents de la Société d'histoire et d'épistémologie des sciences du langage, Première série, 5, p. 1-27.
Anis, Jacques, avec la collaboration de Jean-Louis Chiss et Christian Puech, 1988, L’écriture. Théorie et description. Bruxelles : De Boeck.
Artymovyč, Agenor (1932a). « Pysana mova » [La langue écrite], Zbirnyk Ukrajinśkoho vysokoho pedagogičnoho instytuta v Prazi [Travaux de l’École normale supérieure ukrainienne à Prague] II, p. 1-8.
Artymovyč, Agenor (1932b). « Fremdwort und Schrift », Charisteria Guilelmo Matheiso quiquagenario a discipulid et ciculi linguistici pragensis sodalibus oblata. Prague : Pražský linguistický kroužek [Cercle linguistique de Prague], p. 114-118.
Buben, Vladimir (1935). Influence de l’orthographe sur la prononciation du français moderne. Bratislava : Travaux de la faculté des Lettres de l’Université Komenský de Bratislava.
Chiss, Jean-Louis & Puech, Christian (1983). « La linguistique et la question de l’écriture. Enjeux et débats autour de Saussure et des problématiques structurales », Langue française 59, p. 5-24.
Čermák, Petr, Poeta, Claudio & Čermák, Jan (2012). Pražský lingvistický kroužek v dokumentech [Le Cercle linguistique de Prague en documents], Prague, Academia.
Faye, Jean-Pierre & Robel, Léon (éd.) (1969). Change 3 : Le Cercle de Prague.
Fontaine, Jacqueline (1974). Le Cercle linguistique de Prague. Paris : Mame.
Hall, Robert A. (1960). « A theory of graphemics », Acta Linguistica 8(1), p. 13-20.
Havránek, Bohuslav (1937). « Český „pravopis“ za posledních padesát let », [« „L’orthographe“ tchèque depuis 50 ans »], Slovo a slovenost 3/2, p. 124-127.
Jakobson, Roman (1976). Six leçons sur le son et le sens. Paris : Minuit.
Mathesius, Vilém (1966 [1936]). « Ten Years of the Prague Linguistic Circle » in Vachek Josef (éd.), The Linguistic School of Prague, an introduction to its theory and practice. Bloomington : Indiana University Press, p. 137-151.
Mahmoudian, Mortéza & Sériot, Patrick (éd.) (1994). Cahiers de l’ILSL 5 : L’École de Prague : l’apport épistémologique.
Mukařovský, Jan (1969 [1931]), « Plan graphique, phonologie et poétique », Change 3, p. 88-90 [extrait de « La phonologie et la poétique », Travaux du Cercle linguistique de Prague 4, p. 278-288].
Procházka, Martin, Malá, Markéta & Šaldová, Pavlína (éd.) (2010). The Prague School and Theories of Structure. Göttingen : V & R unipress.
Pullgram, Ernest (1951). « Phoneme and Grapheme : a parallel », Word 7, p. 15-20.
Raynaud, Savina (1990). Il Circolo Linguistico di Praga (1926-1939). Radici storiche e apporti teorici. Milano : Vita & Pensiero.
Sinzelle Poňavičová, Ilona (2022). « Positionnement du Cercle linguistique de Prague vis-à-vis de la langue standard et son rôle dans la vie publique de la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres ». 24èmes Rencontres des Jeunes Chercheurs (RJC) en Sciences du Langage. “Du linguiste à son objet : la distance en question(s)”, p. 6-45. https://hal.science/hal-03918869v1/document
Toman, Jindřich (1995). The Magic of a Common Language. Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle. Cambridge Mass. – London : The MIT Press.
Troubetzkoy, Nikolaï (1969 [1935]). « Note pour une science pure de l’écriture ». Change 3, p. 85-87.
Troubetzkoy, Nikolaï (1936). « Essai d’une théorie des oppositions phonologiques », Journal de psychologie 33, p. 5-18.
Troubetzkoy Nikolaï (1949 [1939]). Principes de phonologie, traduction par Jean Cantineau. Paris : Klinscksieck.
Uldall, Hans Jørgen (1944). « Speech and writing », Acta linguistica 4, p. 11-16.
Vachek, Joseph, (1985 [1939]), « Contribution au problème de la langue écrite », introduction par Jean-Louis Chiss et Christian Puech, traduction par Pierre Caussat, Linx 12, p. 7-23.
Vachek, Joseph (1945). « Some remarks on writing and phonemic transcription », Acta linguistica 5(1), p. 86-93.
Vachek, Joseph, (1948). « Written language and printed language ». Recueil linguistique de Bratislava 1, p. 67-75.
Vachek, Josef (1966). The Linguistic School of Prague, an introduction to its theory and practice. Bloomington : Indiana University Press.
Vachek, Josef (1973). Written language : general problems and problems of English. The Hague – Paris : Mouton.
Vachek, Joseph (1989). Written Language Revisited. Amsterdam – Philadelphia : John Benjamins.
Viel, Michel. (1984). La notion de “marque” chez Trubetzkoy et Jakobson. Paris : Didier.
[1] « Alphabet et système phonétique » (06 février 1928), « Sur la relation entre l’alphabet glagolitique et l’alphabet grec » (6 octobre 1934).
[2] « Sur la réforme de l’orthographe russe » (6 octobre 1934).
[3] « Langue écrite » (24 février 1932), « Phonologie et écriture » (18 décembre 1933).
[4] « Histoire de la langue slovaque écrite du point de vue phonologique et question de la réforme de l’orthographe tchécoslovaque » (23 mars 1931).
[5] « Sténographie et phonologie » (16 mars 1936).