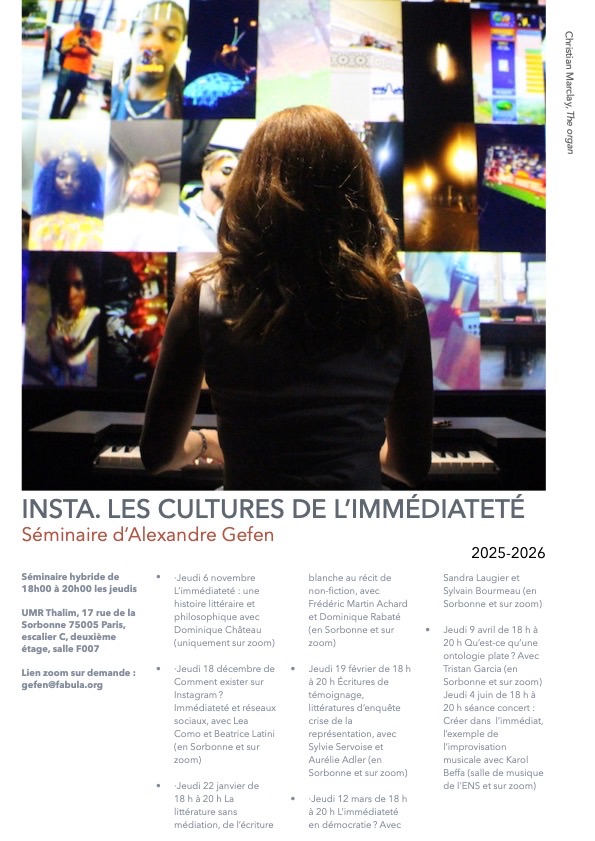
Insta. Les cultures de l’immédiateté
Un séminaire d’Alexandre Gefen
Dans Immediacy, or The Style of Too Late Capitalism (Verso, 2024), Anna Kornbluh développe une puissante critique du régime d’« immédiateté » qui caractériserait nos discours et nos pratiques artistiques et sociales. Sur le plan esthétique, en prenant l’exemple de Karl Ove Knausgård, elle dénonce un « style de l’immédiat » fait de flux, d’immersion et d’authenticité, qui tend à marginaliser la construction formelle et l’invention de médiations. L’effacement des représentations et des cadres réflexifs appauvrit la capacité de l’art à produire de la pensée, réduisant l’expérience à un transfert affectif direct. Enfin, sur le plan politique, elle souligne que cette désintermédiation fragilise les institutions, les symboles collectifs et les distances critiques nécessaires à la solidarité, et elle plaide pour une réhabilitation de la forme comme espace commun de médiation et de construction. Une telle dénonciation s’inscrit dans une critique de la modernité remontant au moins à Walter Benjamin, dont la critique de l’accélération de Hartmut Rosa serait l’héritière, tout en renvoyant en France aux thèses de Jean Baudrillard et Paul Virilio et à la réflexion de François Hartog sur le présentisme. Les résonnances d’une telle critique sont larges, allant de la dénonciation d’une « pop ontologie » où l’on reconnaitra l’ontologie plate des nouveaux réalistes aussi bien que les matérialismes caractérisés par une attention exclusive à la visibilité et à la surface des données jusqu’à l’interrogation sur un « au-delà de la politique » qui rejetterait la médiation (organisation, théorie, État) où l’accélération deviendrait une forme d’aliénation sociale, imposant la course à l’adaptation plutôt que l’émancipation. Pour le champ culturel et littéraire en particulier, force est de constater la « faim de réalité » pour reprendre la formule de David Shields, la puissance de désintermédiation du numérique, la culture du continu et du direct qui y règne, comme l’esthétique de l’urgence et l’impératif d’authenticité qui caractérisent bien des œuvres d’actualité refusant la symbolisation, la fiction, la modélisation ou la simple prise de distance, misant sur l'affect plutôt que la raison, la matérialité plutôt que le médium, la mémoire plutôt que la fiction, et l'individu plutôt que le collectif.
L’objectif de ce séminaire est d’interroger concrètement la thèse de l’immédiateté en la confrontant aux pratiques contemporaines, que ce soit celles de la démocratie directe, de la pratique des réseaux sociaux ou de l’écriture de non-fiction – à l’heure d’Instagram, de décrire et donner corps aux styles de l’immédiat, dont l’hétérogénéité depuis l’écriture par fragment sur les réseaux sociaux numériques jusqu’au enquêtes d’Emmanuel Carrère frappe immédiatement. S’il est aux antipodes de « l’art de l’éloignement » qui domina jusqu’au XIXe l’Occident pour Thomas Pavel, l’immédiat est une vieille lune, revendiquée dès le début du XXe siècle par les écrivains du groupe de l'Abbaye (autour de Duhamel et Jules Romains), suscitant le scepticisme d’Albert Thibaudet qui soutenait que cette littérature immédiate exigeait un « laps de temps », une période d'« ombre, de mystère, de silence » pour se réaliser pleinement. N’y a-t-il pas en effet bien des médiations dans les posts stratégiquement pensés des médias sociaux, de la densité dans les écritures supposées transparentes comme celles d’Annie Ernaux, de la complexité dans les expériences de démocratie directe, de poids du passé dans les interprétations présentistes du monde ?
Faut-il mettre à distance l’expérience sans trahir ? Faut-il encore interpréter ? Peut-on changer de corps par la fiction ? Comment représenter et être représenté ? La rationalité peut-elle encore nous désencastrer des situations ? Que déléguer aux intelligences immédiates que sont les IA contemporaines et qui nous donnent l’impression de court-circuiter nos raisonnements ? Sans nécessairement répondre à toutes ses questions, on proposera de commencer à redonner de l’épaisseur aux supposées transparences, de l’opacité aux dés-intermédiations algorithmiques, du style aux formes de l’immersion, des stratégies dans les pratiques d’authenticité, du savoir dans les narrations les plus directes, de la résistance dans la traductibilité du monde ou bien encore de l’intelligence dans les arts de la performance. S’il faut sans doute poser des contrepoisons à l’accélérationisme englobant qui empêcherait la distance critique et l'action collective comme de la résistance à la fausse transparence du code et de ses plateformes, il parait ainsi possible de réinjecter de la théorie dans des pratiques supposément plates, mais peut-être tout aussi médiées et riches que celles qui les précédaient. Tel serait bien le chantier nouveau des sciences humaines et sociales et de leur tradition critique et constructiviste : réintroduire de la réflexivité et du jeu dans notre ivresse de l’immédiat.
Séminaire interdisciplinaire organisé de manière hybride, en Sorbonne (bâtiment C, deuxième étage, salle F007 sauf la première sur zoom uniquement et la dernière séance du 4 juin qui aura lieu à la salle de musique de l'ENS 46 rue d'Ulm) et sur Zoom : https://cnrs.zoom.us/j/98652056272?pwd=jYvNZaL8WgwqvP8LVNIequghG3bTEl.1
· Jeudi 6 novembre de 18 h à 20 h L’immédiateté : une histoire littéraire et philosophique avec Dominique Château (uniquement sur zoom)
· Jeudi 18 décembre de 18 h à 20 h Comment exister sur Instagram ? Immédiateté et réseaux sociaux, avec Lea Como et Beatrice Latini (en Sorbonne et sur zoom)
· Jeudi 22 janvier de 18 h à 20 h La littérature sans médiation, de l’écriture blanche au récit de non-fiction, avec Frédéric Martin Achard et Dominique Rabaté (en Sorbonne et sur zoom)
· Jeudi 19 février de 18 h à 20 h Écritures de témoignage, littératures d’enquête crise de la représentation, avec Sylvie Servoise et Aurélie Adler (en Sorbonne et sur zoom)
· Jeudi 12 mars de 18 h à 20 h L’immédiateté en démocratie ? Avec Sandra Laugier et Sylvain Bourmeau (en Sorbonne et sur zoom)
· Jeudi 9 avril de 18 h à 20 h Qu’est-ce qu’une ontologie plate ? Avec Tristan Garcia (en Sorbonne et sur zoom)
· Jeudi 4 juin de 18 h à 20 h séance concert : Créer dans l’immédiat, l’exemple de l’improvisation musicale avec Karol Beffa (salle de musique de l'ENS et sur zoom)