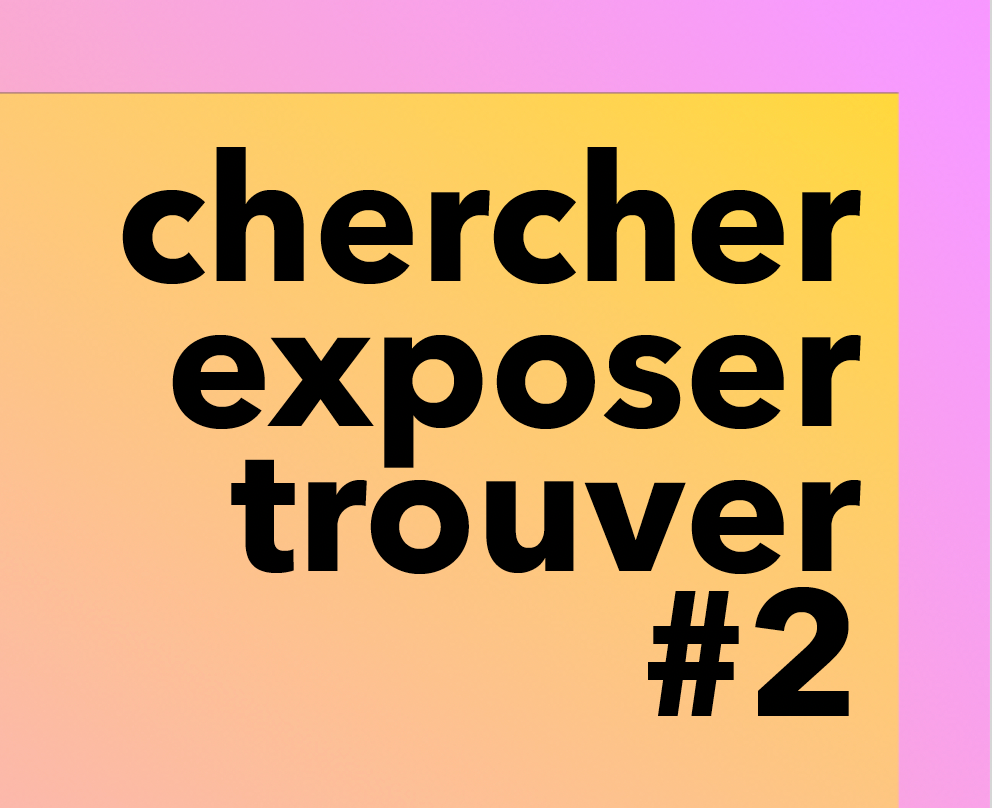
Chercher – exposer – trouver #2
Les variations de l’exposition : itérations et objets satellites pour la recherche
Colloque pluridisciplinaire
Université de Liège (Belgique)
Les 1-2-3 avril 2026
Après une première rencontre au Musée d’archéologie de Nice / Cimiez en 2024 [1] qui a permis de mettre en avant le caractère heuristique des expositions pour les chercheurs et chercheuses de divers horizons, la deuxième édition de Chercher-exposer-trouver vise à approfondir notre compréhension des effets de l’écriture expographique sur la recherche et ses objets. Ces effets seront cette fois abordés à travers les logiques de reprise des expositions et de leurs objets-satellites. Ces variations concernent autant les produits d’exposition (les écrits) que les méthodes dérivées de l’écriture expographique : exposition itinérante (qui implique réécriture ou traduction), exposition miniature (cabinet de curiosité et autre format portatif qui s’appuie sur le même langage), ou encore les produits d’éditions qui découlent de l’exposition ou qui s’en inspirent (catalogue, folio, etc.). Interroger ce que font ces variations permettra d’identifier autant les logiques heuristiques de l’écriture expographique, que celles des réécritures, pour penser l’exposition non comme une fin en soi, mais comme un moyen pour les chercheur·es-en-train-de-chercher. Comme pour la première édition, cette deuxième rencontre, pluridisciplinaire, vise une meilleure compréhension des expositions comme objets complexes, en prenant en compte leur diversité historique, théorique et politique. Il s’agit ainsi de poser les bases d’un champ interdisciplinaire, les Exhibition Studies, qui considère les expositions non seulement comme des formes de créations contemporaines ou patrimoniales, mais aussi comme des dispositifs de recherche et de création à part entière.
Session 1 - Variations itinérantes
L’itinérance d’exposition offre, à certaines conditions, matière à penser. Elle doit parfois s’adapter à un nouvel espace et une nouvelle scénographie, intégrer des objets issus des collections locales, ou supprimer des éléments devenus inopérants dans le nouveau contexte culturel, institutionnel ou politique investi. Lorsque l’itinérance n’est pas simple « téléportation », elle oblige donc à adapter une première version expographique – processus qui n’est pas sans conséquence et qui peut être source de réflexion pour la recherche, en engageant un travail de reformulation à partir de nouvelles contraintes matérielles, discursives et symboliques. Ces nouvelles contraintes peuvent mettre à l’épreuve les choix initiaux : pertinence des dispositifs, équilibre du discours, légitimité des objets sélectionnés, et surtout repérage de ce qui, dans la première version, relevait de l’automatisme ou de l’implicite. Ce que l’on pensait aller de soi est alors interrogé, déplacé, voire remis en cause. La réécriture devient un révélateur d’éventuelles habitudes et normes, dont il est possible de se détacher une fois celles-ci identifiées.
Session 2 - Variations portatives
D’autres formats itinérants sont à rapprocher de l’exposition : l’agencement d’objets dans un format portatif, avec l’intention constitutive de dire et en même temps de montrer. L’exposition devient alors cabinet de curiosités portatif, ou exposition-postale : pensée pour être envoyée ou découverte ailleurs et autrement. Il ne s’agit plus de penser un espace à parcourir, mais bien de « claquemurer, pour ainsi dire, toute l’exposition » — pour paraphraser Jean Davallon. Réduite et condensée, elle devient un objet portatif et manipulable. Elle s’ouvre et se ferme, s’expédie, se déploie selon les contextes et les besoins. Ce n’est plus le visiteur qui se déplace dans l’exposition, mais l’exposition elle-même qui voyage d’un lieu à l’autre, qui demande à être ouverte pour révéler son contenu, à être manipulée pour pleinement exister — l’exposition n’est plus pensée comme un lieu à habiter mais comme un format à activer. Quels impacts les caractéristiques du format ont-ils sur la pensée du chercheur ou de la chercheuse qui met en boîte sa recherche, ou qui anticipe l’activation ? Comment la recherche est-elle pensée lorsqu’elle est saisissable dans sa totalité, car délimitée et non dispersée dans un espace à parcourir ?
Session 3 - Variations éditoriales
Une autre forme de réécriture de l’exposition s’opère dans son passage au format éditorial, notamment celui du livre. Cette transposition ne relève pas d’une simple documentation ou d’un prolongement illustratif, mais engage une véritable reconfiguration des contenus et des intentions, à travers des formes qui, elles-mêmes, s’affranchissent souvent des normes académiques. Si une exposition peut s’appuyer sur une publication scientifique, les livres issus d’une exposition prennent parfois la forme d’un catalogue raisonné, d’un essai visuel, d’une édition limitée expérimentale, d’un PDF interactif ou d’un site web multimédia. Dans quelle mesure l’exposition, en tant que dispositif de médiation et de réflexion, contamine-t-elle les modes traditionnels de production et de diffusion du savoir ? En quoi l’attention accrue portée à la spatialisation du discours, à sa dimension visuelle, à la scénarisation de ses contenus – caractéristiques des dérivés éditoriaux, influe-t-elle sur une manière de penser ? Comment s’articulent écrits académiques et écrits d’exposition ?
Tout autre type de variation est le bienvenu… De manière transversale — fortune et infortune de la réception — nous aimerions interroger la réception de ces « objets satellites non identifiés » : dans quels écosystèmes atterrissent-ils ? Comment la communauté scientifique accueille ces productions pour faire valoir ou reconnaître leur valeur scientifique ? Etc.
—
Pour répondre
Les propositions sous format PDF (300 mots environ, si possible avec illustrations) sont attendues pour le 31 octobre 2025, accompagnées d’une courte biographie, à chercher.exposer.trouver@gmail.com.
Colloque organisé par l’Université de Liège, en collaboration avec l’UCLouvain, sous la direction de Camille Béguin (ULiège), Thomas Beyer (ULiège), Sofiane Laghouati (Domaine & Musée royal de Mariemont / UCLouvain), Nicolas Navarro (ULiège) et Anne Reverseau (FNRS / UCLouvain).
—
Bibliographie indicative :
ATHANASSOPOULOS Vangelis et Nicolas BOUTAN (dir.), « Le commissariat comme forme de recherche » (dossier), Proteus, n°10, 2016.
BÉGUIN Camille, « Le média exposition et le chercheur en sciences sociales : pourquoi écrire la recherche en trois dimensions ? », ExPosition, n°8, 2023.
BÉGUIN Camille et Patrizia LAUDATI, « The Researcher-Curator : what experience poietic ? », Punctum – International Journal of Semiotics, n°10/2, 2025, pp. 61-80.
BJERREGAARD Peter (ed.), Exhibitions as Research. Experimental Methods in Museums, Abingdon, Routledge, 2020.
DAVALLON Jean (dir.), Claquemurer, pour ainsi dire, tout l’univers : la mise en exposition, Paris, Centre Georges Pompidou-CCI, 1986.
DAVALLON Jean, L’exposition à l’œuvre, Paris, L’Harmattan, 1999.
DAVALLON Jean, « L'écriture de l'exposition : expographie, muséographie, scénographie », Culture & Musées, n°16, 2010, pp. 229-238.
BERT Jean-François et Jérôme LAMY, Voir les savoirs : lieux, objets et gestes de la science, Paris, Anamosa, 2021.
GARCIA Tristan et Vincent NORMAND (eds.), Theater, garden, bestiary : a materialist history of exhibitions, Lausanne, Berlin, EXAL Sternberg Press, 2019.
JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir. Espaces et communautés, Paris, Albin Michel, 2007.
JACOB Christian (dir.), Lieux de savoir 2. Les mains de l’intellect, Paris, Albin Michel, 2011.
KARA Helen, Creative Research Methods. A practical guide. Bristol, Policy Press. 2020.
LATOUR Bruno, La Science en action, Paris, La Découverte, 1989 [1987].
LEHMANN-BRAUNS Susanne, Christian SICHAU and Helmuth TRISCHLER (eds.), The Exhibition as Product and Generator of Scholarship, Berlin, Max Planck Institute for the History of Science, 2010.
MACDONALD Sharon, The Politics of Display: Museums, Science, Culture, London, New York, Routledge, 1998.
MACDONALD Sharon and Paul BASU (eds.), Exhibition Experiments, Malden, Blackwell Publishing, 2007.
PERSHON, Lindsay, « Curation as methodology », Qualitative Research, n°21/1, 2020, pp. 20-41.
REVERSEAU Anne, « Littérature et culture visuelle : L’exposition au cœur de la recherche », Entre-temps.net, rubrique « Façonner », 7 novembre 2023.
WAQUET Françoise, L’ordre matériel du savoir : comment les savants travaillent, XVIe-XIXe siècles, Paris, CNRS Éditions, 2015.
NB. Pour la question spécifique des liens entre exposition et littérature, voir la bibliographie établie par le groupe RIMELL sur leur site:
https://www.litteraturesmodesdemploi.org/bibliographie/
—
[1] Chercher-exposer-trouver #1, les 28 et 29 novembre 2024, sous la direction de Camille Béguin : https://siclab.fr/journee-detude-11. Actes à paraître.