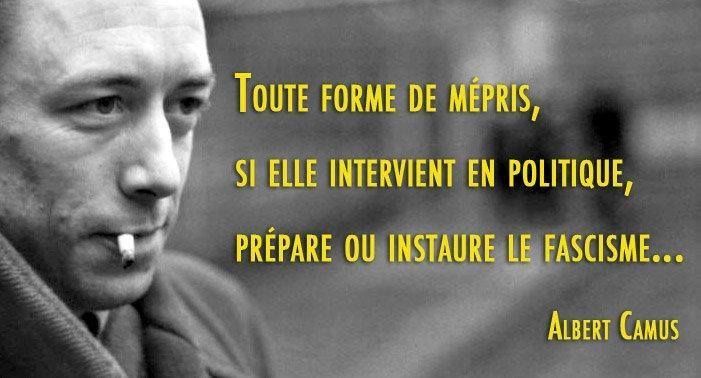
Nous vivons dans une "société du mépris". Chacun se sent méprisé en fonction de son sexe, ses origines, ses revenus, son lieu d’habitation ; des professions entières en font également les frais (éducation, santé, social, justice), parce que l’autorité des institutions décline. Les minorités sont discriminées par la majorité, souffrant, elle, du surplomb des élites. L’imaginaire national, en chute symbolique, subit le mépris du reste du monde. Ce mal touche aussi le sujet libre et responsable, qui peut vivre comme un mépris tout obstacle à son accomplissement, le mépris de soi-même en premier lieu. Dès lors, il est tentant de s’en libérer en dépréciant les autres : le mépris n’est pas un conflit social mais une chaîne d’accusations. Il a remplacé l’"exploitation" comme clé d’explication universelle et rapport au monde. Qu’il soit subi ou mobilisé, le mépris n’est pas une émotion démocratique. Source d’indignations et de ressentiments, il déborde racisme et mépris de classe pour devenir l’énergie émotionnelle des populismes. Que devons-nous faire pour que le sentiment du mépris trouve des expressions culturelles et politiques dans une société démocratique ? Telle est la question posée par François Dubet dans Le mépris. Émotion collective, passion politique, qui paraît dans la collection "La république des idées" des éditions du Seuil.