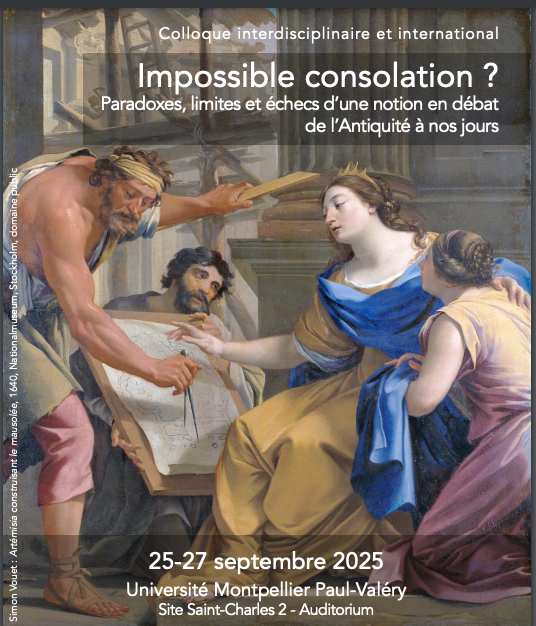
Impossible consolation ? Paradoxes, limites et échecs d’une notion en débat de l’Antiquité à nos jours
Face aux fléaux en tous genres qui ont coutume de s’abattre sur le genre humain, les Grecs et Romains faisaient volontiers appel aux méthodes des orateurs et aux arguments des philosophes. Pour soulager les affligés, les Anciens se fiaient aux vertus curatives du logos, prodigué par une parole amicale. Avec l’invention du christianisme, la religion s’est appropriée cette mission en recyclant les méthodes anciennes par la perspective d’un au-delà rédempteur. C’est ainsi que de l’Antiquité grecque au XVIIe siècle s’est progressivement forgé un arsenal discursif qui a alimenté une littérature visant « à dissiper ou du moins à modérer, autant que possible, le chagrin suscité par les événements malheureux ou considérés comme malheureux selon l’opinion courante (décès, maladie, exil, vieillesse etc.) en aidant la personne consolée à retrouver la tranquillité de l’âme » (Pernot 2000, 261). Cependant, le terme consolation a perdu en chemin une partie de son ancrage logico-discursif : l’acte de consoler n’est plus désormais associé à un certain type de discours, régi par des normes oratoires. Si la consolation occupe encore une place importante dans nos pratiques sociales, non seulement ses liens originels avec la rhétorique, jugée contraire à la sincérité, se sont fortement distendus (Martin-Ulrich 2017), mais elle est sortie du champ de la philosophie contemporaine, qui en dénonce les illusions ou la complaisance (Foessel 2015, 10-11 ; Delecroix 2020, 67-82). Quant à la religion, elle a pour ainsi dire perdu à son tour « le monopole de la consolation » (Delecroix 2020, 221). De fait, ce n’est peut-être pas seulement la rhétorique consolatoire qui est obsolète mais ses fondements mêmes. Dans une société laïque, « matérialiste » et individualiste, le processus de consolation, qui reposait traditionnellement sur des valeurs transcendantes et collectives, est à la peine. Face à la perte, que reste-t-il d’autre que la révolte ou le divertissement ?
Dans ces conditions, ravivée par le développement de la psychanalyse (Freud 1917), la question est plus actuelle que jamais : comment soulager la souffrance d’autrui ? Quel réconfort apporter à un ami ou à un proche dans la peine ? Comment parler de la mort ? Elle qui « échappe aux mots, car elle signe précisément la fin de la parole. Celle de celui qui part, mais aussi celle de ceux qui lui survivent et qui, dans leur sidération, feront toujours de la langue un mauvais usage. Car les mots dans le deuil ont cessé de signifier. Ils ne servent qu’à dire combien plus rien n’a de sens » (Horvilleur 2021, 112-113). Ces interrogations et ces doutes ne sont pas l’apanage des sociétés modernes puisque, de Cicéron à Kierkegaard, en passant par Montaigne, les siècles passés n’ignoraient pas non plus les limites de la consolation comme l’attestent les figures d’inconsolés qui peuplent la littérature, d’Orphée à Niobé, d’Artemisia au Desdichado.
Dès l’Antiquité en effet, l’utilité des discours de réconfort fut l’objet de controverses qui restent d’actualité : en réponse aux injonctions normatives de la société, qu’elles renvoient à un idéal élitaire de maîtrise de soi ou à une idéologie du think positive, de nombreuses voix se sont élevées pour revendiquer le droit au désespoir et à la mélancolie face à une perte insubstituable (Delecroix & Forest 2017, 17- 92). Si la consolation peut apparaître dans certaines sociétés comme un devoir d’humanité, elle se heurte au « refus d’acquiescer à la limite que le réel oppose à notre désir, par où l’Autre échappe » (Le Ninèze 1997).Or, même si la mission de soulager l’affliction est aujourd’hui majoritairement dévolue à la médecine, à la psychothérapie, ou, le plus souvent, aux méthodes de développement personnel, qui sont pour la plupart de pales imitations des exercices spirituels antiques, la littérature offre une expression privilégiée à cette inconsolation radicale, qui illustre la défaillance constitutive de toute consolation (Dagerman 1955). De fait, au-delà de la guérison que laisse espérer la bibliothérapie (Ouaknin 1994 ; Detambel 2005 ; 2023), la littérature a encore et toujours quelque chose de particulier à dire sur l’incommensurabilité de la douleur, sur l’insatiable besoin de consolation et sur le paradoxe d’une parole qui trouve son origine dans une « impuissance assumée » (Delecroix 2020, 183). On se propose d’examiner l’expression de ces résistances et de ces échecs, qui, à chaque époque, invitent à repenser les modalités de la relation à autrui et à interroger le statut de la consolation.
Ce colloque s’inscrit dans un projet de recherche dont l’un des résultats est la publication de la Bibliothèque Idéale de la consolation de l’Antiquité au XVIIe siècle (Paris, Les Belles Lettres, 2025). L’objectif est de croiser les perspectives disciplinaires afin de mieux comprendre le phénomène de la consolation, dans ses dimensions historiques, sociales, religieuses, et psychologiques.