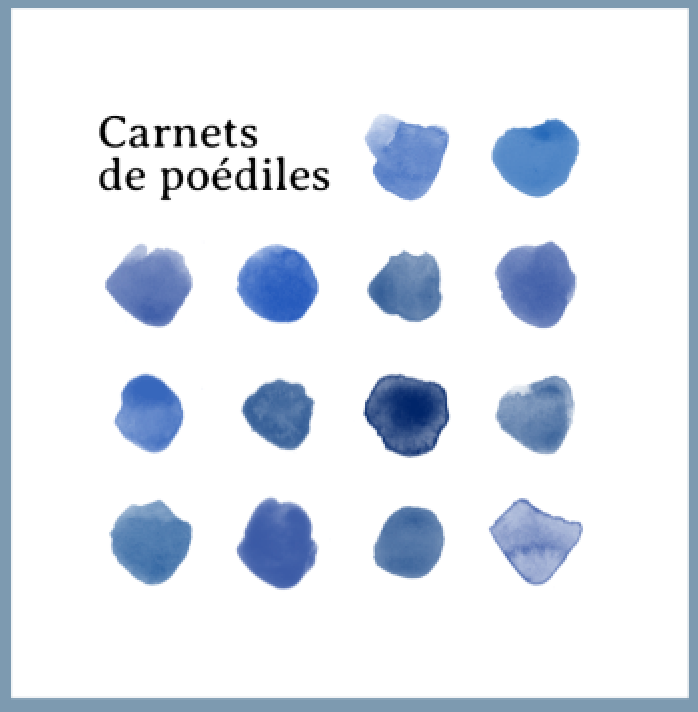
Le troisième appel à contribution des Carnets de Poédiles s’intéresse à la naissance du poème, comme temps de préparation de l’écriture tout aussi bien que temps décomposé de la fabrique du poème. Il s’agit de recevoir la naissance du poème dans une compréhension créative, stratégique, processuelle, matérielle ou documentaire de ce(s) moment(s), déterminant(s) dans l’invention du poème et pourtant faiblement considéré(s) en tant que tel dans les approches didactiques de la littérature.
La poésie, en tant que mode de discours extrêmement divers selon les époques, les cultures, a régulièrement mis en scène et en voix les origines de sa création ; on pense à l’invocation à la muse ou aux arts poétiques. A l’âge de la modernité, ces motifs rhétoriques de l’inspiration ont laissé la place à l’entreprise du faire (Francis Ponge, La fabrique du pré). Dans une perspective didactique, l’appel à contributions accueille toutes propositions et réflexions sur des protocoles et des résultats de recherche qui se distinguent par leur attention particulière aux conditions de l’émergence du poème, dans la classe et hors la classe, quel que soit le public concerné, de l’école à l’université, enfant ou adulte.
Se pencher sur la naissance du poème, c’est en première approche, déplier les différentes motivations qui président à sa réalisation. En suivant Yves Bonnefoy, on peut estimer qu’ « il n’y a aucune vérité à concevoir un antagonisme entre l’étude et la création » ; dès lors, on peut s’intéresser à la part des savoirs, notamment littéraires, retenus dans la conception d’un projet d’écriture et à la manière dont ils entrent dans la conception de l’expérience d’écriture poétique. Un tel présupposé, une alliance entre savoir et création, ne restreint cependant pas les horizons de la création, bien au contraire. S’il n’y a pas une coupure entre le savoir et l'invention créative, l'usage créatif du langage, si l’expérience d’écriture offre un accès à la connaissance de l'exercice poétique du langage, elle excède et sans doute conteste l’idée d’une pratique mimétique de l’écriture comme seule illustration d'un savoir académique. Parce que les savoirs sont pluriels, penser la naissance du poème, c’est aussi envisager l’écriture comme possibilité de subjectivation littéraire. En s’émancipant de la relation critique vis-à-vis des textes, ou en la pensant avec Jean Starobinski comme « participation à l’événement poétique », « savoir sur la parole repris dans une nouvelle parole » prête à « courir les risques de l’œuvre » (Starobinski, 1970 : 55), l’expérience sensible de l’écriture peut donner accès à l’émotion poétique et à la connaissance du poème. Entrer par l’écriture vise à créer une empathie lyrique définie par le poète et critique Antonio Rodriguez comme la « capacité de ressentir et d’imaginer la vie affective d’autrui » (Rodriguez, 2016 : 55) tout comme l’activation de l’écriture poétique se conçoit comme un mode particulier d’accès au réel. Loin de se cantonner aux savoirs institués, la naissance du poème peut viser à ce que chaque sujet-lecteur-scripteur puisse « s’emparer du pouvoir de poser les questions qui comptent au lieu de se contenter de répondre à celles qu’aura formulées autrui » (Citton, 2007 : 17), tout en assumant la part d’incertitude contenue dans l’acte de créer. Dans l’écriture se joue ce que dit Michaux : « j’écris pour me parcourir » (1950).
Comment engager ce parcours de soi et du monde, et penser les conditions de son effectuation dans la naissance du poème ? Il est question dans cette deuxième perspective d’étude de retenir les cadres scolaires ou non scolaires de la fabrique de l’écriture. La question du dispositif est au cœur de la création poétique et on peut faire l’hypothèse que la compétence et l’invention sont intimement reliées au dispositif en tant qu’espace de questionnement, de problématisation, de processus de création. Espace aussi de sociabilité des sujets-lecteurs-scripteurs, capable de soutenir le développement de la création verbale, admis comme un attribut du collectif, car « ce qui fait compétence, c’est cet agencement collectif que le groupe constitue et qui, en retour, devient constitutif de son action » (Le Strat, 2008).
De l’école à l’université (Houdart Merot, 2013), dans des formats apparentés aux cercles d’auteurs (Tremblay et al., 2020) ou encore aux ateliers d’écriture (et dont on pourra mesurer les emprunts) (Oriol-Boyer et Bilous, 2013), les dispositifs introduisent une série de gestes - manipuler, transformer, reprendre– jugés parfois déplacés voire irrévérencieux–, qui sont ceux grâce auxquels les apprentis scripteurs accèdent à une connaissance et à une expérience sensible par l’exercice du Faire. Qu’il s’agisse d’ateliers avec leur mode de fonctionnement singulier, leurs outils de génération de texte, de rituels de classe, de séquences d’enseignement où la question de l’écriture poétique est posée comme centrale, il peut être intéressant d’examiner la façon dont la conception stratégique des situations d’écriture favorise la créativité verbale et fait du dispositif une inventivité productive. Comment la contrainte se trouve valorisée (Oriol-Boyer, 2013), comment s’opère la rencontre entre l’intime du sujet et la régularité de formes codifiées ou s’éprouve le creusement des subjectivités dans une confrontation avec une écriture contemporaine (Eyries, 2013) sont des questions qui intéressent le dispositif, articulées aux enjeux tout aussi déterminants de l’espace et de la temporalité. Les écritures hors de la classe, au musée, les écritures in situ renouvèlent l’expérience poétique et configurent la naissance du poème, inscrit dans un environnement inédit.
La naissance du poème est aussi tributaire des matériaux, entendus au sens large. C’est la troisième perspective retenue. Ces matériaux peuvent être de différentes natures : corpus poétiques, littéraires ou non littéraires, biographiques ou documentaires, réservoir de mots, structures langagières ou déclencheurs d’écriture (Bisénius-Pénin, 2013) qui forment la matière d’engagement dans le processus de création. Linguistiques, génériques, idéels, ces matériaux sont aussi couramment iconiques, installant le poème dans des relations intermédiales qui font appel aussi bien aux pratiques artistiques (photographie, peinture, graphisme…). Une poésie hors du livre s’invente grâce aux technologies contemporaines et se pense dans des rapports nouveaux d’intermédialité et de transmédialité : la Littératube (Bonnet et Fülöp 2023 ) , l’écriture assistée de l’Intelligence artificielle (Petitjean, 2024), les réseaux sociaux (Belin, 2020) les outils collaboratifs inventent leurs propres modes de génération et de réception poétiques. Les brouillons d’écrivains constituent aussi un matériau d’écriture original pour écrire avec / dans la parole du poète, exploiter les ressources de l’écriture, rappelant la puissance du signifiant à réorienter le dire, à ouvrir de nouvelles voies en assumant les contradictions, en ajustant la parole poétique, contestant la croyance selon laquelle l’idée précèderait nécessairement la mise en mots. Plus prosaïquement mais de façon tout aussi décisive, la page blanche est un espace à interroger et avec elle le dessin, les traces d’origines diverses qui accompagnent la naissance du poème. La spatialité peut être un vecteur essentiel de génération poétique.
La quatrième et dernière perspective est difficilement déconnectée des précédentes puisqu’il est question des processus à l’œuvre dans la naissance du poème. Il y a en premier lieu dans les pratiques didactiques l’incontournable enjeu des interactions lecture-écriture. Les genres poétiques, avec leurs règles, leurs régularités formelles, le poème lu sont encore souvent une ressource d’écriture, dans un principe d’imitation du modèle de majordomes rédactionnels, même si on peut s’accorder sur le fait que la pratique imitative présente des limites quand elle est faiblement motivée, contextualisée, problématisée. Le dépassement du modèle rhétorique peut constituer un horizon de la naissance du poème. En s’attachant à l’expérience du sujet-lecteur-scripteur, la didactique de la littérature a pu privilégier les processus d’appropriation subjective du texte poétique et chercher à définir l’immersion lyrique comme une disposition à discuter, à prolonger la transaction établie entre le poète et le réel, à apprécier une posture d’existence dont le lecteur fait l’expérience non comme une vérité stable et intangible mais comme une proposition (Favriaud, 2011 ; Boutevin et al., 2018). Ces formes d’appropriation peuvent s’accompagner d’un trouble dans l’identification de l'appartenance de la parole poétique - jusqu’où cette parole est-elle la mienne ou celle d'un autre ? L’écriture, par le jeu des réénonciations, assure aussi un accès à une expérience de lecture au cours de laquelle le sujet-scripteur, par le jeu de la confusion accentuée du Je, réécrit la scène lyrique, la transpose, ou s’emploie à restituer une perception, une compréhension/interprétation sensible, en la déplaçant dans son univers mental et langagier. Quels sont les processus cognitifs, psycho-affectifs, langagiers qui rendent possible l’invention d’un texte, l’incorporation d’un texte-source, l’émergence d’une proposition alternative d'une figuration entre le sujet lyrique et le monde ? Éprouver l’expérience créative en appréhendant intérieurement ses rythmes, ses aléas, ses blocages, entrer dans les processus de réécriture participe de la naissance du poème. Mais on ne saurait non plus négliger l’horizon du partage de la création poétique comme ressort de l’écriture et partie intégrante de la genèse. Même si le partage, sous une forme écrite ou orale, est une étape qui n’est pas nécessairement ultime, et installe l’écriture dans un processus dialogique (Caffari et Mohs, 2018) il détermine aussi le processus de création, il oriente l’invention du poème. Le processus dialogique ouvre-t-il l’espace des reconnaissances mutuelles au sein d’une communauté d’apprentis-poètes ?
Ces axes problématiques ne se veulent pas contraignants et ont vocation à interagir entre eux, comme à s’ouvrir à d’autres perspectives de recherche relatives à la création poétique. Pour ce troisième numéro des Carnets de Poédiles, sont attendus des articles scientifiques qui permettent d’éclairer un ou plusieurs aspects de la problématique du numéro. Nous souhaitons que la naissance du poème soit interrogée dans des contextes variés et du point de vue de différentes disciplines : la littérature, le français langue étrangère, les langues vivantes, les langues anciennes, les arts… de l’école maternelle à l’université, et hors de l’école. Les articles seront proposés en langue française mais ils peuvent s’appuyer sur des investigations didactiques réalisées dans toutes les langues.
Modalités de soumission et calendrier
• 1er Octobre 2025 : envoi des propositions d’articles aux 3 adresses suivantes :
- francois.le-goff@univ-tlse2.fr
• 1er novembre 2025 : retour aux auteurs et autrices des propositions pour acceptation ou refus motivé.
• 1er septembre 2026 : réception des articles complets (entre 30 et 40000 signes espaces compris).
• 1er octobre 2026 : retour des évaluations et demande éventuelle de réécriture.
• 1er décembre 2026 : réception des articles définitifs
• Mars 2027 : publication des articles.
Les propositions d’articles se présenteront sous la forme d’un résumé (5 à 6000 signes espaces compris) assorti de 5 mots-clés et d’une bibliographie de 6 à 8 références. La problématique, les objectifs et la méthodologie de recherche y seront clairement énoncés.
Les auteurs et autrices veilleront à mentionner leurs coordonnées complètes (statut, institution de rattachement et courriel).
Les articles feront l'objet d'une double expertise anonyme.
—
Éléments de bibliographie
Anis J. (1983). Préparatifs d’un texte : La fabrique du pré, de F. Ponge. Langages n°69.
Anis J. (1991). Gestes d’écriture de Francis Ponge. Dans L’Écriture et ses doubles. Paris : Éditions du CNRS.
Bellemin-Noël, J. (1972). Le Texte et l’avant-texte : les brouillons d’un poème de Milosz. Paris : Larousse.
Belin, O. (2020). Vers une poésie commune ? Les poètes amateurs de Twitter, Instagram et Wattpad. Nouvelle Revue d’esthétique, 25. https://shs.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2020-1-page-57?lang=fr
Belin, O. (2013). Le coin des poètes: l'expérience poétique dans les journaux des lycéens. Pippa
Belin, O. (2022). La poésie faite par tous. Bruxelles : Les Impressions nouvelles.
Benameur, J. (2025). Vers l’écriture. Récit de transmission. Arles : Actes Sud
Bisénieus-Pénin, C. (2013). Écriture à contraintes et processus de création à l’université. Dans
Oriol-Boyer, C. & Bilous, D. (dirs), Ateliers d’écriture littéraire. Paris : Hermann, 393-408.
Boré, C. (2000). Le brouillon : introuvable objet d’étude ?. Pratiques, 105/106, 2000, 23-49.
DOI : 10.3406/prati.2000.2401
Bobillot, J.-P. (2016). Quand éCRIre, c’est CRIer. De la POésie sonore à la médioPOétique & autres nouvelles du front. Saint-Quentin-de-Caplong : Éd. L’Atelier de l’agneau.
Bon, F. (2005). Tous les mots sont adultes : méthode pour l’atelier d’écriture. Paris : Fayard.
Bon, F. (2012). Apprendre l'invention : sur les ateliers d'écriture, 1994-2008. Montpellier : Publie papier.
Bonnet, G., Fülöp, E. et Théval, G. (2023). Qu’est-ce que la littéraTube ?. Montréal : Les Ateliers de [Sens public]
Boutevin, C., Brillant Rannou, N. & Plissonneau, G. (dir.) (2018). À l’écoute des poèmes. Enseigner les lectures créatives. Bruxelles : Peter Lang.
Brillant Rannou, N. et Petit, C. (2015). Devenir lecteur et scripteur de poésie en primaire : quelle expérience ? Quels enjeux ?. Repères 52, 159-176. http://reperes.revues.org/967.
Brillant Rannou, N., Boutevin, C. et Brunel, M. (dirs.) (2016). Être et devenir lecteur(s) de poèmes. De la poésie patrimoniale au numérique. Namur : Presses universitaires de Namur.
Brillant Rannou, N. (2017). Les gestes d’écriture en résidence : du carnet de bord au numérique. Dans C. Bisenius-Penin, (dir.) Résidence d’auteurs, création littéraire et médiations culturelles. Metz : Presses Universitaires de Lorraine, 71-95.
Caffari, M. et Mohs, J. (2018). Écritures contemporaines et processus dialogiques. A contrario, 27(2), 3-20.
Canvat, K. et Legros, G. (1997). Enseigner la poésie moderne ?. Pratiques, 93, 5-29.
Cabot, J. (2018). La poémaïeutique. De la pratique de la poésie oralisée comme didactique empirique. Pratiques, 179-180, https://univ-tlse2.hal.science/hal-02055161/document
Ceysson, P. (2006). La poésie contemporaine. L’institution scolaire et les « règles de l’art ». Revue de linguistique et de didactique des langues, 33, 1-12.
Citton, Y. (2007). Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ? Paris : Éd. Amsterdam.
Collot, M. (1989). La poésie moderne et le structure de l'horizon. Paris : PUF.
Collot, M . (1992). Génétique et thématiques : gravitations de Supervielle. Études françaises, t. XXVIII, I. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 91-108.
Collot, M. (1992). Tendances de la genèse poétique. Genesis, 2, « Manuscrits poétiques ». Paris : Jean-Michel Place, 11-26.
Collot, M. (1997). La Matière-émotion. Paris : PUF.
Costéro, E. et Risselin, K. (2016). Les gestes du brouillon. Les Cahiers pédagogiques, 515.
Debray Genette, R. (1977). Génétique et poétique. Littérature, 28. Paris : Larousse, 19-39.
Debreuille, J.-Y. (1998). Un Poète dans la classe. Jean-Vincent Verdonnet. Lyon : PUL.
Escamez Charlotte (2016). La classe vive - pour une poétique de l'atelier d'écriture. Arles : Actes Sud.
Eyries, A. (2013). Expériences d’écriture à l’écoute d’Henri Meschonnic. Dans V. Houdart-Merot et C. Mongenot (dirs.). Pratiques d’écriture littéraire à l’université. Paris : Honoré Champion. 305-314.
Fabre, C. (1990). Les brouillons d’écoliers ou l’entrée dans l’écriture, Grenoble : Céditel / L’atelier du texte.
Favriaud, M. et al. (2011). Le poème du lecteur : mémorisation, imagination, compréhension – et image de soi. Dans C. Mazauric, M.-J. Fourtanier et G. Langlade &, (dirs.), Textes de lecteurs en formation. Bruxelles : Peter Lang.
Favriaud, M., Vinsonneau, M. & Poletto, M. (2017). Les chemins de poésie d’Alep. Poétique et didactique du dire-lire-écrire à l’école primaire. Limoges : Lambert-Lucas.
Fenoglio, I. (2005). Du manuscrit à l’édition. Genèse du poème combat d’Andrée Chedid. Degrés, 121-122.
Gautier, V. (2022). Vers les terres vagues. Approche de la zone à défendre. Marseille : ed. Nous, coll. Disparate.
Houdart-Merot, V. et Mongenot ; C. (dirs.) (2013). Pratiques d’écriture littéraire à l’université. Paris: Honoré Champion.
Jean, G. (1997). Comment faire découvrir la poésie à l’école. Paris : Retz.
Kervyn, B. et Faux, J. (2014). Avant-texte, planification, révision, brouillon, réécriture : quel espace. Pratiques, 161-162. https://journals.openedition.org/pratiques/2172
Le Français aujourd’hui (1996). Il y a poésie & poésie. 114.
Le Goff, F. et Larrivé, V. (2018) Le temps de l’écriture. Écritures de la variation, écritures de la réception Grenoble : UGA Éditions, 2018. 248 p. Collection « Didaskein ».
Le Goff, F. (2013). Fiction énonciative et imaginaire du lecteur dans la formation d’une bibliothèque patrimoniale. Dans N. Denizot et S. Ahr, Les Patrimoines littéraires à l’école, usages et enjeux, Namur : Presses Universitaires de Namur, coll. « Diptyque ». p. 99-118.
Mahrer, R. (2009). De la textualité des brouillons. Modèles linguistiques, 59. http://journals.openedition.org/ml/333 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ml.333
Martin, M.-C. et Martin, S. (1997). Les poésies, l’école. Paris : PUF.
Martin, S. (2010). Présentation. Les poèmes au cœur de l’enseignement du français. Le Français aujourd’hui, 169, 3-14.
Michaux, H. (1950). Passages. Paris : Gallimard.
Murzilli N. (2024). L’écriture poétique en recherche-création : façonner des publics, expérimenter des agirs. Dans V. Houdart-Merot (dir.), Le tournant créatif de la recherche. Presses Universitaires de Vincennes.
Nicolas-Le-Strat, P. (2008). Des compétences indisciplinées, https://pnls.fr/des-competences-indisciplinees/
Oriol-Boyer, C. et Bilous, D. (dir.) (2013). Ateliers d'écriture littéraire. Hermann. https://doi.org/10.3917/herm.oriol.2013.01.
Oriol-Boyer, C. (2013). Le texte littéraire comme théâtralisation de mécanismes langagiers. Dans Houdard-Merot, V. & Mongenot, C. (dirs), Pratiques d’écriture littéraire à l’université. Paris : H. Champion, 71-90.
Petitjean, A. (2024). Que devient la créativité littéraire à l’heure de ChatGPT ? L’évolution d’un atelier d’écritures numériques en master de création littéraire. Le français aujourd'hui, 226(3), 85-100. https://doi.org/10.3917/lfa.226.0085.
Rodriguez, A. (2016). « L’émotion poétique » face aux crimes contre l’humanité : Reverdy et les pouvoirs de l’empathie. Littérature, 183, p. 51-63.
Rouvière, N. et Shawky-Milcent, B. (2024). De l’écrivain professeur au professeur écrivant. UGA Éditions.
Siméon, J.-P. (2015). La poésie sauvera le monde. Paris : Le Passeur.
Starobinski, J. (2010). La relation critique. Paris : Gallimard.
Tremblay, O., Turgeon, E. & Gagnon, B. (2020). Cercles d’auteurs et ateliers d’écriture : des dispositifs innovants pour un enseignement engagé de l’écriture au primaire. Revue hybride de l'éducation, 4(2), I–XIII. https://doi.org/10.1522/rhe.v4i2.988