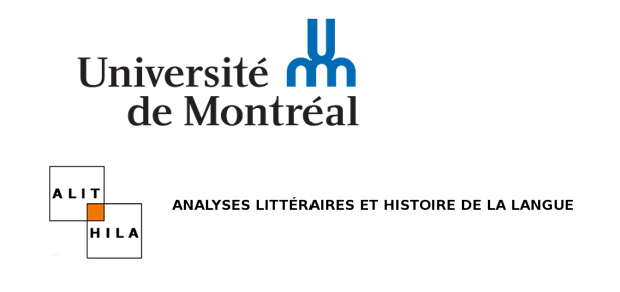
La honteuse culpabilité de l’être : entre faute et mauvaise foi, l’émergence du sujet dans le roman français du premier vingtième siècle (Montréal)
Appel à communications pour une journée d'étude (en bimodal)
La honteuse culpabilité de l’être :
entre faute et mauvaise foi, l’émergence du sujet dans le roman français du premier vingtième siècle
Sous la direction de Xavier Lacouture (Université de Montréal) et Sarah Cornet (Université de Lille, ALITHILA ULR 1061 / Université de Montréal)
Département des littératures de langue française, Université de Montréal
Le 11 mai 2025
« Écoutez Bernard, ce que je vous en dis, ce n’est pas pour vous persuader de mon innocence, bien loin de là1 ». Tels sont les mots que François Mauriac met dans la bouche de son héroïne Thérèse Desqueyroux dans le roman éponyme publié en 1927. Si Thérèse échappe au verdict de culpabilité lors de son jugement, elle se dérobe également à toute culpabilité morale et à la honte pour assumer pleinement sa liberté.
À l’instar de Thérèse Desqueyroux, le roman du premier vingtième siècle met en scène des personnages particulièrement réflexifs en proie à des affects plus complexes les uns que les autres : honte, mauvaise foi, culpabilité, et encore bien d’autres hantent la conscience des personnages. Les affects appartiennent, selon Sartre, au domaine du pré-réflexif, ils ne sont saisissables que lorsqu’ils ne sont pas pleinement saisis par la conscience – un peu comme les émotions qui, une fois conscientisées, s'évaporent pour ne devenir que l’ombre d’elles-mêmes. (cf. Sartre, 1941).
Ce rapport étroit à la conscience nous invite à nous demander, à juste titre, si ces affects appartiennent tous au domaine du pré-réflexif (Sartre, 1943) ou si certains d’entre eux nécessitent un phénomène de conscientisation, qui impliquerait alors un lien avec différentes temporalités : une temporalité interne ainsi qu’une dynamique temporelle au regard des autres affects. Par exemple, si la honte peut être à la fois un « affect-signal », « latente » ou encore « structurale d’après-coup » (Muths, 2017), elle peut aussi se situer en aval de la culpabilité. Des temporalités qui s’entrecroisent, mais qu’il serait intéressant d’interroger au prisme des différents affects de notre sujet d’étude.
Par ailleurs, le personnage de cette première moitié du XXe siècle semble entretenir une relation assumée avec la faute sur laquelle repose son affranchissement des normes sociales et son affirmation comme sujet autonome. Cependant, la culpabilité que l’on pense associée à la faute, est repoussée voire reniée par ce même personnage fautif. Les romans de cette période montrent une culpabilité qui vient d’autrui, qui émane de l’Autre telle une aliénation que l’'héroïne ou le héros en quête d’autonomie rejette éperdument.
Dans les domaines philosophique et théologique, la culpabilité renvoie à une « conscience réflexive de soi-même, en tant que référé à un ordre intérieur ou extérieur que l’on a dérangé » (Oraison, 1950-60). Le personnage de roman semble accepter et même rechercher la première mais il ne paraît avoir que faire de la seconde. En ce sens, il invite à délier la faute de la culpabilité pour en repenser une relation au sein de laquelle la culpabilité précède peut-être la faute, fuit sans doute celle-ci mais certainement ne l’accompagne plus.
Au début du XXe siècle, la France a encore en tête la défaite de 1870 face à la Prusse et baigne dans un climat particulièrement nationaliste afin de faire regagner de l’honneur à une patrie qui semble l’avoir perdu. La honte jaillit aussi avec les deux guerres mondiales qui ont, par la suite, fait naître de nombreux écrits fictionnels comme théoriques –, abordant la honte et la culpabilité comme question centrale dans le processus de subjectivation de certains personnages ? Qu’elle soit du côté des victimes ou des bourreaux, la honte fait émerger de nombreux questionnements à la fois sur le sujet humain et ses représentations romanesques. L’intérêt littéraire et philosophique pour ces affects semble avoir créé un point de non-retour concernant la compréhension et la représentation du sujet au travers de ces différents domaines.
Rappelons que Sartre comme Levinas soulignent le fait que la honte ne peut exister de façon pérenne, une fois que l’on en prend conscience, elle ne peut persister et s’inscrit forcément dans l’instant. Sartre est, en effet, l’une des figures de proue concernant la honte, l’ayant établi au rang de véritable concept philosophique, il évoque une (h)ontologie (Lacan, 2005) : une honte constitutive de l’être humain et dont chacun chercherait à s’en départir, notamment par la recherche d’une quelconque transcendance au travers d’un art comme celui de la littérature. Genet, Flaubert et Sartre auraient en commun cette habilité à dépasser la honte, cette boue, et à la modeler en or.
Cependant, nombreuses sont les mises en garde concernant les représentations d’un sujet littéraire coupable, honteux ou encore de mauvaise foi : il est aisé de tomber dans la complaisance, dans le mensonge (envers autrui comme envers soi-même), ou encore de nier les responsabilités qui accompagnent l’existence du sujet. Sartre donne une incarnation à ce mode d’existence, celle du « salaud » qui, rongé par la mauvaise foi, préfère s’occulter la liberté constitutive de ses actes.
Le colloque vise donc à s’interroger sur les représentations littéraires de la culpabilité et de la honte, souvent pensées ensemble par les écrivain.es de la première moitié du XXe siècle. Est-il possible de les représenter sans ôter leur dynamisme constitutif ? Qu’est-ce que leur traitement respectif vient dire de la compréhension du sujet et de sa représentation littéraire au XXe siècle ? Existe-t-il une « solution », une « résolution » à ces affects dépréciatifs au sens où pourrait s’installer un jeu créateur de la honte et de la culpabilité ? La littérature est-elle le nœud par lequel peut s’épanouir l’ambiguïté de ces notions ou, au contraire, leur instance libératrice ? Qu’est-ce que le jugement d’autrui vient engendrer auprès du sujet honteux ou coupable, et vice versa ? Peut-on d’ailleurs être les deux à la fois, ou est-ce que cela correspond à deux temporalités différentes ? Enfin, par l'intermédiaire du langage et à plus large échelle de la fiction, parvient-on encore à ramener la honte, la culpabilité, et la mauvaise foi, à leur nature, pour la plupart, pré-réflexive.
Axes de recherche (liste non exhaustive)
- la culpabilité morale ou existentielle
- la faute
- l’aveu et la confession
- le sujet et la subjectivité
- la honte sociale ou ontologique
- la mauvaise foi
- le temps et la temporalité
—
Les propositions de communication de 300 mots devront être envoyées avant le 2 mars 2026 aux adresses électroniques suivantes : sarah.cornet@umontreal.ca et xavier.lacouture@umontreal.ca. Merci d’inclure une brève bibliographie (une page) et une notice biographique (100 mots). Les communications seront d’une durée de 20 minutes, suivies d’un temps de discussion.
Date de réponse des organisateurs : mi-mars 2026.
Possibilité de participer en colloque en distanciel bien que nous priviligiérons dans la mesure du possible les interventions en présentiel.
—
Bibliographie sommaire :
Bernard, William, La honte et la nécessité, Paris, PUF, coll. « Philosophie », 1997, 272 p.
Chaouat, Bruno, Lire, écrire la honte, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Passages », 2007, 422 p.
Delumeau, Jean, Le péché et la peur : la culpabilisation en Occident, Paris, Fayard, 1983, p. 211-363.
Oraison, Marc, Faux et vrai sens du péché chrétien, Paris, Cité Abraham, 1950-1960.
Hesnard, Angelo, L’univers morbide de la faute, Paris, Presses Universitaires de France, 1949.
Lacroix, Jean, Philosophie de la culpabilité, Paris, Presses Universitaires de France, 1977.
Levinas, Emmanuel, Totalité et infini : essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de poche, coll. « Essai / Philosophie / Métaphysique », 2007 [1961], 341 p.
Martin, Jean‑Pierre, La Honte. Réflexions sur la littérature, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2017, 401 p.
Ricoeur, Paul, Le Mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Geniève, Labor et Fidès, 2004.
Ricoeur, Paul, Philosophie de la volonté, t. 2 : Finitude et culpabilité, Paris, Points, 2000.
Saint-Cheron, Michaël de, Réflexions sur la honte : de Rousseau à Lévinas, Paris, Hachette, 2017, 190 p.
Sartre, Jean-Paul, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1971 [1943].
Tisseron, Serge, La honte. Psychanalyse d’un lien social, Paris, Dunod, 1992.
Tortonese, Paolo, La faute au roman : littérature et morale, Paris, Vrin, 2023.
Vergez, André, Faute et liberté, Paris, Les Belles Lettres, 1969.
[1] François Mauriac, Thérèse Desqueyroux, Paris, Le Livre de poche, 1989 [1927], p. 144.