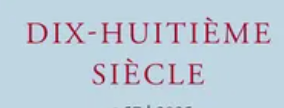
A l’heure où les replis identitaires fracturent l’horizon européen, et où la culture du voyage est intensément questionnée par les défis environnementaux et les crises migratoires, nous proposons pour le numéro de la revue Dix-Huitième siècle à paraître en 2027 un dossier pluridisciplinaire consacré à "l’Europe à l’épreuve du voyage".
L’Europe du XVIIIe siècle a souvent été convoquée comme horizon culturel de référence pour la construction européenne qui a vu le jour aux lendemains de la seconde guerre mondiale. Le dossier que nous proposons entend démontrer à l’épreuve des Lumières et de la culture du voyage les potentialités critiques toujours vivaces de l’idée européenne. À ce titre, il ne s’agit pas de mettre en avant une Europe figée dans un universalisme des Lumières qui aurait pris le pas sur l’universalisme chrétien, mais de dévoiler une Europe en constante construction, tendue vers la redécouverte d’elle-même, sachant se soumettre à des processus d’autocritique souvent inspirés par des voyages plus lointains. Le dossier souhaite donc dépasser l’opposition devenue stérile entre un « Grand Tour » associé à la « civilisation » de l’Europe et un voyage d’exploration prétendument réservé aux mondes « extra-européens ». Les contours problématiques d’une appartenance européenne au tournant des Lumières seront en somme interrogés à travers les discours et les pratiques du voyage, qui ont enjoint à repenser les frontières sociales, géographiques et philosophiques assignées jusqu’alors au Vieux continent.
À l’appui de leur expertise dans les champs de la littérature viatique, de l’histoire des techniques, de l’histoire sociale et de l’histoire culturelle, les porteurs du dossier invitent les contributeurs à un dialogue interdisciplinaire fondé sur des sources publiées mais également sur des « archives du voyage » délaissées ou inédites. Seul un vaste corpus composite de documents, souvent manuscrits, faits de carnets, journaux, lettres, croquis, cartes et autres sources viatiques, pourra en effet permettre de reconstituer l’expérience et les discours des auteurs et des voyageurs ayant traversé en acte ou en pensée les centres, les marges comme les confins de l’Europe du XVIIIe siècle. Le dossier sera constitué autour de trois axes forts :
Axe 1. Une Europe repensée par de nouveaux acteurs du voyage : il s’agira ici de jouer la carte du décentrement, en montrant comment l’Europe du XVIIIe siècle a été traversée et appréhendée par de nouvelles figures de voyageurs, au premier rang desquels nous souhaitons donner toute leur place à des groupes et individus que l’historiographie dominante du Grand Tour a souvent invisibilisés. Femmes, artisans, artistes, aventuriers, gens à talents, minorités ethniques ou confessionnelles, mais aussi voyageurs venus d’ailleurs : le premier axe du dossier entend redonner toute sa place à ces voyageurs émergents, en analysant comment leur positionnement singulier dans la société d’Ancien régime les met en situation de porter un regard critique, disruptif ou décentré sur les territoires qu’ils traversent. Dans le sillage d’études récentes ayant mis en avant la nouveauté des regards portés sur l’Europe du XVIIIe siècle par des voyageurs venus d’Afrique, de Chine, du Pacifique ou des Amériques, on cherchera à systématiser les principes d’une enquête comparative sur un continent européen repensé par des voyageurs du lointain. Les acteurs européens du voyage ne doivent évidemment pas être exclus du cadre, mais on portera une attention particulière à ceux qui ont repensé l’Europe à l’appui de leur exploration parallèle des mondes lointains.
Axe 2. Les échelles européennes du voyage : comment le territoire de l’Europe est-il devenu au XVIIIe siècle l’objet d’une connaissance pratique, concrète et partagée, nourrie par l’épreuve de la route et les traces manuscrites qui en ont été le fruit ? De nombreux fronts pionniers du voyage se sont alors ouverts, qui restent encore à documenter. Le nouvel attrait exercé par l’environnement naturel et par les territoires de confins, qu’ils soient scandinaves, russes ou orientaux, joue à rebours des voyages anciennement polarisés par les cours et les grandes capitales. Encourageant une articulation inédite des franges littorales avec l’intérieur des terres, des vallées avec les sommets, des capitales avec les régions les plus reculées, les voyageurs du XVIIIe siècle ont rendu possible une première unification culturelle de la géographie européenne. C’est principalement par l’emboîtement des échelles géographiques que l’on peut espérer mieux comprendre comment cette Europe fut envisagée, peut-être pour la première fois de son histoire, dans ses dimensions multiples et interconnectées. L’un des objectifs de cet axe sera donc aussi de comprendre comment les voyageurs du XVIIIe siècle échafaudent une carte mentale de l’Europe qui n’est pas exempte de visées captatrices.
Axe 3. Lumières et philosophie du voyage européen : ce troisième axe du dossier vise à établir comment les voyages réels mais aussi utopiques ou imaginaires ont influé sur les débats relatifs aux limites et à la vocation de l’Europe. La littérature prescriptive à destination des voyageurs a joué à cet égard un rôle de grande importance. Guides de voyage et arts apodémiques ont souvent été envisagés comme des cadres contraignant la pratique du voyage. Nous souhaitons renverser la perspective, en montrant comment l’expérience du voyage renouvelle voire subvertit les questionnaires. La culture de l’observation dont le mouvement des Lumières est porteur se signale de ce point de vue par une tentative d’« envisionner » l’Europe et de croiser les divers objets du voyage, par-delà les clivages ultérieurs entre culture technique, antiquaire, érudite ou naturaliste. Mais l’espace de la fiction et des récits contribue également à renouveler l’approche de l’Europe, en en faisant le socle d’une histoire plus critique que conquérante. On s’interrogera donc également ici sur la manière dont dialoguent les textes entre eux, sur la propension des voyageurs à rejouer des voyages antérieurs, sur la portée des émotions dans l’écriture viatique, et sur la porosité des frontières entre l’Europe vécue et l’Europe des textes.
—
Consignes pour les articles et les propositions :
Les articles attendus se limiteront à 35’000 signes, espaces et notes comprises. On privilégiera les approches transversales, les réflexions théoriques et les études de cas bien problématisées, débouchant sur une réflexion dépassant le simple cas monographique. Les études purement biographiques ne sont pas souhaitées.
Les propositions d’article (1 page, avec une brève notice bio-bibliographique de 5-6 lignes max.) expliciteront l’inscription du sujet dans l’un des trois axes. Elles seront envoyées pour le 15 octobre au plus tard à :
jean.boutier@ehess.fr
liliane.hilaire-perez@u-paris.fr
gilles.montegre@univ-grenoble-alpes.fr
nathalie.vuillemin@unine.ch
—
Calendrier :
Mi-décembre 2025 (au plus tard) : réponse aux auteur.ices.
30 avril 2026 : envoi de la première version de l’article.
19 juin 2026 : journée d’études à Neuchâtel (Suisse) : discussion des articles.
7 août 2026 : remise de la version modifiée des articles, aux normes.
Fin septembre 2026 : retour des évaluateurs.
Mi-novembre 2026 : remise des versions définitives ne varietur.