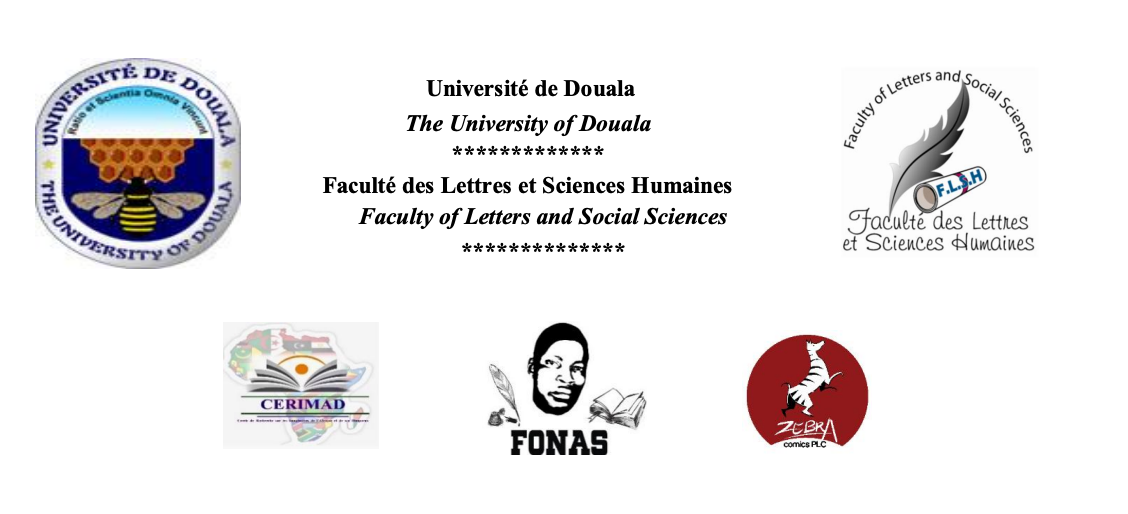
Les grandes figures féminines dans les littératures et les bandesdessinées africaines (Douala, Cameroun)
« Les grandes figures féminines dans les littératures et les bandes dessinées africaines»
Symposium
Les 8-9 avril 2025
Alors même que la question des femmes dans les littératures africaines, orales et écrites, a fait l’objet d’une attention critique abondante, force est de constater que la représentation des figures féminines se limite très souvent aux rôles classiques de mères, d’épouses et de filles. Confinées à la condition de victimes d’un patriarcat aliénant, ou au contraire, louées pour leurs vertus dans l’éducation des enfants et la stabilité de la cellule familiale, elles sont rarement portraiturées en tant que résistantes ou leaders. Jusqu’à tout récemment, l’espace littéraire africain, et spécifiquement celui circonscrit au sud du Sahara, a révélé que la prise de parole des figures féminines est essentiellement le fait de la vague des écrivaines des années 1970-1980 qui modifient la perception idyllique et mythique de la femme. Ces autrices décrivent des femmes confrontées à des situations traumatisantes, tant dans la société que dans leurs foyers. Leur démarche vise à déconstruire les représentations véhiculées par le discours social et la littérature à leur sujet. Par la suite, les années 1980 et 1990 ont marqué l'émergence d'une nouvelle génération de femmes dans ces littératures. Des amazones des temps modernes qui s'engagent dans les luttes pour les libertés individuelles ; en affirmant leur identité singulière1. Force est donc de constater que les figures féminines restent sous-étudiées ou limitées à des archétypes ; leur représentation apparaissant toujours sous des formes brumeuses chez Beyala2, ou inédites chez Eugène Ebodé3, pour ne citer que ces deux auteurs.
Par ailleurs, du point de vue de l’historiographie africaine, les figures féminines sont très souvent absentes, marginales ou encore sous-représentées. Il y a une sorte de « silencement » du passé4 et de l’histoire des femmes africaines. La tendance au demeurant majoritaire, est encore de restituer les femmes à l’histoire, d’écrire ce que Gerda Lerner5 a appelé l’histoire « compensatoire » et « de contribution ». Or, il ne s'agit pas seulement d'ajouter des femmes à l'histoire, mais d’adopter une pratique blasphématoire de contestation du système de représentation ; voire de repenser les récits historiques en reconnaissant leur contribution essentielle, et en incluant des perspectives de genre.
La lecture qui précède s’applique autant à la production romanesque qu’à la bande dessinée. A titre de rappel, le neuvième art est en pleine ébullition dans l’ensemble du continent africain. Mais pour de nombreux bédéistes, les limites de cette effervescence se résument à un seul mot : l’extraversion. C’est du moins l’avis de deux figures importantes de cet art au Cameroun, à savoir Joëlle Epée Mandengue et Nathanaël Ejob6. La première, autrice de La Vie rêvée d'Ebène Duta, pose ce diagnostic sans fards : « Certains sont de brillants dessinateurs mais qui ont copié Bleach en changeant juste la coupe de cheveux d’Ichigo, en lui mettant des nattes ! […] Il faut que les auteurs créent véritablement ». Le second, scénariste et dessinateur au sein du collectif Zebra Comics, affirme quant à lui : « J’ai grandi avec Batman et Superman alors, inconsciemment, mes histoires ressemblaient à ce monde-là, qui n’est pourtant pas le mien […] Ça a été comme un sursaut, l’envie de raconter mes propres histoires. » L’enracinement consiste aussi en la sauvegarde des langues locales en péril. Il est important de souligner que la veine novatrice prônée par ces bédéistes, adossée à une entreprise de revalorisation du patrimoine culturel africain, ne peut ignorer le fait que le neuvième art a longtemps consacré l’invisibilité des figures féminines. L’Afrique entend aujourd’hui corriger cette lacune mondiale. Dans l’ensemble du continent, la tendance est à la prolifération des héroïnes, mais surtout des parcours atypiques incarnés par des personnages féminins, notamment ceux de judokates, reines, guerrières ou archéologues. C’est une tendance à questionner au plan de la représentation des grandes figures féminines de l’histoire. Ces créateurs de personnages féminins hors du commun, tiennent-ils compte des lacunes à combler en matière de représentation des héroïnes, connues ou inconnues, qui ont marqué le continent africain ? On peut aussi, dans une perspective comparatiste entre la BD et le roman, décrypter la perspective « afrofuturiste », telle que la définit Nathanaël Ejob : « C’est ça le pouvoir de l’afro-futurisme, montrer qu’en Afrique aussi on peut créer un monde incroyable, il faut juste croire qu’on en est capable !7». Nathanaël Ejob parle ici de l’importance de convoquer les genres littéraires qu’on range dans la catégorie du surnaturel, c’est-à-dire le fantastique et la science-fiction. A ce propos, les mythes et la spiritualité africaine seraient pourvoyeuses d’histoires « incroyables ». Il s’agirait par conséquent, d’interroger le présent et de le réinventer à l’aune du passé. Dans une telle perspective, la question suivante mériterait également d’être posée : quels sont les enjeux historiographiques et sociologiques de la création des figures féminines dans les récits8 ?
Le symposium objet du présent appel à communication, qui se tiendra à Douala dans le cadre de la deuxième édition des « Journées de la bande dessinée », est ouvert à une diversité de spécialistes : universitaires, chercheurs, bédéistes, éditeurs… etc. Il s’agira d’étudier les grandes figures féminines dans les littératures africaines ; avec un accent porté en particulier sur la représentation des femmes chez les bédéistes africains. Les axes de communication, non exhaustifs, sont les suivants :
1- Diversité des grandes figures féminines africaines. On pourra interroger les typologies (élites, subalternes) et rôles joués dans l’historiographie africaine.
2- Stéréotypes et limites des représentations. Il s’agit de voir si les récits traditionnels et modernes reproduisent les clichés sur la « femme africaine » ; et dans quelle mesure l’absence de ces dernières dans les récits donne une vision biaisée des sociétés africaines, et participe non seulement à leur invisibilité mais aussi et surtout à leur inhabitabilité.
3- Grandes figures féminines dans des contextes contemporains. Ici, on peut par exemple questionner le rôle des femmes dans les contextes de migrations, génocides, guerres civiles et conflits post-Apartheid. Tout comme lors des luttes pour l’autodétermination des pays africains, ces situations de vie sont marquées par l’action de nombreuses héroïnes inconnues qu’il serait opportun de sortir de l’oubli et de mettre en lumière.
4- Re-lecture féministe et intersectionnelle des textes africains. Cet axe peut amener à voir comment les grandes héroïnes du continent sont réinterprétées et réinvestissent les imaginaires africains, voire comment elles ont évolué à l’intersection des oppressions degenre (idéologies patriarcales coloniales et idéologies patriarcales autochtones), de race et/ou de classe.
5- Décolonisation et réhabilitation des grandes figures féminines. En privilégiant les perspectives décoloniales, notamment celles du féminisme décolonial, il est question d’analyser les nouvelles représentations des figures féminines oubliées (résistantes, mères des nations…) durant les luttes coloniales et les indépendances.
—
Modalités de soumission
Les propositions de communication de 300 mots devront être envoyées à l’adresse suivante :
Elles doivent comporter les parties ci-après : le titre, le nom de l’auteur, la structure ou Etablissement d’attache, ainsi qu’une adresse électronique.
—
Calendrier
17 janvier 2025 : lancement de l’appel.
28 février 2025 : date limite de réception des propositions de communication.
5 mars 2025 : réponse aux auteurs.
—
1. Joseph, Ndinda, « Femmes africaines en littérature, aperçu panoramique et diachronique » dans Femmes et création littéraire en Afrique et aux Antilles, Palabre Vol. III, n°1&2, avril 2000.
2. Calixthe Beyala, Assèze l’Africaine, Paris, Albin Michel, 2014.
3. Eugène, Ebodé, Souveraine magnifique, Paris, Gallimard, 2014.
4. Michel-Rolph, Trouillot, Silencing the Past : Power and the Production of History, London, Beacon Press, 2015.
5 Gerda Lerner (30 avril 1920 - 2 janvier 2013), est une historienne américaine d'origine autrichienne, qui figure parmi les fondatrices du domaine de l'histoire des femmes aux États-Unis. Elle a été l'une des premières à apporter une perspective historique féministe. Ses publications les plus emblématiques dans le domaine sont les suivantes : 1. Black Women in White America : A Documentary History (1973), publié en français sous le titre De l'esclavage à la ségrégation - les femmes noires dans l'Amérique des Blancs (1975) ; 2. The Majority Finds Its Past : Placing Women in History (1979) ; 3. The Creation of Patriarchy (1986) ; 4. The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-Seventy (1993).
6 Klervi Le Cozic, « la bande dessinée contemporaine en Afrique », https://www.citebd.org/neuvieme-art/la-bande-dessinee- contemporaine-en-afrique, Juin 2021.
7 Klervi Le Cozic, op. cit.
8 Balana Yvette, « Entre grandeurs et misères. Fictions, récits, mythes et réalités sur la femme camerounaise », in Amabiamina Flora (dir.), Peintures de femmes dans la littérature postcoloniale camerounaise, Abà, Revue internationale de lettres et de sciences sociales 4/2016, Paris, Dianoïa.