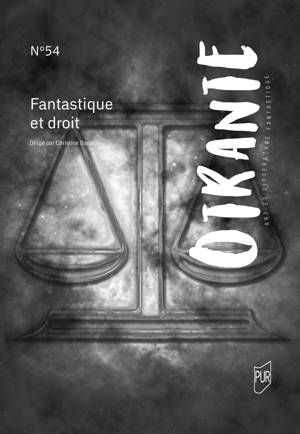
Dans de nombreux textes, séries ou films relevant du genre de la politique-fiction (Star Wars) ou de la fantasy (Crimson Peak) le droit occupe une place non négligeable. Les univers fantastiques se caractérisent ainsi paradoxalement par l’invention de sociétés dont les normes et les lois sont souvent très élaborées. Imaginaire juridique et littéraire se nourrissent ainsi réciproquement dans un dialogue où les littératures mettent en scène des cas concrets, voire repensent des concepts juridiques tels que le pacte social, le droit de la personne, la responsabilité, la dignité humaine, le contrat. De fait, la jurisfiction, en tant que genre expérimental qui met à l’épreuve des questions de droit offre un cadre narratif pour questionner le droit public dans des récits utopiques ou dystopiques (A. Palmer, A. Damasio, J. Zeh), le droit privé et le droit pénal dans d’autres fictions en mettant au jour les blancs, impensés, les risques, les dérives possibles des pratiques juridiques dans nos sociétés.
Avec le soutien de l’université de Poitiers et de l’Unité de recherche ACE de l’université Rennes 2
Accès au sommaire en ligne via Cairn…
—
On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un billet de Michel Porret sur ce sommaire :
"Inscrit dans les horizons du fantastique, hommage au roman fondateur de la littérature gothique (Horace Walpole, Le château d’Otrante, 1764), semestriel pluridisciplinaire de critique littéraire, Otrante évoque la place du droit dans l’imaginaire des fictions fantastiques. Ce dossier ambitieux en suit d’autres, publiés depuis 2019 : Paradoxes de l’espace-temps (no 46), Apocalypses (47-48), Mutations 3. Posthumain et écran (51) ou encore Fantasy et séries télévisées (53).
Initiées au début du XXe siècle par les juristes John Wigmore (1863-1943) et Benjamin Cardozo (1870-1938), les étudessur « littérature et droit » pensent la fiction comme pivot de l’imaginaire et des savoirs juridiques. Depuis l’Odyssée, que boucle la restauration pénale du droit conjugal dans la domus d’Ulysse, la littérature sait « narrer » le droit (François Ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, Odile Jacob, 2004). Entre utopie, dystopie, récit horrifique ou de science-fiction, l’imaginaire conjecturel et fantastique est-il pensable à travers le prisme du positivisme juridique ? Comment juridiquement qualifier la « personnalité » du monstre que coud le démiurge Victor Frankenstein à partir de cadavres humains et animaux ? (Mary Shelley). En quoi Dracula de Bram Stoker incite-t-il à évaluer l’atteinte à la paix des morts lors du passage à l’acte vampirique ?
« Fantasy et droit », « Droit des femmes et fictions fantastiques », « Classiques revisités au prisme du droit », « Jurisfictions » : après l’introduction programmatique (Christine Baron), ce numéro d’Otrante propose neuf études de l’imaginaire normatif dues à des juristes ou à des critiques de littérature. Ils enrichissent le dialogue de la fiction et des concepts juridiques – pacte social, droit de la personne, responsabilité individuelle et dignité humaine. La « jurisfiction » offre un cadre narratif sur les représentations du droit en littérature, mais aussi pour questionner le monde réel. Si le Léviathan hobbesien marque les dystopies totalitaires publiées au XXe siècle (entre autres, 1984), n’avance-t-il pas à l’horizon de notre monde incertain, prélude au Terminus radieux d’Antoine Volodine ? Il y a des mariages épistémologiques plutôt prometteurs, dont celui de la littérature et du droit que ratifie Otrante." — Michel Porret.