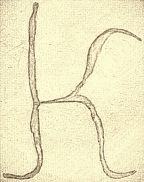
Appel à contributions
K. Revue trans-européenne de philosophie et arts vol. 12, 2/2024
La séduction du nom : Hélène et son spectre
Ce n’était pas moi-même, mais mon nom seulement
Euripide, Hélène
Un vrai amant ne cesse pas d’aimer
Euripide, Les Troyennes
La guerre est-elle un spectre ? Plus précisément : est-elle un simulacre de la civilisation ? Sans doute Euripide devait-il le croire lorsqu’en réadaptant dans Hélène une version du mythe différente de celle adoptée par les poèmes homériques, il démonte la logique la plus canonique du modèle de la beauté absolue (pour Homère, la beauté d’Hélène tend à impliquer fatalement l’infidélité de l’épouse) et détruit ainsi, jusqu’à leurs fondements, certains bastions culturels de la civilisation grecque archaïque. Dans la tragédie représentée pour la première fois en 412 avant J.-C., Grecs et Troyens se seraient en effet massacrés pour rien, pour un fantôme (mais au fond, un fantôme, qui plus est d’une belle femme, est-ce vraiment rien ?) : la femme que Pâris emmène avec lui loin de Sparte n’est pas Hélène, mais seulement son image. Eidolon : « Un fantôme/semblable à moi, fait d’éther et par elle animé [...]. Le roi fils de Priam crut donc me posséder/quand il ne tenait qu’un mirage » (Euripide, Hélène, vv. 34-36). Que dit le fantôme d’Hélène ? On ne possède pas une image ; encore moins une image en mouvement, qui vit, bien que ne possédant pas d’identité précise. Euripide a la force de libérer Hélène de son image – une image qui semble évoquer celle d’Ève dans le Paradis perdu : disponible à la séduction du verbe, superficielle, éphémère, ingrate envers ceux qui lui accordent un royaume – en fournissant littéralement à la femme une autre image qui lui permette de dissocier son existence, sa beauté, ses désirs, de la mort.
Le conflit se joue donc, matériellement, sur une apparence : l’Hélène d’Euripide, celle pour laquelle on se bat et l’on meurt, n’est rien d’autre qu’un nom ; il n’y a aucune substance ; son corps n’est pas là où il devrait être. La “vraie” Hélène, en effet, dans la tragédie d’Euripide, se trouve en Égypte, où elle passe son temps à attendre anxieusement de recomposer les ruines de sa famille (aux yeux du Nietzsche de La Naissance de la tragédie, cette Hélène sans rêve, atone, résolument anti-apollinienne, devait sans doute apparaître comme une formidable confirmation des intentions suicidaires d’Euripide envers la tragédie classique). Pour Euripide, la guerre est une illusion, la moins réelle qui soit dans la réalité, et c’est précisément pour cette raison qu’elle est destructrice et quasiment sans répit. Il s’agit alors d’ouvrir les yeux en échappant à une série de malentendus, pour en finir enfin avec les illusions qui gâchent la vie, de sorte à comprendre que le conflit qui mène la ville de Troie à son trépas est une expérience insensée, fruit d’un terrible malentendu. À ce stade, les corps déchiquetés, défigurés dans les batailles, ne constituent plus qu’une couverture pour un événement plus traumatique et plus bouleversant encore, si cela est possible, que le massacre : tout conflit est une mortelle hallucination.
Hélène apparaît en effet comme un mystère indéchiffrable pour ceux qui l’entourent ; le point culminant de la matérialisation la plus radicale de la différence féminine, précisément parce que, contrairement à d’autres figures féminines de la tragédie, elle ne présente pas une profondeur dramatique exceptionnelle (nous pensons évidemment, avant tout, à Antigone et à Médée). À cet égard, comme le souligne un précieux ouvrage (M. Bettini - C. Brillante, Il mito di Elena. Racconti dalla Grecia a oggi, Turin, 2002), dans Hélène, avant d’arriver comme naufragé en Égypte, où il retrouvera sa “vraie” femme, Ménélas passe sept ans avec l’eidolon d’Hélène (enlevée à Troie après la fin de la guerre) et pourtant, chose incroyable, il ne remarque rien, il ne perçoit aucune différence entre la “vraie” Hélène, qu’il ne rencontre pas en effet depuis dix-sept ans, et son image ; pas même un doute. Il ne perçoit aucune dissonance entre les deux, au point qu’en Égypte, il ne pourra croire à la “vraie” Hélène que lorsque le double évanescent de la reine de Sparte disparaîtra (mais une image peut-elle disparaître définitivement ? N’est-ce pas là son privilège le plus grand : survivre même lorsqu’elle s’évanouit ?)
Toutefois : si l’on admet l’hypothèse du jeune Nietzsche sur la structure apollinienne de la culture grecque, qui serait fondée sur l’idée que pour vivre il faut avoir l’illusion que la vie vaut la peine d’être vécue, qu’il faut, comme dans un rêve, donner une forme à la destruction pour ne pas être détruit, les choses se compliquent sans doute. Soyons clairs, c’est en cela que réside la tragédie de la guerre et de son incommensurable brutalité : il faut se bercer de l’illusion qu’elle ait un sens. Sommes-nous alors certains qu’Agamemnon, Ménélas, Hector, Ajax, Ulysse ne savaient pas – c’est-à-dire sans s’attarder, comme le fait Euripide dans Hélène, sur des discours qui pourraient évoquer des diatribes de philosophie du langage (comment considérer autrement les propos sur la valeur d’un nom propre littéralement décorporé ?) – que l’interminable carnage de la guerre se réalise immanquablement par une image ? On pourrait oser encore davantage et penser que les poèmes homériques, où la femme de Ménélas est avant tout une épouse infidèle, avertissaient déjà qu’Hélène est le nom propre d’une affaire commune, c’est-à-dire que la guerre est inexorablement une affaire de spectres, de morts, de survivances et de douleur ; qu’Hélène n’est à ce point qu’un nom pour donner un nom à l’insensé. Un doute surgit alors : Euripide ne met-il pas en scène dans Hélène ce qui, à bien des égards, est un fait connu et ne se débarrasse-t-il pas ainsi avec une agilité excessive du mythe d’une femme dont la beauté serait à l’origine d’un conflit sanglant ? Un mythe de la beauté et de la guerre qui indique, justement, que la guerre, plus longue et sanglante est-elle, plus elle s’avère être un événement inconsidéré. La guerre n’est-elle pas, en d’autres termes, une vicissitude inextricablement liée aux simulacres, aux fausses croyances, mais surtout à la nécessité d’attribuer un sens au tourbillon tragique et insensé de l’existence même ? Après tout, le Thersite laid et imprésentable du deuxième livre de l’Iliade, soldat grec différent de tous les autres héros décrits par Homère, n’avait-il pas déjà crié la vérité au visage d’Agamemnon ? « C’est votre guerre ! C’est celle des rois et des puissants ; ce n’est pas une affaire qui concerne les infirmes, les misérables, les nullités, les hommes et les femmes sans nom ». Il le dit clairement : nous rentrons chez nous. Humilié immédiatement, rien de moins que par Ulysse, il reste quand même un soldat, il pleure : vaincu, terrassé, moqué, il sanglote. Dans l’Iliade, il y a deux monstres parmi les Achéens : Hélène, glaçante par son extraordinaire beauté, presque une étrangère, désormais, et Thersite, l’homme qui ose s’insurger contre le pouvoir et qui imagine que tous ceux qui sont comme lui devraient déserter les honneurs de la guerre.
—
Hélène de Sparte ? Ou bien : Hélène de Troie ? Putain, épouse infidèle, fugitive, traîtresse, maîtresse, spectre, adultère, reine rusée ? Fille de Zeus et de Léda, sœur d’une autre femme aux habitudes dangereuses, Clytemnestre, sœur des Dioscures, son nom est-il perdu, ou ne reste-t-il que son nom ? Au nom de l’absolu, d’une beauté extraordinaire, qui confine à la justice, peut-on dévaster le monde ? En consacrant un dossier à la reine de Sparte, arrivée pour Homère à Troie, réfugiée, pour Euripide, en Égypte tandis que son double se trouve dans les bras de Pâris, la revue K entend soulever une série de questions probablement précieuses pour la physionomie généalogique de la notion de pouvoir destituant.
Le féminin comme différence potentielle dans la guerre : bien qu’accusée d’être la cause d’un conflit terrible et sanguinaire, l’Hélène d’Euripide pourrait représenter au contraire une des formes de l’altérité féminine dans le monde classique par rapport à la guerre (nous pensons bien sûr, entre autres, à Lysistrata).
La figure d’Hélène est tellement séduisante qu’elle mérite l’un des gestes les plus provocateurs de Gorgias qui, dans l’Éloge d’Hélène (presque contemporain de l’Hélène d’Euripide), entreprend de démontrer l’innocence de l’épouse de Ménélas : la philosophie matérialiste des Sophistes s’insurge contre l’archaïsme en exonérant la femme de toute culpabilité : « Ce qu’elle a fait, c’est par les arrêts du Destin, ou par les arrêts des dieux ou par les décrets de la Nécessité qu’elle l’a fait ; ou bien c’est enlevée de force, ou persuadée par des discours, (ou prisonnière du désir) ».
Le désir féminin ne devient-il tolérable que s’il est raisonnable ? Que s’il est commode ? Que s’il est consommé de manière responsable et en mesurant les conséquences ? La jouissance féminine peut-elle être supportée ou devient-elle une tragédie, une trahison, le rejet de toute norme morale ? Euripide ne risque-t-il pas, au fond, d’apprivoiser jusqu’à l’excès le rôle du féminin dans le tragique, en laissant finalement s’évanouir les illusions d’un plaisir ingouvernable par la Raison d’État ?
Dissiper le nom, ne pas avoir de nom propre, se séparer du nom, comme la condition pirandellienne pour échapper aux formes de capture de soi. Dans l’Hélène d’Euripide, la guerre de Troie est combattue autour d’un nom, alors que la femme pour laquelle la guerre se déchaîne est ailleurs. On pourrait alors penser que l’anonymat est le véritable salut d’Hélène. Il est probable qu’aujourd’hui, s’évanouir, être sans nom, clandestin, soit à la fois le plus grand danger et aussi le seul combat politique qui vaille la peine d’être pensé.
Qui est Ménélas ? Dans Hélène d’Égypte (1928) de Hofmannsthal, où convergent brillamment la version homérique et la version euripidéenne du mythe, Ménélas est empoisonné par le ressentiment, par la rage : il tente plus d’une fois de tuer sa femme, il ne supporte pas l’outrage qui lui est fait et sa beauté ne peut être apprivoisée. Chez Hofmannsthal, en effet, le véritable protagoniste de la pièce est le roi trahi, le cocu par excellence de toute la tradition occidentale. Pourtant, au cours de l’histoire, Ménélas change : il pardonne, pour reprendre l’expression de Derrida, l’impardonnable. Qu’est-ce qui permet à Ménélas de cesser d’être un homme accablé et violent, de regarder peut-être pour la première fois sa femme ?
Comme l’avaitcompris peut-être mieux que quiconque Walter Benjamin dans la lutte contre le nazi-fascisme, afin de rompre toute forme de complicité culturelle avec ses présupposés politiques, la bataille a un caractère tout d’abord esthétique : le terrain d’affrontement radical et préalable se joue dans le domaine des images. Si l’intention fasciste est toujours, au fond, dominée par une esthétisation de la guerre, le renversement de cette vision exige que ne soit toléré aucun compromis avec la fascination et les raisons, quelles qu’elles soient, de la violence guerrière.
Dans l’Hélène d’Euripide est traité un topos littéraire et artistique de longue date : le double (le double d’Hélène est également une figure cruciale dans l’Hélène d’Égypte d’Hofmannsthal). Une figure anodine capable, peut-être comme peu d’autres, de tourmenter la logique de l’identité par l’excès de proximité entre ce qui l’incarne et sa révocation ; un type traumatique de complicité telle que seuls la victime et le bourreau peuvent peut-être établir.
Le mythe d’Hélène, c’est d’abord une beauté qui n’est pas comme les autres : elle est incomparable à tout ce que l’on peut concevoir sur terre. Il ne serait pas incorrect de la considérer, avec Kant, comme sublime : la condensation de la terreur dans le plaisir le plus grand. Dans l’Iliade, par ailleurs, les anciens de Troie, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un malheur, ne doutent pas que pour une beauté comme celle d’Hélène, une beauté jamais vue, une beauté difficile même à imaginer, cela vaille la peine de s’entretuer : « Ce n’est pas sans raison que les Grecs aux belles cnémides et les Troyens supportent, pour une telle femme, de si longues souffrances. Son visage est aussi beau que celui des déesses Immortelles » (Livre III, vv. 156-159). Dans le sillage de Lyotard, nous voudrions interroger la valeur actuelle de la notion de sublime comme dispositif à même de conférer au geste artistique une politisation inimaginable, donc révolutionnaire.
—
Les propositions devront être envoyées avant le 8 avril 2024 (maximum 2500 caractères)
À l’adresse : krevuecontact@gmail.com
Si la proposition est acceptée, la contribution devra être remise avant le 20 septembre 2024. Après cette date, il est prévu que la contribution soit automatiquement exclue du numéro de la revue.