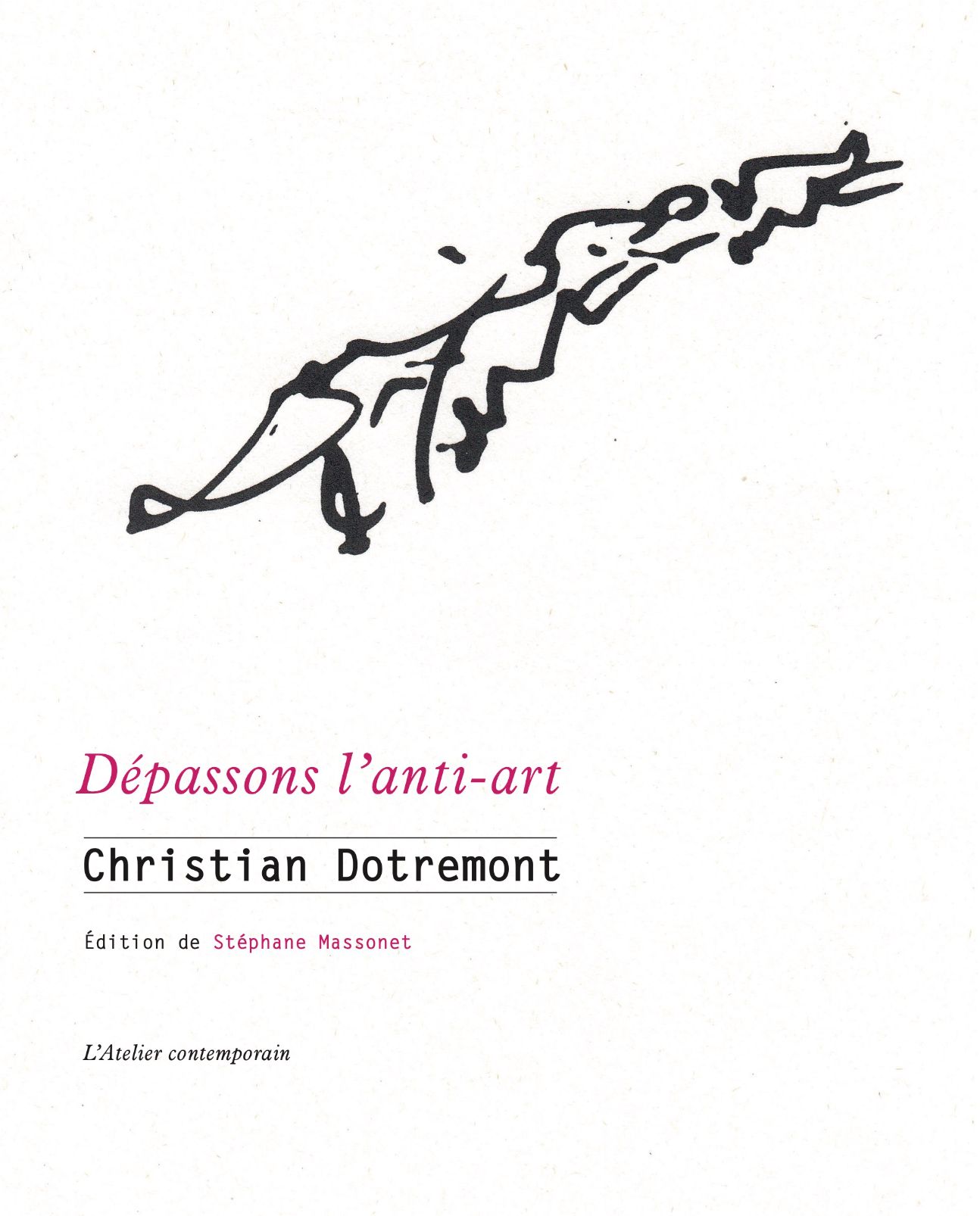
Ecrits sur l'art, le cinéma et la littérature, 1948-1978.
Acteur et témoin de plusieurs mouvements expérimentaux d’après-guerre, dont ceux du surréalisme-révolutionnaire et de Cobra, historien des arts impliqué dans l’histoire qu’il raconte, théoricien emporté cependant à l’écart de la théorie par sa fidélité à la confusion des sensations immédiates, telles sont les facettes de Christian Dotremont que révèlent ses nombreux écrits sur l’art, la littérature et le cinéma. À leur lecture, c’est d’abord comme si on déroulait plusieurs fils de noms, qui retracent certaines constellations artistiques et intellectuelles majeures de son époque, dans ce qu’elles eurent de tumultueux et de vivant. Édition établie et présentée par Stéphane Massonet.
On croise ainsi, évoquées à travers leurs œuvres comme à travers leur existence quotidienne, de grandes figures du milieu artistique belge, tels René Magritte et son « anti-peinture » traversée d’humour et de poésie, ou Raoul Ubac et la « forêt de formes » de ses photographies, mais aussi du surréalisme parisien, tels Paul Éluard accomplissant sa « grande tâche lumineuse » dans la nuit de 1940, Nush Éluard servant du porto rue de la Chapelle, ou Pablo Picasso dans son atelier rue des Grands-Augustins, occupé à faire du café et à dessiner sur des pages de vieux journaux, en ces temps de pénurie de papier. On croise également des personnages plus inattendus, comme Gaston Bachelard, lecteur des Chants de Maldoror, Jean Cocteau, « délégué de l’autre monde », ou Jean-Paul Sartre, travaillant frénétiquement à sa table du Dôme, et s’interrompant pour lire avec bienveillance les poèmes que lui soumet jeune Christian Dotremont. Mais celles et ceux dont il esquisse les portraits les plus denses, ce sont les artistes de Cobra, qui de 1948 à 1951 fut « une somme de voyages, de trains, de gares, de campements dans des ateliers », une manière de travailler en « kolkhozes volants », entre Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Entre autres, sont évoqués avec une finesse critique particulière Asger Jorn, qui avec ses toiles « sème des forêts » à l’écart des dogmes, Pierre Alechinsky, dont la peinture est « comme un coquillage où s’entend l’orage », Egill Jacobsen, inventant des « masques criants de vérité chantée », Erik Thommesen, dont les sculptures sont « un grand mystère trop émouvant pour être expliqué », ou Sonja Ferlov, qui réconcilie « la pierre et l’air »...
Dans les textes qu’il consacre à ses amis et amies artistes, on retrouve la musique et les images obsédantes qui travaillent aussi sa poésie, telle l’image de la forêt, pour dire chaque fois les surgissements de la trame illisible du monde qui le fascinent. Artiste révolutionnaire, déçu pourtant par l’étroitesse des conceptions esthétiques communistes, il se fait théoricien d’un art du non-savoir, contre la propension à ordonner et à policer du « réalisme-socialiste ». Il s’agit avant tout pour lui de ne pas trahir « toutes ces confuses sensations que nous apportons nuit et jour ». Cela, seule une écriture affirmant sa dimension graphique le peut vraiment. Lignes discursives et lignes expressives doivent être pensées et tracées ensemble, comme en attestent ses logogrammes ou les « peintures-écritures » de Cobra. À ses yeux, l’écrivain est un artiste, voire un artisan ; les gestes de sa main sont ce qui compte avant tout. Ses écrits sur l’art manifestent sa volonté de réconcilier la dimension intellectuelle et la dimension matérielle de l’écriture, le verbe et l’image, de même, dit-il, que sont réconciliés la création et l’interprétation dans le jazz. L’écrivain doit être, selon ses termes, « spontané » et « sauvage ».
Extraits
Il fait si gris, si médiocre, si vieux dans le monde qui nous est proposé qu’un trait d’encre nous touche au cœur comme une flèche, qu’une tache de couleur fait mouche sur lui, et joyeusement fait boule de neige dans l’immense parc solitaire et glacé. C’est que le trait d’encre, la tache de couleur ont tout ensemble les empreintes de l’homme et le prestige de la matière, tandis que le monde qui nous est proposé efface nos empreintes (il préfère les traces de la radioactivité) et n’accorde plus à la matière que le prestige de nous menacer.
Dans le parc solitaire et glacé les ombres qui passent font encore des chinoiseries : Eh quoi, nous disent-elles, eh quoi vous jouez ! Parfaitement, Ombres, nous jouons, nous nous amusons, Alechinsky s’amuse (qui va au cœur de la matière avec le sien), Van Roy s’amuse (qui se fait architecte des mirages de Derrière l’Œil), Bury s’amuse (qui en a eu marre de lécher les St-Honoré du trompe-l’œil), Collignon s’amuse (qui peint les champs où la couleur est son propre engrais), Welles s’amuse (qui le jour fait de la menuiserie), Corneille, François et Claus s’amusent, et Burssens et Vlérick et Bergen et de Coninck s’amusent, et Yvonne Van Ginneken s’amuse, et s’amusent contre vous. Nous ne pensons pas que pour être de son temps il faille s’embêter : nous pensons que derrière le temps de chien qui nous est fait, le temps du plaisir attend, et déjà c’est le nôtre. Plus loin que vos tristes parades, derrière les maisons, après la banlieue, derrière le terrain vague où vous jetez vos vieilles idées (dont d’autres font de nouvelles cravates), s’étend la grande plaine de jeux de la peinture expérimentale, de la jeune peinture, de la peinture qui refuse d’être l’ombre des Ombres ! Nous jouons avec le soleil, avec la mer, avec les cheveux de Gradiva, avec les cailloux, avec la pâte, avec le bois, comme des enfants : nous désapprenons vos leçons de morte morale, de nature morte, de mort générale.
(« Cordialement »)
*
Je connais ton nom, mon amour, je connais le goût de ton sommeil, la chaleur de ton épaule, je connais grâce à toi la forêt noire, l’odeur des branches de sapins brûlées, je connais grâce à Van Gogh l’intensité de l’été provençal de 1888 – et je n’y comprends rien, mais je vis. Je me souviens de la tache de soleil sur tes cheveux, de la courbe de ton geste, et je n’y comprends rien, et je souhaite de n’y jamais rien comprendre – car je souhaite vivre. Je défendrai « toutes ces sensations confuses que j’ai apportées en naissant », toutes ces confuses sensations que nous nous apportons nuit et jour.
(« Nous irons dans les bois et nous y laisserons les lauriers »)