par Jérôme Meizoz
(Université de Lausanne)
Extrait de : Écrire les mondes vernaculaires. Littérature, ethnologie et création sociale, Rimouski/Trois-Rivières, Tangence éditeur, coll. « Confluences », 2021. Chapitre 5, p. 75-95.
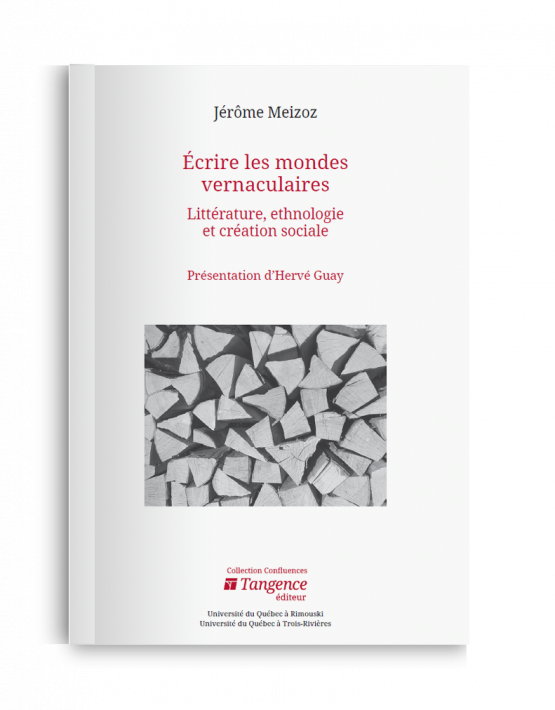
Ce texte est reproduit dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula avec l'aimable autorisation de l'auteur et de son éditeur.
Dossiers Politique.
Pour décrire le traitement littéraire du vernaculaire, voici un bref rappel historique de ses différents dispositifs. Selon Jack Goody, les sociétés fondées sur la raison graphique connaissent en leur sein un « fossé » entre les traditions écrites (religion, droit, histoire et culture lettrée en général) et les traditions orales des cercles familiaux ou locaux, « souvent en pleine contradiction avec les précédentes »[1]. Il faut donc mesurer les tensions internes, dans les sociétés à régime graphique, entre le poids de la culture écrite et la persistance de modalités vernaculaires orales. Les exemples en sont nombreux. Pensons, en cuisine, à la coexistence d'une transmission à dominante orale (la cucina casalingha, en Italie) et d'une codification écrite très élaborée dans les ouvrages de gastronomie savante.
Le vernaculaire en intrigue : questions d'hégémonie
Comme l'apprentissage des techniques d'écriture est lent et complexe, il occupe une bonne partie de l'éducation des enfants. Les coûts de cet apprentissage, dans les univers familiaux éloignés de la culture écrite, sont élevés et porteurs d'effets sociaux discriminants[2]. Qu'on songe aux débats récurrents sur l'illettrisme et ses enjeux dans nos sociétés[3]. Le conflit se manifeste le plus clairement au sein de l'école, institution charnière de la socialisation :
Le spécialiste de la culture littératienne a un mode de pensée qui est par essence et fondamentalement aux antipodes de celui qui s'applique au vécu, au quotidien. Cette opposition est d'ailleurs bien ancrée dans la longue tradition des blagues sur le professeur toujours dans la lune.[4]
Ce n'est ni le personnage de Tournesol (Hergé) ni celui du Schtroumpf à lunettes (Peyo) qui démentiront Jack Goody. Celui-ci fait remarquer que les littératures occidentales modernes et contemporaines thématisent abondamment les progrès ambivalents de la culture écrite et mettent en scène ses enjeux et ses effets. Une telle proposition lui permet d'envisager de manière globale les histoires littéraires occidentales depuis la Renaissance au moins. La tension entre culture écrite et oralité en constitue une ligne de force transnationale et translinguistique. Parmi les textes fondateurs de la modernité romanesque, Goody montre que le Don Quichotte (1606) oppose Sancho, homme de l'oralité et maître des proverbes, à un chevalier errant intoxiqué par trop de livres, détraqué par la lecture des romans de chevalerie. Toute la tradition du « bon sauvage », de Montaigne à Rousseau, reformule en fait les interrogations et réticences des intellectuels à l'égard de l'emprise croissante de la culture écrite. En effet, note Goody, l'idée de l'innocence des primitifs
rend hommage, sans le savoir, à la force que la culture orale puise dans son homogénéité, à l'admiration teintée de jalousie que les personnes éduquées vouent à la vie simple mais solidaire des gens de la campagne, à la dimension d'intemporalité de leur façon de vivre l'instant présent […].[5]
De cette dialectique, on connait nombre d'expressions, de Robinson Crusoé de Defoe (1719) à Paul et Virginie (1788) de Bernardin de Saint-Pierre : « Paul et Virginie n'avaient ni horloges, ni almanachs, ni livres de chronologie d'histoire, et de philosophie. »[6]. Une étude de grande ampleur pourrait les collecter, de Stendhal (Le Rouge et le noir, 1830) à François le champi (1850) de George Sand ; de Jules Vallès dénonçant les « victimes du livre »[7] à La Vie d'un simple d'Emile Guillaumin (1904) ; de Un de Baumugnes (1931) de Giono à Mort à crédit (1936) de Céline ; de Zazie dans le métro de Queneau (1959) au Petit Nicolas de Sempé (1962) ; de Coco perdu de Louis Guilloux (1972) à Lila dit ça de Chimo (1997). En 1968, moment de la « prise de parole »[8] de la jeunesse contre les institutions pérennisées par un patrimoine écrit, Jean Dubuffet s'en prend, dans Asphyxiante culture, au figement élitaire de la culture officielle. Là encore, les deux régimes sont mis en tension :
L'idée de l'Occidental, que la culture est une affaire de livres, de peintures et de monuments, est enfantine ; et il est probable que les nations qui ont connu les plus hauts degrés de cérébralité sont celles qui n'ont légué aucune trace de cette sorte – ni trace du tout, peut-être – et chez qui la pensée ne connaissait d'autre voie d'expression qu'orale.
Il se pourrait qu'écrire, à cause de la mise en forme que cela implique, entraîne, bien plus que l'expression orale (qui l'entraîne elle-même déjà) un alourdissement, un empêtrement de la pensée, et, en tout cas, une inclination pour celle-ci à entrer dans des moules traditionnels qui l'altèrent. [9]
Il faudrait également s'éloigner du canon traditionnel pour observer de tels phénomènes dans les genres peu consacrés comme la poésie ouvrière et la chanson de rue au XIXe siècle, ou le roman policier dans les premières décennies du XXe. Et la fameuse bande dessinée Astérix le Gaulois n'oppose-t-elle pas constamment l'oralité du colonisé (le barde Assurancetourix ; la parole du chef du village) à l'écriture de l'envahisseur (les tablettes gravées des Romains) ?
On peut faire l'hypothèse qu'une partie de la production littéraire, depuis les Lumières au moins, met en intrigue les déplacements, tensions et reflux du mode vernaculaire et, à travers eux, les injonctions à s'adapter à un ordre culturel nouveau. Mais on y lirait aussi les ruses et bricolages pour détourner ou résister à ce reflux qui profite à la culture écrite. Songeons aux écrits de Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de St Pierre, Restif de la Bretonne, Paul-Louis Courier, Rodolphe Töpffer, Nerval, Sand, Vallès, Alain-Fournier, Pergaud, Péguy, Louis Hémon, Henri Pourrat, Ramuz, Giono, Prévert, Henri Calet et plus récemment Annie Ernaux, Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Jean-Loup Trassard, Marie-Hélène Lafon, etc. Il vaudrait aussi la peine d'examiner des cas plus anciens, de Villon à Rabelais, de Montaigne à Molière, sans oublier Bocaccio, Cervantès, Defoe ou, dans le monde germanique, Thomas Platter, Ulrich Bräker, Jeremias Gotthelf ou Gottfried Keller.
À plusieurs reprises, on a constaté l'extraordinaire porosité syncrétique des usages vernaculaires : bien des textes « littéraires », parce qu'ils font place au détail signifiant, à la pluralité des points de vue et des voix, en fournissent des exemples. Bien que très (sans doute trop) générale, la polarisation entre règles planifiées (normes verticales) et astuces pratiques (usages horizontaux) est néanmoins suffisamment prégnante, sociologiquement, dans l'histoire des sociétés européennes, pour structurer nombre de récits, s'infiltrer dans les intrigues et en orienter les schémas actantiels.
La tension entre la planification abstraite et les bricolages vernaculaires anime dialectiquement ces cultures narratives parce qu'elle travaille en profondeur les formes de vie comme les jeux de langage. Examinons-en de plus près quelques exemples.
Jean-Jacques Rousseau, « un supplément à la parole »
Pour Jean-Jacques Rousseau, marqué par le sensualisme de Condillac et l'empirisme de Hume, l'écriture apparaît toujours comme un état second de la parole. Elle tend à faire écran aux passions portées par la voix : « Les langues sont faites pour être parlées, l'écriture ne sert que de supplément à la parole ; »[10]. Substituée à l'oral, l'écriture entraîne la déperdition des traits de la parole, comme les accents, et s'avère incapable de les restituer dans son corps abstrait. En outre, elle exerce un effet en retour sur l'oralité. Sous le sceau de l'écriture, la parole se transforme en une sorte de dictée calquée sur la forme écrite, raison pour laquelle « on ne fait plus que lire en parlant » :
L'écriture, qui semble devoir fixer la langue, est précisément ce qui l'altère ; elle n'en change pas les mots, mais le génie ; elle substitue l'exactitude à l'expression. L'on rend ses sentiments quand on parle, et ses idées quand on écrit. En écrivant, on est forcé de prendre tous les mots dans l'acception commune ; mais celui qui parle varie les acceptions par les tons, il les détermine comme il lui plaît ; moins gêné pour être clair, il donne plus à la force ; et il n'est pas possible qu'une langue qu'on écrit garde longtemps la vivacité de celle qui n'est que parlée. On écrit les voix et non pas les sons : or, dans une langue accentuée, ce sont les sons, les accents, les inflexions de toute espèce, qui font la plus grande énergie du langage, et rendent une phrase, d'ailleurs commune, propre seulement au lieu où elle est. Les moyens qu'on prend pour suppléer à celui-là étendent, allongent la langue écrite, et, passant des livres dans le discours, énervent la parole même. En disant tout comme on l'écrirait, on ne fait plus que lire en parlant. [11]
Si l'on croit suppléer à l'accent par les accents [typographiques], on se trompe : on n'invente les accents que quand l'accent est déjà perdu. (idem, p. 390)
À l'origine, le langage accentué dominait, bientôt transformé pour les besoins de la communication sociale par un langage articulé. Comprendre l'histoire des langues, selon Rousseau, c'est suivre les progrès de l'articulation jusqu'à l'écriture, qui en est la limite : l'accent y disparaît presque, alors que l'articulation y règne en maîtresse. Peu à peu, la force de l'accent cède aux règles des grammaires. De là, des régimes différents d'action langagière : ainsi, dans le vocabulaire de Rousseau, l'accent persuade (émotion, oralité) alors que l'articulation convainc (raison, écriture). Enfin, à l'écrit, la présence du corps de l'énonciateur s'efface, et des ressources différentes doivent y suppléer. La communication, fortement médiatisée, se fait aléatoire et différée. Si l'Essai propose ailleurs de considérer l'oral et l'écrit comme deux ordres distincts, sans présumer de leur valeur respective, le degré de complexité d'une culture semble indépendant de ses techniques d'écriture :
L'art d'écrire ne tient point à celui de parler. Il tient à des besoins d'une autre nature, qui naissent plus tôt ou plus tard, selon des circonstances tout-à-fait indépendantes de la durée des peuples, et qui pourraient n'avoir jamais eu lieu chez des nations très-anciennes. On ignore durant combien de siècles l'art des hiéroglyphes fut peut-être la seule écriture des égyptiens ; et il est prouvé qu'une telle écriture peut suffire à un peuple policé, par l'exemple des Mexicains, qui en avaient une encore moins commode. [12]
À cette tension entre la parole vive et la médiation de l'écriture, s'ajoutent d'autres couples d'oppositions à l'œuvre chez Rousseau, fondés sur la même axiologie : ville/campagne, élites urbaines/paysans, Paris/province, etc. Dans le récit conjectural des origines de l'inégalité, l'écriture (même si Rousseau ne la décrit pas explicitement en termes médiologiques) apparaît comme l'une des institutions, avec la propriété privée et le droit, ayant suscité la stratification sociale puis perpétué les inégalités. L'emprise excessive que l'écrit exerce sur l'échange oral a trait, selon Rousseau, à la forme des gouvernements « qui fait qu'on n'a plus rien à dire au peuple » [13] :
Depuis longtemps, on ne parle plus au public que par des livres, et si l'on lui dit encore de vive voix quelque chose qui l'intéresse c'est au théâtre. […] Les livres bien écrits vont partout. Dans les provinces, dans les villages, chez l'étranger. Il n'y a point de lieu reculé où l'on ne puisse étudier les règles de la langue dans les ouvrages qui en traitent et voir l'application de ces règles dans les écrits des bons auteurs. Il n'en est pas de même des règles de la prononciation. Ce ne sont pas les livres qui les portent, ce sont les hommes. (p. 1250)
Ainsi l'échange oral perdrait peu à peu en prestige au bénéfice des modèles écrits. Selon Rousseau, seule une société de petite taille, fondée sur les échanges oraux assure une transparence de communication. L'écrit, permettant une démultiplication de sa diffusion, tend à se figer en un modèle désincarné. La prééminence de l'écrit augmente ainsi l'ascendance de Paris sur les provinces, et celle des élites urbaines sur les paysans (p. 1252). C'est pourquoi Rousseau prend le parti d'une innocence paysanne supposée contre la perversion urbaine, par exemple dans la préface de La Nouvelle Héloïse (1761). Son jugement rejoint celui, implicite, prononcé dans le premier Discours (1750) :
Il est singulier qu'à mesure que les lettres se cultivent, que les arts se multiplient, que les liens de la société générale se resserrent, la langue se perfectionne tant par l'écriture et si peu par la parole. Pourquoi les hommes en se rapprochant sont-ils si soigneux de bien dire, de l'art de parler à distance, et si peu de l'art de parler de vive voix ? C'est que le discours prononcé se noie au milieu de tant de parleurs et que l'a célébrité ne s'acquiert que par les livres. (p. 1251)
Menacée ou perdue, l'oralité renvoie alors à la beauté du reste, ce résidu d'une société disparue où le travail peu divisé et les contacts entre individus auraient lieu au contact physique des autres[14]. Oralité heureuse le plus souvent, chez Rousseau, s'exprimant par la musique née selon lui des chants des femmes à la fontaine. Ou à l'occasion de réjouissances populaires (la Fête des Vignerons, au bord du lac Léman) où une petite société met en scène pour elle-même l'innocence de ses mœurs. […]
C. F. Ramuz et le refoulé du dialecte
Nombre de critiques ont souligné l'intérêt de C. F. Ramuz (1878-1947) pour les mondes vernaculaires, réputés élémentaires, authentiques ou protégés. Héritage de la mélancolie romantique du «dernier» témoin en voie de disparition (Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans, 1826), cette curiosité est faite d'urgence et de fascination à recueillir et témoigner de pratiques avant qu'elles ne disparaissent. Elle motive en profondeur la quête des folkloristes et des ethnographes depuis le début du XIXe siècle (Fabre 2010).
À la lumière de cette tradition, on peut lire Le Village dans la montagne (1908) de Ramuz comme un protocole folkloriste mis en récit et en images (par le peintre Edmond Bille) pour un large public. L'écrivain suisse y décrit, selon le cycle saisonnier, la production (élevage, fromages, combat de vaches, inalpe), le langage (le dialecte, les légendes comme «les âmes sur le glacier»), les activités coutumières et rituelles (mariages et enterrements, tir, danse), et mentionne aussi des pratiques récentes (le tourisme). Examinant les légendes, il reprend un motif courant chez les folkloristes :
Ils ont eu beaucoup de légendes, ils n'en ont plus guère. Ils ont cru à la ouivre, aux fées et aux esprits malins ; à présent, quand on leur en parle, ils rient, ou plutôt ils font semblant de rire, parce que tout au fond d'eux-mêmes, peut-être, ils ont gardé un reste de croyance, mais ils ont peur qu'on se moque d'eux. [15]
Ils ont cru à beaucoup de choses et n'y croient plus beaucoup… (p. 162)
Dans la perspective romantique, on déplore la disparition des légendes. Les autochtones adoptent de plus en plus à leur égard une distance ou une attitude clivée, parce que le regard de l'autre (le touriste, le folkloriste, l'écrivain en visite…) a semé le doute. Il n'y a donc plus de croyance heureuse, une immersion culturelle sans dehors, et le rire gêné en est la manifestation palpable.
Autre intérêt, plus proche du projet littéraire de Ramuz, celui accordé au parler vernaculaire, objet d'étude des grammairiens et philologues. En littérature, les parlers régionaux, les langages de métier ou de classe s'intègrent aux dialogues romanesques (Balzac), par l'indirect libre (Flaubert, Zola) ou par la technique du «roman parlant», chez Ramuz, Céline, Queneau, Cendrars ou Aragon (Meizoz 2015 [2001]).
Typique du mode vernaculaire, le dialecte opère souterrainement dans la littérature française comme dans celle de Suisse romande : certes, on ne l'écrit pas ou plus, mais la réflexion sur son impact formel et tonal sous-tend bien des rapports à la langue[16]. Bien que hantés par la conscience diglossique, les textes littéraires modernes ne manifestent que la variété standard : « Ne pas mettre le mot patois : ça fait pittoresque. »[17]. En général, Ramuz a soigneusement évité les termes régionaux et dialectaux :
On parle beaucoup, ces temps-ci, de “régionalisme”: nous n'avons rien de commun avec ces amateurs de « folklore ». [...] Nos usages, nos moeurs, nos croyances, nos façons de nous habiller, les mots à nous que nous pouvons avoir, et qu'on dise une « boille » au lieu d'une hotte à lait, toutes ces petitesses-là, qui ont seules paru intéresser jusqu'ici nos fervents de littérature, non seulement seront pour nous sans importance, mais encore nous sembleront singulièrement sujettes à suspicion. [...] Le particulier ne peut être, pour nous, qu'un point de départ. On ne va au particulier que par amour du général et pour y atteindre plus sûrement. [18]
Cependant, sa réflexion sur l'écriture passe par la reconsidération de l'impact dialectal, et s'inspire sur ce point du poète Juste Olivier dans Le Canton de Vaud (1835). Ramuz a cherché dans une intense élaboration syntaxique à tirer le meilleur parti expressif des inflexions et rythmes de la langue parlée :
Toutes les fois qu'on a parlé notre langue chez nous dans des livres, ç'a été pour s'en moquer. [...] Notre patois qui a tant de saveur, outre de la rapidité, de la netteté, de la décision, de la carrure (les qualités qui nous manquent le plus quand nous écrivons en « français »), ce patois-là, nous ne nous en sommes jamais ressouvenus que dans la grosse comédie ou dans la farce, comme si nous avions honte de nous-mêmes. C'est pourtant à lui qu'il faudra bien en revenir, lui seul pourra jamais nous servir de modèle (et là encore la transposition doit intervenir, car il n'y a pas d'art sans transposition); mais seul il constitue vraiment une forme pour nous, parce que préexistant, parce que défini, parce que sorti du sol même. Voilà par où déjà l'objet s'évade de ce qu'il est, sollicité par cet accent issu de lui.[19]
Ramuz préconise la « transposition », et non l'usage littéraire du dialecte. Le manifeste Raison d'être, en rupture déclarée avec les canons nationaux et parisiens, prône la refondation sur place (à l'exemple de Cézanne en peinture) d'une pratique littéraire en français : « Il faut que, notre rhétorique, nous nous la soyons faite sur place, et jusqu'à notre grammaire, et jusqu'à notre syntaxe [...] » (p. 37). On est loin ici de la sécession félibrige (Mistral) et de ses avatars. Au contraire, Ramuz veut, en français, tirer bénéfice des ressources expressives du patois (rythme, inflexion, ton). Non du patois même, mais de ce qui en subsiste dans le français des vaudois, c'est-à-dire l'accent :
Ô accent tu es dans nos mots, et c'est toi l'indication, mais tu n'es pas encore dans notre langue écrite. Tu es dans le geste, tu es dans l'allure, et jusque dans le pas traînant de celui qui revient de faucher son pré ou de tailler sa vigne : considérez cette démarche et nos phrases ne l'ont pas. (RE, p. 45).
Jérôme Meizoz (Université de Lausanne), 2021
Mis en ligne dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula en octobre 2021.
[1] Jack Goody, « The consequences of literacy » (1968), in M. Kara & J.-M. Privat (dir.), La Littératie. Autour de Jack Goody, Pratiques, no 131-132, Université de Metz, décembre 2006, p. 60.
[2] Jean-Marie Privat in La Littératie, ouvr. cit., 2006, p. 130.
[3] Voir les thèses de Bernard Lahire (contre celles du linguiste Alain Bentolila), dans L'Invention de l'illettrisme, La Découverte, 1999.
[4] Jack Goody in M. Kara & J.-M. Privat, La Littératie, ouvr. cit., 2006, p. 61.
[5] Jack Goody in M. Kara & J.-M. Privat, La Littératie, ouvr. cit., 2006, p. 61.
[6] Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie [1788], Garnier-Flammarion, 1984, p. 47.
[7] Jules Vallès, « Victimes du Livre », Le Figaro, 9 octobre 1862, in Littérature et révolution, Editions sociales, 1969, pp. 57-66.
[8] Michel de Certeau, La prise de parole, pour une nouvelle culture [1968], Points-Essais, 1994.
[9] Jean Dubuffet, Asphyxiante culture (1968), ouvr. cit., 1986, pp. 20-21.
[10] Jean-Jacques Rousseau, « Prononciation », O.C. II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 1249. Je cite désormais les O.C., volumes I à V, dans cette édition.
[11] Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues, O.C. V, p. 388.
[12] Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues, chap. V, « De l'écriture », O.C. V, p. 386.
[13] Jean-Jacques Rousseau, « Prononciation », O.C. II, p. 1250.
[14] La différence entre oralité et écriture recoupe en partie les formes de socialisation décrites par Emile Durkheim dans De la division du travail social (1893), sous le nom respectivement de solidarité « mécanique » versus « organique ».
[15] C. F. Ramuz, Le Village dans la montagne, chapitre XVI, Œuvres complètes, éd. Rencontre, 1968, p. 159.
[16] Jérôme Meizoz, « L'écriture des patois en Suisse romande: un “tabou diglossique”? (XIXe-XXe siècles) », in Ch. Baumberger, S. Kolberg, A. Renken (dir.), Polyphonies littéraires en Suisse / Literarische Polyphonien in der Schweiz, Peter Lang, «Variations», vol. 6, 2004, pp. 17-41.
[17] C. F. Ramuz, Journal, 9 février 1942, t. 2, L'Aire, 1978, p. 399.
[18] C. F. Ramuz, Raison d'être, ouvr. cit., p. 57.
[19] C. F. Ramuz, Raison d'être, [1914], ouvr. cit., pp. 45-46.