Le déni du calembour, par Alain Vaillant.
Chapitre 2 de Le Veau de Flaubert, Paris, Éditions Hermann, coll. "Fictions pensantes", 2013.
Extrait reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur et des éditions Hermann.
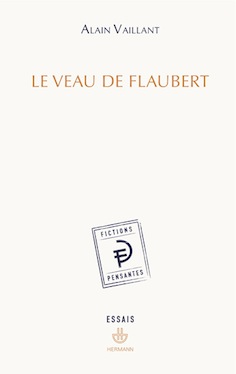
«...j'en vins à jeter les yeux, la millième fois peut-être, si l'on me passe l'hyperbole, sur l'illustrissime incipit de Madame Bovary, sur ce véritable Pont-aux-Ânes de la narratologie, où un pronom nous, si déplacé chez le parangon de l'impersonnalité littéraire, semble défier le lecteur dès les premiers mots, suivi de peu par un "nouveau" assorti d'italiques et, précise encore le texte, "habillé en bourgeois": "Nous étions à l'étude, quand le Proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un pupitre." Or, une évidence s'est alors spontanément imposée à moi – non comme le résultat laborieux d'un décryptage poursuivi à toute force, mais comme une image apparue à mon insu sans que je l'aie le moins du monde recherchée –: ce "nous" ne se trouvait pas face à un quelconque "nouveau", mais à un "nous-veau", à un nous transformé par une moderne Circé (Flaubert lui-même) en veau, et cette confrontation inaugurale entre le "nous" (nous, les hommes, autant que nous sommes) et, comme disait Gilles Deleuze, notre "devenir-animal", m'a semblé offrir d'emblée, sous la forme d'une magnifique et réjouissante métamorphose, toute la morale de l'histoire.
(...)
Reconnaître le calembour, c'est admettre que le chef-d'œuvre inaugural du réalisme français, sa référence absolue et mythique, commence par une blague et un éclat de rire. Le rire est l'éternel proscrit de la critique scolaire ou universitaire, celle des "pédagogues tristes", selon le mot réjouissant de Hugo. à moins de servir à donner des leçons de morale, comme s'y emploie la satire classique. Ou, dans sa version moderne, sauf à emprunter l'apparence plus respectable de l'ironie: selon la conception vaguement philosophique qu'on s'en fait ordinairement, l'ironie est un rire seulement esquissé, celui d'un homme qui n'aurait ni l'énergie d'être franchement sérieux, ni le courage d'être ouvertement comique.» (extraits de l'introduction).
LE DÉNI DU CALEMBOUR
I. L'ANIMALISME ROMANTIQUE
Tout le mystère du célèbre incipit de Madame Bovary tiendrait donc dans un animal, un simple veau. Mais il est temps de souligner que la chose n'est en elle-même ni scandaleuse ni même originale. À vrai dire, il n'y a d'ailleurs pas beaucoup d'idées originales chez Flaubert: à s'en tenir aux éclats de voix bougons ou aux formules toujours définitives qui émaillent sa correspondance, il incarne assez bien le scepticisme critique de l'intellectuel bourgeois, sa méfiance invétérée pour toute sorte d'idéal, ce qu'on nomme parfois un «anarchisme de droite» et qui finit toujours par ressembler à un conservatisme confortable et à courte vue. Si l'on ne craignait d'alimenter un éventuel remake du Dictionnaire des idées reçues, on dirait qu'il est un parfait représentant d'un travers français, qui confond l'esprit de critique (avec l'ironie facile qu'il implique) avec l'intelligence. On insiste trop sur les lectures faites par Flaubert, sur son érudition scientifique ou historique, sur la rigueur de sa documentation. Les critiques universitaires, faisant ainsi, plaident évidemment pour eux-mêmes, eux qui, par nécessité professionnelle, tirent leur légitimité des livres savants qu'ils ont lus puis de ceux qu'ils ont écrits: comment pourraient-ils comprendre Flaubert, prendre au sérieux sa haine des savoirs? Bien sûr, lui aussi a beaucoup lu: il n'avait que cela à faire; en somme, c'était sa manière à lui de se concentrer sur son écriture, de supporter les longues plages, désespérément grises, de la préparation de l'œuvre puis de sa rédaction. Il n'empêche: ses idées sont celles d'un honnête homme du Second Empire, raisonnablement intelligent, curieux et original. Mais il n'a pas une vision personnelle de l'homme ou de la société – je n'en dirais pas autant de Balzac, par exemple –; blindé par son pessimisme radical, il n'a pas vraiment le sens du devenir historique: ici, je l'opposerais assez volontiers à Hugo. Non, ce qu'il a en propre, la seule chose qu'il ait jamais revendiquée de façon sérieuse, c'est d'éprouver si intensément ses idées et ses convictions, ses lieux communs à lui, de se sentir si vibrant des extases ou des inconsolables tristesses qu'elles provoquent en lui, qu'il a trouvé le secret d'en faire de l'art – pour écrire des livres qu'il faut bien appeler, faute de meilleur terme, des chefs-d'œuvre.
L'animal, donc: non seulement Flaubert n'est pas le premier à s'intéresser à l'animal, mais celui-ci peut à bon droit être considéré comme le véritable emblème du romantisme – d'un romantisme compris au plein sens du terme, dont l'auteur de La Tentation de saint Antoine participe mieux que personne, du moins sur le plan émotionnel. Car, au-delà des multiples définitions partielles ou spécialisées qu'on peut avancer, le romantisme se caractérise, encore et toujours, par une obsession fondamentale, une utopie sans cesse poursuivie malgré toutes les désillusions: la synthèse heureuse de l'intelligible et du sensible, de l'esprit et du corps, de l'invisible et du visible, de l'idéal et du réel[1]. En principe, cette synthèse est constitutive de la nature humaine, puisque, théologiquement, l'homme est censé être le seul être situé à l'intersection des deux ordres de réalités qui composent l'univers. Mais, en réalité, il sait bien que la fusion totale, donc le retour à l'unité, est impossible: c'est précisément cette dualité qui, pour les romantiques allemands et, après eux, pour le Hugo de la Préface de Cromwell (1827), explique l'abîme qui sépare les cultures antique et moderne – le romantisme cultivant de façon masochiste la conscience de cet abîme, jusque dans ses ultimes conséquences. L'homme romantique ne désire donc pas la réalisation de l'unité: il la regrette, parce qu'il la pense impossible; il est absolument persuadé de devoir rester, à tout jamais, un être double, partagé entre ses deux composantes antagonistes. Il se voudrait plus et mieux qu'un homme, et s'identifie alors à ces deux surhommes que sont, symétriquement, l'ange et l'animal.
Bien sûr, c'est l'ange qui a d'abord hanté le romantisme – le romantisme nimbé de la religiosité fervente de la Restauration. L'ange a l'avantage exclusif de passer sans difficulté apparente du ciel aux cieux, de la nature atmosphérique de l'espace naturel à l'infini éthéré qui est réservé à Dieu[2]. Mais, justement, l'ange reste un esprit honteux de son semblant de corporéité; son romantisme est frileux, d'avance repentant, rempli de crainte parce qu'il sait bien que, tôt ou tard, il devra choisir entre la nature et la sacristie. Dans Illusions perdues, le baron du Châtelet, formé au rationalisme du Premier Empire, a beau jeu de se moquer des anges qui encombrent la poésie toute ruisselante d'angélisme sentimental de Lucien de Rubempré: «C'est des vers comme nous en avons tous plus ou moins fait au sortir du collège […] Autrefois nous donnions dans les brumes ossianiques. […] Aujourd'hui, cette friperie poétique est remplacée par Jéhova, par les sistres, par les anges, par les plumes des séraphins, par toute la garde-robe du paradis remise à neuf avec les mots immense, infini, solitude, intelligence[3]».
De fait, l'ange ne résistera pas longtemps à l'effondrement de la monarchie de droit divin, en 1830, et de son cléricalisme revendiqué – sinon à titre de vestiges ou sous la forme ironiquement satanique que lui donnera Baudelaire, celle du vampire. Il laisse la place à sa version esthétisante et sexuée, l'androgyne[4]: d'abord l'androgyne encore très céleste de Balzac, Séraphitus-Séraphita, mi-homme mi-ange, puis le voluptueux androgyne à la manière de Gautier et de sa Mademoiselle de Maupin qui, cette fois, rompt totalement avec le spiritualisme pour recueillir l'héritage de l'érotisme antique (c'est-à-dire païen). Cependant, l'androgyne gardait quelque chose de trop artificiel, correspondait de façon trop évidente à une rêverie mystique ou plastique pour permettre, au-delà du désir souvent malicieux de provoquer et de séduire, un réel investissement sensible. L'animal a donc pris la place de l'ange, et ce n'était que justice. La religion avait établi une frontière infranchissable entre l'homme et l'animal; celui-ci ne servait en littérature, comme dans les fables de La Fontaine, qu'à offrir de simples masques allégoriques, aussi commodes que transparents. La déchristianisation de l'après-Révolution a permis, beaucoup plus franchement qu'au XVIIIe siècle des Lumières et de l'Histoire naturelle de Buffon, d'envisager enfin l'animal pour lui-même, ainsi que pour ses profondes et troublantes affinités avec l'homme. Aussi le romantisme s'est-il passionné pour l'animal[5]; non pas tout le romantisme, mais ce romantisme fasciné par la matière, sinon tout à fait matérialiste, qui, après les Trois Glorieuses, ne quittera plus la scène artistique.
L'animal a d'abord investi les peintures de Géricault ou Delacroix, les sculptures de Barye. On a reproduit, avec une fascination violente ou alanguie, les mufles massifs des bœufs, les croupes ou les cuisses musculeuses des chevaux, la sauvagerie sanguinaire des lions, l'élégance énigmatique des chats[6]. Les animaux envahissent aussi la littérature. Les œuvres du plus matérialiste des romantiques, Victor Hugo, réunissent ainsi, prose et poésie confondues, une extraordinaire arche de Noé: de l'ours de Han d'Islande à L'Âne, en passant par la chèvre de Notre-Dame de Paris, la pieuvre des Travailleurs de la mer, le loup de L'Homme qui rit, le bestiaire familier des Chansons des rues et des bois. La même passion poussera Michelet à passer de l'histoire du peuple à l'exploration d'autres mystères, ceux des oiseaux puis des insectes et des poissons[7]. Ducasse peuple ses Chants de Maldoror d'un prodigieux pandémonium où grouille grotesquement, en plus de monstres sadiques, d'êtres fantastiques et d'un Dieu passablement débauché, une ménagerie improbable et proliférante d'insectes, de bêtes sauvages ou domestiques, d'oiseaux ou d'animaux marins.
Deux êtres dominent presque toujours ces multiples collections d'animaux, réalisant le plus complètement l'idéal synthétique du romantisme: l'oiseau parce que, ange totalement débarrassé des cieux, il se meut dans un espace double, céleste et terrestre, sans se départir de son être purement corporel; le bœuf dont l'imperturbable et méditative rumination semble vouloir initier l'homme aux mystères insondables de la nature. L'oiseau et le bœuf, symbolisant l'un et l'autre pour Hugo la vérité profonde de la littérature. Les oiseaux, dans «Réponse à un acte d'accusation», sont tous les mots innombrables de la poésie, libérée par la révolution romantique, avec «ses millions d'yeux sur ses millions d'ailes[8]». Et les mugissements des bœufs, qui donnent son titre virgilien au «Mugitusque boum» des Contemplations, sont les «grandes voix solennelles[9]» qui font résonner jusque dans le livre du poète les vérités éternelles de la nature. Même diptyque chez Rimbaud qui, dans «Les Corbeaux», se représente en «fauvette[s] de mai[10]», après avoir terminé son idylle sentimentale des «Reparties de Nina» par l'évocation de «l'étable / pleine de fumiers chauds», où «[u]ne vache fienterait, fière[11]»: il faut n'avoir pas vécu à la campagne pour ne pas saisir la beauté émouvante de cette chaude bouse de vache s'écrasant majestueusement sur le sol de l'étable villageoise.
Mais le meilleur de ce romantisme animalier se trouve peut-être dans le Chant des paysans qui fut le grand tube de Pierre Dupont, le chansonnier populaire de 1848, et que chante justement un brave pharmacien éméché à la soirée donnée par Dussardier, dans L'Éducation sentimentale. Il suffira ici de lire la première strophe et le refrain, pour en mesurer la profondeur toute bovaryenne:
J'ai deux grands bœufs dans mon étable,
Deux grands bœufs blancs marqués de roux;
La charrue est en bois d'érable,
L'aiguillon en branche de houx.
C'est par leurs soins qu'on voit la plaine
Verte l'hiver, jaune l'été.
Ils gagnent dans une semaine
Plus d'argent qu'ils n'en ont coûté.
[Refrain]:
S'il me fallait les vendre,
J'aimerais mieux me pendre,
J'aime Jeanne, ma femme,
Eh bien! J'aimerais mieux
La voir mourir
Que voir mourir mes bœufs.
On ne doit pas s'étonner s'il revient à l'esprit, à propos de ces animaux romantiques, les Bucoliques de Virgile, l'invocation à Vénus en ouverture du De natura rerum de Lucrèce, tel vers de Properce ou d'Ovide. Car, au-delà de l'imprégnation latine, précoce, forcenée et continuelle, qui caractérise la pédagogie du XIXe siècle et qui, inévitablement, laisse une empreinte profonde dans les textes, et jusque dans la manière de concevoir et de faire de la littérature, ces échos suggèrent à eux seuls le sens véritable de cet animalisme; appelons-le un «épicurisme romantique». L'épicurisme doit s'entendre en son sens littéral et antique, qui recouvre une adhésion totale de l'esprit et de la sensibilité au présent (d'où le célèbre carpe diem) et une égale antipathie à l'égard des abstractions, des idéalismes qui s'interposeraient et feraient obstacle entre le sujet et le monde; il apprend à regarder les choses qui nous environnent, et à les aimer telles qu'elles sont, avec reconnaissance et, parfois, gourmandise. Mais cet épicurisme, ressuscité en plein XIXe siècle et anticléricalement avivé par l'ignorance méprisante et inquiète à l'égard du monde naturel que manifeste une église catholique tout à sa reconquista postrévolutionnaire, se mêle à un idéalisme paradoxal, un désir persistant d'absolu qui sont venus en droite ligne du romantisme, que les oiseaux et les bœufs, à eux seuls, ont évidemment beaucoup de mal à satisfaire totalement et dont même un Rimbaud ne parviendra pas à se déprendre. De cette contradiction latente, inscrite au cœur même d'un hédonisme de principe et de façade, sourd cette douce mélancolie qui, chez Flaubert, prend l'allure du plus franc désespoir.
II. JEAN RICARDOU ET L'INVENTION DU NOUS-VEAU
Revenons donc à Flaubert et à son nouveau. On devrait parler de calembours ou de secrets «dormants», dans les textes littéraires, comme on parlait d'«espions dormants», pendant la Guerre froide, pour qualifier les espions qui, recrutés dans les pays ennemis, pouvaient mener leur vie normale pendant des décennies jusqu'au jour où ils étaient «réveillés», remis en activité selon les besoins de leur service de renseignements. Le nouveau, que j'avais d'abord cru découvrir (ou «inventer» au sens spéléologique du terme), a en fait été réveillé en 1974 (ou en 1972, on le verra) – soit plus d'un siècle après la publication de Madame Bovary. Il vaut la peine de s'attarder à cette révélation – tardive et, finalement, à bien des égards manquée.
Du 21 au 28 juin 1974, se déroule au château de Cerisy-la-Salle, haut lieu de la convivialité savante, un colloque consacré à «La production du sens chez Flaubert». En ces temps déjà anciens où l'on semblait devoir chaque jour refaire la littérature et la théorie littéraire dans l'ambiance aussi fiévreuse qu'enfumée de l'après mai 68, les colloques, qui ne s'étaient pas encore multipliés comme les pains dans le désert, étaient de grands moments de liturgie intellectuelle. On y employait de grands mots; on mimait de grandes passes d'armes à coup de formules ou d'excommunications; mais on pensait aussi de grandes choses. On était d'ailleurs tellement conscient de l'importance de tout ce qui s'y disait qu'on prenait soin de publier, non seulement les communications elles-mêmes, mais aussi (et parfois surtout) les discussions vives, contradictoires, qu'elles ne manquaient pas de susciter[12]. Le colloque de 1974 – qui, l'expression est légitime pour une fois, a fait date dans les études flaubertiennes – réunissait notamment parmi les orateurs une brochette de spécialistes, éminents ou en voie de le devenir, de Flaubert lui-même (Jeanne Bem, Raymonde Debray-Genette, Claude Duchet, Jacques Neefs) ou du XIXe siècle (Graham Falconer, Françoise Gaillard, Henri Mitterand, Jacques Seebacher), sans compter, invités à participer aux débats, une autre brigade d'universitaires (parmi lesquels Jean Bellemin-Noël, Maurice Delcroix, Philippe Hamon, Claude Mouchard, Jean-Luc Steinmetz). Et donc, au titre de ses diverses contributions à la littérature, à la théorie du roman aussi bien qu'à la critique flaubertienne, Jean Ricardou.
L'exposé de Ricardou part d'une réflexion, aujourd'hui banale, sur la tension, constitutive de l'esthétique du roman, entre récit et description; mais nous en sommes encore, en 1974, aux temps héroïques de la narratologie: trois ans après le livre du même Ricardou, consacré au Nouveau Roman (Pour une théorie du nouveau roman, Paris, Seuil, 1971), mais sept ans avant celui de Philippe Hamon sur la description[13] – sans omettre, bien sûr, les travaux fondateurs de Gérard Genette, dont les trois premiers volumes de Figures ont déjà paru, de 1966 à 1972. Selon Ricardou, «[s]i le récit ne peut se passer de la description qui l'accrédite, la description ne s'accomplit qu'en perturbant le cours du récit[14]».
Cette situation de conflit, Ricardou décide de la nommer «belligérance», en détaillant ses conséquences textuelles et en les appliquant à l'incipit de Madame Bovary (notamment à la description de la casquette). Mais il souligne aussi que, parfois, le texte lui-même aide à gérer certaines situations de conflit, notamment par le phénomène d'«anagrammatisation»: ce sont alors les lettres d'un mot matriciel, disséminées dans le texte, qui contribueraient à engendrer les éléments descriptifs aussi bien que narratifs et à fondre ensemble les deux types de textes qui composent tout roman. Il en fournit deux exemples. Il suggère d'abord que le mot «Bovary» est dispersé dans la description de la casquette, comme le prouve, selon lui, la densité des B et des C (initiales de Charles Bovary). Puis il en vient au «nouveau»:
[…] ceci dût-il déplaire, Bovary le bœuf est jeune encore, dans la scène initiale ou, si l'on préfère, c'est un veau, ou encore un nouveau, à la casquette neuve. Ainsi se laisse entendre par quel relai phonique s'est établie la scène initiale: Bovary, jeune veau, fraîchement issu de sa campagne, est accueilli par un personnage collectif moins énigmatique, si l'on constate qu'avec lui advient, au premier mot du livre, une très opportune syllabe: nous.[15]
L'essentiel est déjà trouvé: le veau, ainsi que son lien calembourdesque avec le «nous» initial. Il est vrai que ce lien n'est pas sémantiquement motivé. Le «nouveau» reste un nou-veau, et non pas le nous-veau dont j'ai fait l'hypothèse. Le jeu de mots servirait seulement à indexer la simplicité paysanne du jeune Charles, en l'opposant aux autres collégiens, au lieu d'en faire l'emblème burlesque d'une humanité globalement animalisée. Mais, dans les discussions qui suivent sa communication, des auditeurs de bonne volonté se sont eux-mêmes employés à prolonger sa démarche et à l'étayer avec de solides arguments. D'abord, Alain Goulet:
[…] ce caractère bovin de Bovary, on peut l'articuler avec d'autres observations. Par exemple, à maintes reprises, Flaubert oppose l'agriculture des pâturages et des prés, domaine du travail de l'homme, à cet espèce d'avachissement que représente le «bovarysme», qui peut se traduire par l'abandon du désir; et le récit, d'une certaine manière, peut se lire aussi comme le passage de toutes sortes de culture, dans tous le sens du terme, à une multiplication, précisément, du bœuf: Emma devient de plus en plus Bovary, et ce nom qu'elle rejette lui colle de plus en plus à la peau. Alors, votre travail sur Bovary pourrait amorcer une mise en place d'une structure générale des noms dans le roman[16].
Puis Roger Bismut:
À propos de la dernière partie de la communication de Jean Ricardou, je voudrais apporter quelques confirmations. Lorsque Charles est étudiant, sa mère lui envoie par la diligence du veau au four; du veau à la casserole est servi au repas de noces; lorsque Emma et son mari reviennent de la Vaubyessard, c'est du veau à l'oseille qu'on leur offre. Cette espèce de vitellisation domine dans les comices agricoles. Le maire d'Yonville s'appelle Tuvache et Léon épousera Mademoiselle Lebœuf. J'ajoute que le peintre qui accompagne Charles pour le choix du tombeau s'appelle Vaufrylard. Et Claudine Gothot-Mersch fait remarquer dans son édition que Flaubert avait reçu ce surnom, de sorte qu'il y a là une sorte de réverbération du veau sur Flaubert lui-même.[17]
Cette fois, tout, ou à peu près, est dit ou au moins suggéré, sur le fond comme pour la forme. Il suffisait de poursuivre sur cette voie tracée à plusieurs, dans le feu de l'improvisation collective, et le veau de Charles aurait trouvé sa juste place dans la critique flaubertienne, aux côtés du cochon d'Antoine et du perroquet de Félicité. Mais il n'en a rien été. À vrai dire, dès le colloque de 1974, un détail pouvait déjà susciter des inquiétudes. Alain Goulet et Roger Bismut, respectivement spécialistes d'André Gide et de Camoens, étaient hommes de bonne volonté et d'intelligence critique, mais non pas flaubertiens patentés. En revanche, Claude Duchet et Philippe Hamon, qui pouvaient incarner en la circonstance une certaine doxa dix-neuviémiste, s'en tiennent prudemment à des considérations théoriques sur la modélisation linguistique proposée par Ricardou, mais choisissent d'ignorer les hypothèses interprétatives concrètes de Ricardou, sans dire s'ils les estiment nulles et non avenues, ou seulement secondaires. D'autres, comme Claudine Gothot-Mersch et Maurice Delcroix, s'en prennent à la décomposition anagrammatique de BOVARY, dans la description de la casquette, mais négligent à peu près totalement le veau.
Le silence était donc presque immédiatement retombé sur le «nou(s)-veau» de l'incipit, et, d'année en année, hormis quelques allusions obligées et épisodiques à l'hypothèse de Ricardou[18], il deviendra de plus en plus épais, même chez les chercheurs flaubertiens que taraude cette question de l'animalité. En 2010, l'excellente Revue Flaubert, revue électronique hébergée sur le site de l'université de Rouen, publie un riche et suggestif dossier sur «Animal et animalité chez Flaubert[19]». Trois articles au moins, dont j'ai tiré le plus grand profit, croisent assez directement mes préoccupations: ceux de Didier Philippot («Le rêve des bêtes: Flaubert et l'animalité»), Yvan Leclerc («les “animalités de l'homme”-plume»), Jacques Berchtold («Figures de l'auteur en bêtes: autoréflexivité dans Madame Bovary»). Nulle part, pourtant, même dans ce dernier, trace de mon veau embourgeoisé. Ce silence, en tant que tel, mérite qu'on y médite.
Deux explications viennent d'abord à l'esprit, faisant de Ricardou tour à tour une victime et un coupable. Victime: Ricardou, ancien instituteur, écrivain-théoricien, auteur de la célèbre revue Tel Quel, n'est pas un universitaire. Fondateur de la «textique» et l'un des animateurs du centre de Cerisy-la-Salle, il n'en reste pas moins un marginal par rapport aux institutions officielles de la recherche. En France encore plus qu'ailleurs, la marginalité institutionnelle se paie presque toujours: il n'est pas besoin d'avoir lu Bourdieu pour s'en rendre compte (mais cela aide à le comprendre). Coupable: Le «nou-veau» qui, qu'on y croie ou non, a une incontestable apparence d'évidence, vient après des considérations anagrammatiques beaucoup plus hasardeuses. On en est encore, dans les années soixante-dix, à se passionner pour les travaux sur les anagrammes de Saussure[20], à rechercher les moindres traces grammatiques de tous les mots possibles, et des noms propres en particulier: le goût pour les jeux sur le signifiant de la psychanalyse lacanienne, alors très en vogue, contribuait à l'emballement de l'imaginaire linguistique. Sans rouvrir ce débat, on doit admettre que, aujourd'hui, on s'en tient prudemment à des anagrammes plus concentrées, sur un ou deux mots, et qu'on ne se contente plus, pour inférer l'existence d'une anagramme, d'aller à la pêche aux lettres dans une phrase voire dans un paragraphe entier.
Ricardou a eu le tort d'adosser une hypothèse dotée d'un taux de probabilité élevé à une interprétation fragile. C'est une tactique constante, dans un débat contradictoire: l'adversaire disqualifie la thèse faible, en laissant entendre que son effondrement doit automatiquement entraîner avec elle la plus forte. C'est pourquoi, par exemple, j'ai renoncé à évoquer, lorsque j'ai passé en revue, dans le chapitre précédent, les références aux bovins dans Madame Bovary, les plats cuisinés à base de veau auxquels fait allusion Roger Bismut: quoi que j'en aie pensé personnellement, j'ai craint que ces motifs gastronomiques, risquant de paraître moins convaincants, n'affaiblissent l'ensemble de la démonstration.
On pourrait d'ailleurs formuler la même réserve à l'encontre d'un livre par ailleurs remarquable que j'ai déjà cité à plusieurs reprises et qu'il faut maintenant commenter plus longuement, La Scène originaire de «Madame Bovary» de Francisco González. Cet ouvrage constitue en effet à lui seul une véritable somme herméneutique sur l'incipit flaubertien. Il ne se contente pas d'offrir un panorama raisonné de la critique à peu près complet – au moins jusqu'en 1999; il suit aussi toutes les pistes interprétatives imaginables: la génétique, la poétique narrative, la linguistique énonciative, la psychanalyse, l'analyse lexicologique et phonologique, etc.; surtout, il revient de façon très détaillée sur la thèse de Ricardou, qu'il reprend à son compte, pour l'essentiel. Sur bien des points, il aboutit donc à des conclusions très proches des miennes: en particulier, sur l'évolution du texte manuscrit, le recours au calembour, la récurrence significative des «nous» et des «nouveau», sans parler des multiples phénomènes repérés au fil du roman. Mais González s'intéresse à une tout autre piste qu'à mon «veau»: au «nous», où il voit l'indice de l'aspiration flaubertienne à un «nous» heureux et empathique. Au demeurant, les deux hypothèses ne sont pas contradictoires, loin s'en faut, et je me réjouis d'autant plus de cette convergence qu'il s'agit d'une rencontre, non d'une influence. La Scène originaire de «Madame Bovary», rarement signalé dans les bibliographies, est en effet absent de la quasi-totalité des bibliothèques françaises. Je ne suis donc pas loin de voir dans cette relégation un nouvel effet malheureux de la «malédiction du veau». Cependant, avouons que, en accumulant les rapprochements les plus inattendus tout au long de son travail (par exemple, avec le baroque, l'onirisme, le diabolisme, la commedia dell'arte, l'évolutionnisme, l'opéra), González semble happer Madame Bovary dans une spirale métamorphique à quoi s'ajoute une dérive proprement roussélienne où la lettre même du roman disparaît derrière tous les énoncés fantomatiques qu'elle paraît évoquer et où le jeu sur le «nous» et le «nouveau» est enfoui sous la masse des inférences et des associations, très suggestives mais forcément hasardeuses, dont il est entouré. Si bien que le lecteur, obligé de se laisser guider dans le dédale des rapprochements ou de se démettre, risque bien à tort de choisir la solution la plus paresseuse, et de faire comme si aucun bénéfice herméneutique n'avait été effectivement et définitivement obtenu. Je repars donc aujourd'hui à l'offensive, mais à mon propre compte, avec mes seules armes, et un objectif unique: le veau.
Car le silence de la critique ne s'explique pas seulement par une maladresse argumentative, d'ailleurs parfaitement volontaire et assumée par Ricardou lui-même, puisque la cause était en réalité entendue d'avance. En effet, dès 1972, Claude Duchet avait envisagé la présence du veau dans l'incipit, pour l'écarter aussitôt. Or, il s'agit là d'un événement d'une grande portée symbolique, puisque cet ostracisme du veau intervient, non dans un texte mineur, mais dans l'article fondateur de la sociocritique, paru dans le premier numéro de la revue Littérature et intitulé: «Pour une socio-critique, ou variations sur un incipit[21]». Duchet y présente sa méthode critique, fondée sur l'analyse des modes d'inscription du social dans le texte, grâce au repérage des emprunts, des reprises d'éléments cotextuels dans le corps même du texte, et des effets de sens induits par ce déplacement du cotexte dans le cadre de la fiction. Puis il applique sa proposition théorique à l'incipit de Madame Bovary:
L'incipit de Madame Bovary s'installe dans la massive évidence d'un être-là. L'écriture réaliste énonce l'innommable, donne forme de nécessité à l'arbitraire, fait coïncider le sujet linguistique et le sujet textuel, fonde le vraisemblable sur la mise en scène du progrès d'énonciation: ici le nous initial, figure rhétorique du «point de vue». En fait, il s'agit d'un leurre: ce nous médiatise le référent et le transforme en espace-temps piégé, puisque déjà vécu par un être textuel. De plus, et surtout, si la mimésis du réel tend à évider l'écran des mots et s'inscrit dans un schéma narratif préformé. Ici, l'énoncé se trouve réglé par une structure métonymique ([élèves] ––> étude–> étude–> proviseur–> nouveau–> garçon de classe–> pupitre) qui repose sur une “archive”, le sujet scolaire: décrivez l'arrivée d'un nouveau dans votre classe.[22]
J'ai déjà évoqué cette thèse, qu'on peut très grossièrement résumer ainsi: le «nous» serait un leurre, servant à intégrer le nouveau dans l'espace socialement déterminé du collège, dont le «nous» n'est que le truchement linguistique; la convention réaliste est donc sauve. Un peu plus loin, Duchet suggère encore: «Dans une chronologie “réelle”, le “Nous” est antérieur au “nouveau”, qu'il engendre peut-être, textuellement». Mais il ajoute alors une note, formulant un doute incident: «Ou l'inverse»; on a vu, en effet, que le «nous» initial était sans doute né du «nouveau». Puis il continue sa note: «J'entends certains: “Que faites-vous du veau?” Faut-il les renvoyer aux comices? En fait, je veux seulement dire qu'un texte suppose, parmi ses conditions de production, un minimum de cohérence spécifique. Ainsi les bleus d'un vitrail, quels qu'en soient les figures ou le motif[23]». Claude Duchet avait donc bien le veau en tête, mais il avait décidé de l'en expulser. On aimerait d'ailleurs pouvoir interpréter au plus juste le «j'entends certains». A-t-il eu lui-même l'idée du veau, qu'il reporte par dialogisme rhétorique sur un «certains» imaginaire? Ou quelqu'un lui a-t-il réellement suggéré le calembour possible? En ce cas, l'effacement de son nom reproduit de façon très symbolique le rejet du calembour lui-même. Quant au calembour, que Duchet a pourtant l'excellente idée de lier à la scène des comices, il est écarté, d'une seule phrase, au nom de la cohérence idéo- ou socio-logique du texte: que viendrait faire un veau, dans cette histoire de mœurs (petites-)bourgeoises? Pour se justifier, Duchet introduit alors une étrange comparaison, qui ne laisse pas d'interloquer. Il en est, dit-il, comme du bleu des vitraux d'église. Si le bleu mérite de retenir l'attention, c'est parce que, je suppose, il renvoie au bleu du ciel divin et qu'il est donc conforme avec le lieu où il se situe (une église). Mais si le vitrail avait par extraordinaire une tache marron, orange, ou de je ne sais quel autre couleur qu'on jugerait déplacée, il ne faudrait donc pas la voir? Chez Flaubert, un veau a scandaleusement fait irruption dans une salle de classe, créant une situation d'une insupportable anomie: ignorons-le, il finira bien par sortir.
Revenons à Cerisy. Il fallait se débarrasser du veau. Ce ne sera pas Claude Duchet qui se chargera de la besogne – il l'avait déjà fait pour son propre compte deux ans auparavant –, mais Françoise Gaillard, d'ailleurs avec beaucoup de brio. Si jeu de mots il y a, et elle veut bien admettre que l'hypothèse est séduisante, il faut savoir qui a fixé la règle du jeu, et dans quelle intention. Or, pour sa part, elle ne voit que deux théories du sujet possibles dans un cas de ce genre: la psychanalyse, qui pourrait l'expliquer par l'inconscient, ou l'interprétation sociocritique, qui repère le travail de l'idéologie. Dans cette histoire d'anagramme, il lui manque donc ce qui, selon elle, importe le plus, le sens de la manœuvre linguistique. Elle conclut, s'adressant à Ricardou:
En vous écoutant, j'étais à la fois fascinée par ce travail extrêmement brillant et convaincant à beaucoup de niveaux, et tout à fait gênée par cette lacune importante qui est celle de la signification […].[24]
Françoise Gaillard a parfaitement raison de formuler sa gêne et sa déception. La question du sens est capitale, et j'ai déjà souligné la pauvreté de l'interprétation suggérée par Ricardou. Mais pouvait-il refuser de voir le calembour, au nom de l'orthodoxie herméneutique? «Et pourtant elle tourne!», avait simplement rétorqué Galilée, dans des circonstances analogues. Ricardou, lui, contre-attaque, et retourne à l'envoyeur l'accusation d'idéalisme que, au nom du freudisme et du marxisme réunis, lui avait lancée Françoise Gaillard – accusation gravissime, dans un débat mené entre matérialistes convaincus. Lui non plus n'a pas tort d'objecter alors que le pire des idéalismes – ou des dogmatismes, serait-il plus juste de dire – consiste encore à nier une réalité, sous le seul prétexte qu'on ne saurait pas bien quel sens lui donner:
Ce qui est idéaliste […], ce sont les conceptions qui placent le sens, sous un avatar ou un autre, en position première et causale par rapport au jeu des signifiants[25].
Le débat s'interrompt rapidement après cette confrontation; il ne sera jamais repris[26]. Mais il fallait le citer longuement parce qu'il fait apparaître, au travers même de ses malentendus et de ses silences, un désaccord fondamental. Le jeu de mots repéré par Ricardou séduit et on ne lui oppose pas de réfutation réellement déterminante. Pourtant, sans que personne ne l'avoue clairement, on devine qu'il contient un ingrédient inacceptable, définitivement inassimilable; on sent qu'il enfreint les règles non écrites de ce qu'on pourrait appeler l'herméneutiquement correct, et qu'aucune explication n'y aurait rien fait. C'est pourquoi, cette fois, il faut aller au bout des raisons de ce blocage – j'en verrai deux – pour espérer ressusciter, un peu plus longtemps que le temps d'un livre, le veau de Flaubert.
III. LE BOVARYSME DE L'HERMÉNEUTE
En réalité, Ricardou a commis le crime absolu en matière de critique littéraire: trouver une clé au texte, le «résoudre» de manière simple et définitive, clore le travail interprétatif – pire, l'escamoter, puisque Ricardou ne propose pas une «lecture» du texte, mais veut en passer simplement par le travail supposé de l'auteur, pour expliquer la forme définitive qui est donnée à lire au public. Or les critiques, que sont par fonction les spécialistes de littérature, ont une aversion naturelle et irrépréssible pour toutes les hypothèses qui viendraient arrêter le processus herméneutique et offrir le moyen – commode, tangible, disponible – de défaire les nœuds d'obscurité textuelle. L'incipit de Madame Bovary cacherait donc un veau? Que faire de l'extraordinaire profusion d'interprétations provoquée par le «nous» initial? Faut-il fermer le ban? Et comment s'y résigner?
Il est beaucoup plus facile de ne rien dire ni faire. Le veau de Flaubert deviendra celui de Ricardou, qui avait bien d'autres chats à fouetter. Et on finira par ne plus y penser, puis par perdre la trace de son existence. L'histoire de la glose littéraire a ainsi ses placards (et ses notes, éparpillées dans la masse des publications savantes) remplis de cadavres oubliés, de pistes esquissées, d'éclaircissements aperçus, mais sur lesquels on a préféré ne pas faire fond, parce qu'ils risquaient de réduire l'espace du jeu herméneutique. C'est ce que je propose de nommer le «bovarysme de l'herméneute». Pour Jules de Gaultier, le bovarysme est un mal dont sont accablés non seulement les lectrices de mauvais romans sentimentaux, mais surtout, dans notre civilisation obsédée par le désir de connaître et de comprendre, tout homme qui «se conçoit propre à atterrir en des régions qui lui demeurent inaccessibles, à posséder un savoir qu'il ne conquiert jamais[27]». C'est le mal dont souffrent en particulier saint Antoine, Bouvard et Pécuchet, Gustave lui-même sans doute. Mais c'est un mal consenti et masochiste: les hommes jouissent de chercher à acquérir des connaissances qui sont hors de leur portée, et ils en jouissent d'autant plus qu'ils les croient hors de leur portée. La critique littéraire est la plus voluptueuse des activités de l'esprit, puisqu'elle est virtuellement infinie: malheur à qui veut, même avec les meilleures intentions du monde, hâter la satisfaction du plaisir.
Pour ne pas multiplier les exemples et pour ne pas aller les rechercher dans un passé trop lointain, qu'il me soit ici permis d'évoquer une péripétie de ma propre vie d'herméneute. Naguère – en 1997, déjà –, il m'est arrivé, pour des raisons sur lesquelles il est inutile de revenir, de compter le nombre des chapitres dans Les Misérables. Car le roman de Victor Hugo se présente comme une énorme masse textuelle, bavarde, fragmentée et apparemment anarchique, seulement hiérarchisée en parties, en livres et en chapitres, dont le nombre semble défier tout effort de synthèse: le roman comporte cinq parties, comprenant elles-mêmes de huit à quinze livres comportant chacun de un à vingt-quatre chapitres. Chaque chapitre est usuellement désigné par les numéros de la partie, du livre dans la partie, du chapitre dans le livre: le chapitre I, 3, 2 est par exemple le deuxième chapitre du troisième livre de la première partie. Mais, si l'on choisit, par hasard ou par curiosité arithmétique, d'ignorer cette numérotation à trois niveaux, on constate que les cinq parties de l'œuvre réunissent respectivement 70, 76, 76, 76 et 67 chapitres, soit un total de 365 chapitres. Comme pour le veau de Flaubert, je n'étais pas tout à fait le premier à faire l'addition; mais, ici comme là, Françoise Gaillard a bien raison, encore faut-il comprendre le sens du jeu.
Or, 365 chapitres, c'est-à-dire exactement autant de chapitres que de jours dans une année non bissextile: la coïncidence est trop improbable pour être raisonnablement attribuée au hasard. Il est impossible, de bonne foi, de ne pas supposer ici un cas d'hermétisme numérique, plus précisément un code calendaire: le premier chapitre correspondrait au 1er janvier, le deuxième au 2 janvier, et ainsi de suite jusqu'au dernier, qui jouerait le rôle du 31 décembre. Passons également sur les différentes étapes de ma recherche, à toutes les hypothèses que j'ai dû examiner avant d'en arriver à ce qui, selon toute probabilité, est l'explication du code. Il me faut donner cependant un dernière précision, capitale: le découpage en chapitres a été effectué à la fin du travail d'écriture, si bien que Hugo avait toute latitude de répartir la masse textuelle (voire de la modifier) en fonction des nécessités du codage. Voici maintenant la solution de l'énigme. Victor Hugo a consigné, par ce système calendaire, les dates qu'ils jugent essentielles: celles-ci correspondent à des chapitres significatifs du roman, avec lesquels elles entretiennent un rapport d'analogie. L'examen de trois cas particulièrement remarquables suffira à montrer, je l'espère, la validité de l'hypothèse calendaire.
Le chapitre IV, 5, 5 («Cosette entre en rêverie») est celui où Marius, qui a retrouvé rue Plumet la trace de Cosette, lui laisse sous une pierre un manuscrit censé exprimer son amour. Or, cette lettre est très bizarrement remplie d'allusions à la mort et à l'au-delà; elle a d' ailleurs déjà été mentionnée dans le chapitre précédent, intitulé «Un cœur sous une pierre» – le cœur sous la pierre évoquant irrésistiblement l'image de la pierre tombale. Justement, le IV, 5, 5 correspond selon le code calendaire au 4 septembre, c'est-à-dire à la mort de Léopoldine. Si Marius emprunte très évidemment bien des traits à Hugo jeune, le cryptage calendaire prouve que Cosette est aussi un double de Léopoldine, le roman dissimulant l'idée d'un amour virtuellement incestueux entre le père et la fille.
Quant au célèbre chapitre «Une tempête sous un crâne», il correspond au moment où Jean Valjean alias M. Madeleine, devenu un notable respectable comme le Hugo embourgeoisé de la monarchie de Juillet, décide de quitter le confort de sa vie pour sauver celle de Champmathieu, un autre forçat arrêté à sa place. Après une nuit tempétueuse d'hésitation, Jean Valjean fait le sacrifice de sa position sociale, si durement conquise, et choisit de se dénoncer. Ce chapitre symbolise la vraie naissance de la conscience morale chez l'ancien forçat, et les images du texte prennent soin de souligner cette allégorie enfantine: ainsi est-il écrit que l'ancien forçat «marchait comme un petit enfant qu'on laisse aller seul». Or, «Une tempête sous un crâne», est le chapitre I, 7, 3, soit le cinquante-septième, ou encore, dans l'ordre du calendrier, le 26 février, jour de naissance de Victor Hugo.
Mais il faut parler un peu plus longuement d'un dernier cas d'hermétisme calendaire dans Les Misérables, de loin le plus important parce que, au-delà des allusions autobiographiques, il donne cette fois accès à la clé d'interprétation du roman lui-même, considéré dans sa globalité. On pouvait en effet légitimement s'étonner que, dans ce roman écrit pendant le temps de l'exil consacré à combattre Napoléon III, il n'y ait aucune allusion à l'Empire ni à l'ennemi détesté: même si l'intrigue s'arrête en 1833, quelques allusions n'auraient posé aucune difficulté et cette apparente abstention est peu conciliable avec le caractère testamentaire que Hugo a voulu donner à son œuvre. En réalité, Napoléon III est bien présent, à condition de passer par le code calendaire. En effet, après la prise de la barricade de la rue de la Chanvrerie, Jean Valjean sauve Marius en passant par les égouts de Paris, dans le chapitre V, 3, 8 («Le pan de l'habit déchiré»). Dans l'imaginaire hugolien, l'égout, réceptacle d'immondices enfouies sous la ville, figure le résidu matériel qui résiste au mouvement idéal du progrès historique. L'égout est la face négative et corrompue de l'humanité. En chemin, l'ancien bagnard croise Thénardier, qui a fait de l'égout son gagne-pain et qui le rançonne: contre quelques pièces, il ouvre la grille à Valjean, qui s'échappe du sous-sol parisien. Or ce chapitre V, 3, 8 est aussi le trois cent trente-sixième, soit, selon le code calendaire, le 2 décembre, le jour du coup d'État. Le cryptage permet d'accéder à l'allégorie politique que dissimulait le roman. L'égout est la société bourgeoise du Second Empire, immobile et compromise. Quant à Thénardier, il représente Napoléon III: l'un et l'autre revendiquent l'héritage héroïque du Premier Empire, dont ils ne sont que les spoliateurs, symbolisant, engloutis dans le cloaque de l'égout, la tyrannie de la matière ténébreuse. Du même coup, le décodage de l'hermétisme numérique éclaire le dénouement. On pouvait s'étonner que, après le geste magnifique de Jean Valjean, le roman s'achève par une médiocre histoire de jeune bourgeois borné, mettant à la porte son bagnard de beau-père après avoir joué au révolutionnaire exalté. Mais c'est que Jean Valjean est Victor Hugo, et Marius l'incarnation de la bourgeoisie libérale qui a pris son parti de l'Empire. Le jeune marié finit d'ailleurs par découvrir le désintéressement de Jean Valjean et la vraie nature de Thénardier: de même, la bourgeoisie libérale et républicaine – c'est du moins la prophétie implicite contenue dans le roman – se débarrassera de Napoléon III, grâce au dévouement reconnu de Valjean/Hugo, qui est investi in fine d'un rôle à la fois sacrificiel et politique.
Enfin, le plus extraordinaire n'est peut-être pas ce que cache le roman, mais, pour elle-même, la décision littéraire qu'a prise son auteur de le cacher, de ne pas textualiser son secret et de n'en laisser aucun indice écrit. Pourtant, le travail final de découpage des chapitres a dû être complexe et délicat; il est impossible qu'il n'ait pas donné lieu à des calculs, des hésitations, des réaménagements. Il n'existe pourtant, dans la masse des manuscrits conservés et transmis avec tant de soin par Hugo, aucun indice du travail de cryptage, dont toutes les traces ont dû être systématiquement effacées, comme si Hugo voulait garder la signification du code pour lui-même, sans perturber la lecture même du roman, tel qu'il est offert au public, en toute lisibilité.
Laissons les détails: c'est la question de l'herméneutique, non le cas de Hugo ni le mien, qui importe ici. Mais on peut tenir pour acquis d'un part que l'existence du code calendaire a, pour le moins, une très forte probabilité – asymptotiquement proche, comme dirait Balzac, de la certitude –, d'autre part que l'explication que j'en proposais était à la fois simple (dénuée de toute contorsion interprétative ou sollicitation excessive des faits) et d'une incontestable productivité. J'ai donc publié mon «invention du code calendaire» en 1997, et mon principal étonnement fut, comme pour le veau de Ricardou (disons ainsi, provisoirement), la fin de non recevoir de la critique hugolienne. J'ai régulièrement republié ma trouvaille à l'occasion de divers travaux, avec une obstination non dénuée de malice: en 2002, 2007, 2010[28]. Toujours en suscitant, auprès des divers publics où je la présentais aussi dans mes conférences, une curiosité d'abord étonnée (devant l'énormité de la révélation), puis intriguée (par sa quasi-clandestinité) et globalement approbative (au vu des preuves présentées par quelqu'un d'apparemment sensé et sain d'esprit). Mais la fait est que, à ma connaissance, l'hypothèse n'a jamais été relayée par aucune publication spécifiquement hugolienne, ne serait-ce que pour y être discutée: je ne doute pas que cette stratégie du silence ne finisse par être gagnante: en critique littéraire, du fait même de la masse toujours croissante de travaux, la diffusion de l'information bibliographique fonctionne de plus en plus à l'intérieur des réseaux constitués par les spécialistes de chaque auteur du canon.
Dans son édition magistrale du roman au Livre de poche, en 1998, Guy Rosa, évoquant les «références autobiographiques», se contentait de juger dans ses notes générales, à mon endroit ou à celui de tout autre: «On se gardera donc devant ces allusions, moins secrètes que discrètes et nullement cryptées, de céder à la tentation herméneutique: Hugo ne cache rien, aucun trésor dont il serait seul possesseur et que le critique-biographe viendrait lui ravir[29]». Il y a là un argument très consistant, qu'on peut traduire ainsi: nous, lecteurs, n'avons pas à nous préoccuper des intentions de l'auteur, des message cryptés qu'il aurait inclus dans son œuvre; l'auteur ne nous concerne pas, ne nous intéresse pas; seul compte ce qui est lisible. Peu importe, à la limite, l'existence du code calendaire chez Hugo, ou du calembour sur le veau dans Madame Bovary; et cela importe d'autant moins qu'on n'a pas besoin d'en faire l'hypothèse pour aboutir aux mêmes interprétations, en s'appuyant sur les seules données textuelles et en décidant, une fois pour toutes, de se passer de la présence encombrante de l'auteur et de ses supposées manœuvres secrètes.
L'argument, si souvent ressassé, révèle un malentendu épistémologique et méthodologique très profond qu'il faut dissiper avant de continuer. Passons sur le coup de force que représente le critère de la lisibilité – au fond, c'était celui que Claude Duchet opposait déjà au veau, en 1972. Car c'est bien dans le texte que Ricardou et moi avons vu un veau dans l'incipit de Madame Bovary, et que j'ai compté 365 chapitres dans Les Misérables; c'est à partir du texte que nous avons, l'un et l'autre, fait l'hypothèse d'un processus d'écriture à l'œuvre en amont du livre publié. Ricardou précise même qu'il peut très bien arriver que ce processus soit interne au texte, aux mécanismes immanents qui déterminent sa production, sans qu'il faille faire l'hypothèse d'une intention auctoriale[30]: je ne le suivrais pas tout à fait sur cette voie, du moins pour le calembour veau/nouveau, cependant sa réfutation méritait d'être entendue. Dans tous les cas, qui a l'autorité pour décider que ce que je vois dans un texte n'y est pas, sous le prétexte que je serais le seul à le voir?
Il y a beaucoup plus grave, qui porte sur la nature des enjeux proprement théoriques qui sont en question ici. En effet, lorsque j'avance que le couple veau-nouveau naît d'un calembour (je dirai désormais «je», pour ne pas compromettre davantage Jean Ricardou), je ne prétends évidemment pas que la signification de l'incipit, pour le lecteur, est contenue tout entière dans ce jeu de mots – et encore moins que celle des Misérables découle d'un mécanisme calendaire qui n'est jamais verbalisé et qui est postérieur à la rédaction du roman dans ses grandes masses. Ce serait absurde: il est de bonne guerre, mais de mauvaise camaraderie, de laisser croire que son contradicteur est plus stupide qu'il n'est. Mon problème est de poétique, non d'herméneutique; il porte sur le processus de fabrication de l'œuvre et non sur sa lecture ni sur son interprétation – même si on peut supposer que le mode de fabrication peut influer, jusqu'à un certain point (mais lequel?) sur la signification. Mon hypothèse se limite à ceci: je défends l'idée que Flaubert, en associant de façon ostentatoire et répétée un nouveau italiqué à un «nous» formellement aberrant, a voulu textualiser et exploiter fictionnellement le calembour nous-veau; que Hugo, en choisissant de diviser Les Misérables en 365 chapitres, a utilisé un code calendaire dont il a fait un usage cryptique. Mais je ne veux bien sûr pas imposer au lecteur les significations que j'en infère, même si je me réserve le droit de penser, par-devers moi, qu'elles valent autant que d'autres – voire davantage, peut-être.
Nous avons affaire en réalité à deux conceptions de l'étude des textes littéraires, qui sont complémentaires si on veut bien ne pas s'épuiser inutilement à les opposer, car l'une et l'autre ont leur utilité. La première, que j'appellerai de sémiotique littéraire, traite le texte littéraire comme un système de signes, totalement disponible pour les libres processus interprétatifs mis en œuvre par le lecteur. Un texte vaut alors pour ce qu'il signifie, pour l'inventivité herméneutique qu'il suscite chez tout un chacun. Cette sémiotique implique bien «la mort de l'auteur» – disons son congédiement, pour éviter de dramatiser inutilement – afin qu'il ne vienne pas s'interposer entre le texte et son lecteur. La deuxième est la poétique historique[31], ici appliquée à une œuvre ou un auteur singuliers. Elle consiste à considérer la littérature comme un art – défini dans les termes les plus neutres, précisément comme un art d'écrire –: et cet art, comme tous les arts, implique des processus concrets de fabrication, des mécanismes de production que l'analyse doit essayer de mettre au jour. De façon générale, la poétique historique vise à rendre compte des transformations des formes de l'écriture littéraire, en prenant en compte l'ensemble des données historiques. Appliquée à une œuvre, elle s'attache à repérer la dynamique créatrice qui lui est propre: la poétique historique devient alors génétique historique, qu'elle dispose ou non des avant-textes de l'œuvre. Elle peut et doit s'appuyer sur les traces du travail de composition, particulièrement visibles dans la répartition des masses, les structures formelles, les procédés d'ouverture ou de fermeture, le choix des noms propres, les jeux de mots, etc. Bien sûr, tous ces éléments ont des implications interprétatives; mais ils sont d'abord des matériaux artistiques, mis en œuvre, consciemment ou non, par un auteur, et dotés d'une réalité objective dont l'historien de la littérature peut légitimement tenir compte. J'ajoute encore, sur ce dernier point, que, avant d'en venir à des hypothèses sur les processus inconscients de l'auteur, il me paraît de bonne méthode d'épuiser d'abord ce que peuvent nous apprendre les actes volontaires de l'écrivain, qui résultent de ses choix assumés d'auteur et que manifestent une multitude d'indices à la surface des textes, pour qui veut bien les observer.
Enfin, l'objection ordinaire faite au veau de Flaubert ou aux 365 chapitres de Hugo (leur invisibilité au regard de la lecture) pose une ultime question, celle du statut de la recherche littéraire, du moins lorsqu'elle est appliquée à une œuvre singulière – car le mieux est qu'elle s'exempte le plus souvent possible de son obsession monographique, mais c'est un autre problème –: s'agit-il de critique ou d'histoire[32]? Le critique, si on entend par ce mot une sorte de lecteur professionnel, c'est-à-dire un interprète des signes, n'a pas à croiser sur sa route la question de l'auteur; lorsqu'il songe à l'auteur, c'est d'ailleurs toujours par ricochet de ses impressions de lecture et en fonction de ses a priori psychologiques, donc de façon doublement arbitraire. Pour un historien, au contraire, les représentations, dont font partie les textes littéraires, ne sont pas séparables des pratiques concrètes dont elles découlent; les unes et les autres impliquent en outre l'intervention d'instances et d'agents spécifiques, dont il lui revient de décrire le plus exactement possible les modes d'action. L'auteur est l'un de ces agents, assurément le plus déterminant, au niveau d'une œuvre singulière. Le problème de l'historien n'est pas de remettre indéfiniment en cause la présence d'un calembour ou d'un code calendaire, une fois qu'il les a dûment constatés, mais de s'interroger, en termes de poétique et non de psychologie individuelle, sur la signification historique de cette présence. Dans un article ancien consacré à l'histoire littéraire, Roland Barthes concluait que l'historien de la littérature en finissait toujours, lorsqu'il en venait à une œuvre particulière, par faire des hypothèses sur son auteur[33]. C'est sans doute vrai. Mais il faut alors ajouter que l'historien, en se saisissant de la catégorie d'auteur, ne doit le faire qu'en l'inscrivant pleinement dans le champ de l'histoire, qu'il s'agisse d'histoire sociale, de sociologie historique, d'histoire culturelle ou enfin, au plus près des textes, de poétique historique: c'est pourquoi l'historien est, parmi tous les spécialistes de littérature, le seul qui ait toute légitimité pour parler de l'auteur. Ce qui ne signifie pas qu'il doive en abuser, car d'autres tâches l'attendent: l'étude des textes et des auteurs du canon est assurément la plus gratifiante – un chef-d'œuvre reste un chef-d'œuvre –, mais il n'est pas sûr que ce soit, pour le progrès des connaissances littéraires, la plus utile.
IV. IRONIE VS CALEMBOUR
Il y a pire que ces polémiques sur l'herméneutique littéraire. Dans sa bête naïveté, le veau bovaryen a commis un crime d'une extrême gravité, qui suffit à expliquer toutes ses avanies. Son existence seule, au cœur du nouveau, fait soupçonner que Flaubert a choisi de figurer toute la philosophie de Madame Bovary, du roman emblématique du réalisme français, au moyen d'un simple calembour. Et quel calembour! Une plaisanterie digne de l'almanach Vermot ou des blagues Carambar! Il y aurait là un pied-de-nez si radical, si irrécupérable à l'égard de toute apparence de respectabilité – à commencer par celle de ses commentateurs – qu'on ne veut même pas y songer. Le calembour, on le sait, consiste à produire un énoncé nouveau à partir du signifiant d'un premier énoncé – concrètement, en regroupant les syllabes de manière à créer des mots le plus inattendus –: telle cette réjouissante formule, attribuée à Ponson du Terrail, un contemporain de Flaubert: «En voyant le lit vide, il le devint». Le calembour est de la famille des manipulations ludiques pratiquées par les jeunes enfants qui commencent seulement à maîtriser le langage et s'émerveillent encore de ses possibilités plastiques (à-peu-près, mots tordus, charades…). Pour cette raison, dans la hiérarchie des procédés comiques, il est considéré comme la forme la plus dévaluée: digne des cours de récréation, des propos de comptoir, à la rigueur des pratiques accrocheuses des journalistes; mais, de là à accepter l'idée que Flaubert, l'ermite de Croisset, ait pu compromettre son grand œuvre, et dès la première phrase, par un telle pitrerie, il y a un pas qu'on se garde bien de franchir.
Non que Flaubert soit toujours sérieux. Loin de là: au contraire, on sent toujours, à fleur de texte, le sourire en coin, le regard qui frise, la distanciation et le second degré dévastateur. Mais on préfère alors parler d'ironie, et d'ironie seulement. Bien sûr, il y a de l'ironie chez Flaubert, et une ironie qui fait corps avec son parti pris d'impersonnalité. Mais cette ironie, du moins telle qu'on l'entend habituellement (j'en proposerai au chapitre VI une autre interprétation), a essentiellement une fonction prophylactique; elle débarrasse par avance des illusions fallacieuses, des idéologies nocives, des opinions absurdes, de toutes les médiocrités, pour s'abandonner à la jouissance d'être au monde, malgré tout. C'est d'ailleurs exactement la tâche que le jeune Flaubert de 1845 assignait, non pas à l'ironie, mais à la parodie:
Il [Jules, l'un des deux protagonistes] porta dans les arts l'habitude, qu'il avait contractée dans l'étude du monde et insensiblement dans l'analyse de lui-même, de parodier ce qui lui plaisait davantage, de ravaler ce qu'il aimait le mieux, abaissant toutes les grandeurs et dénigrant toutes les beautés […] . Mais de même que le velours en lambeau est plus beau que la toile neuve, et qu'un bonnet de papier sur la tête de l'Apollon ne la dégrade pas, la parodie ne peut rien détruire de ce qui est indestructible, son couteau se casse contre les marbres impérissables […]. (OJ, p.1042)
L'ironie finit toujours par déboucher sur quelque chose de sérieux; c'est pourquoi on la tolère. Quelle élégance, d'ailleurs, dans sa moquerie voilée, dans le tact de sa méchanceté, dans l'air d'intelligence qu'elle donne à la moindre phrase! Mais le calembour? Une fois qu'on a eu la mauvaise idée de trouver le veau dans le nouveau, on ne pourra plus jamais s'empêcher de voir, non pas ce pauvre Charles mal dégrossi, mais, réellement, en peine classe, près de l'estrade, à côté du Proviseur qui semble n'avoir rien remarqué, face aux collégiens, un veau, déguisé en bourgeois, et aussi effrayé que si on l'avait conduit à l'abattoir. Toute la puissance du calembour, qui s'apparente en effet à l'émerveillement puéril, du don réservé à l'enfance de mêler sans gêne le réel et l'irréel, tient de son extraordinaire puissance métamorphique, de son pouvoir d'enchantement. Le vrai secret de Flaubert ne réside pas dans son ironie, qui est à la portée de tous les Homais d'hier et d'aujourd'hui, mais dans son goût immodéré, énorme, pour les blagues. Désormais, il ne sera plus question que de lui.
(Université Paris-Ouest)
Pages associées: Humour, Comique, Calembour, Ironie, Interprétation, Herméneutique?, Commentaire, Critique?, Bovarysme, Parodie, Auteur.
[1] Sur cette synthèse romantique de l'âme et du corps, voir Alain Vaillant, «Pour une histoire globale du romantisme», dans Dictionnaire du romantisme, A. Vaillant (dir.), Paris, CNRS éditions, 2012, p.XIII-CIX. Pour son application aux deux principales figures de la modernité, Flaubert et Baudelaire, voir Juliette Azoulay, L'Âme et le corps chez Flaubert. Une ontologie simple, thèse de doctorat de l'université de Rouen (sous la direction de Jean-Louis Cabanès et Yvan Leclerc), 2012; Alain Vaillant, Baudelaire poète comique, op. cit.
[2] Voir notamment L'Ange romantique, Gisèle Vanhèse (dir.), Figures, n°11, 1993.
[3] Honoré de Balzac, Illusions perdues, dans La Comédie humaine, P.-G. Castex (éd.), t.5, Paris, Pléiade, 1977, p.204.
[4] Voir Pierre Laforgue, L'Éros romantique. Représentations de l'amour en 1830, Grenoble, ELLUG, 1998; Frédéric Monneyron, L'Androgyne romantique. Du mythe au mythe littéraire, Grenoble, ELLUG, 1994.
[5] Voir Élisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes, Paris, Fayard, 1998; L'Animal du XIXe siècle, Actes du colloque international 2008, Paule Petitier (dir). (http://www.equipe19.univ-paris-diderot.fr/Colloque%20animal/Page%20titre%20colloque.htm).
[6] Voir Élisabeth Hardouin-Fugier, Le Peintre et l'animal en France au XIXe siècle, Paris, les Éditions de l'Amateur, 2001.
[7] Par ordre chronologique de parution: L'Oiseau (1856), L'Insecte (1857), La Mer (1861).
[8] Victor Hugo, «Réponse à un acte d'accusation» (Les Contemplations, 1, 1, VII, v.210).
[9] Victor Hugo, «Mugitusque boum» (Les Contemplations, II, V, XVII, v.35.
[10] Arthur Rimbaud, «Les Corbeaux», v.21.
[11] Id., «Les reparties de Nina», v.69-70.
[12] Voir La Production du sens chez Flaubert, Claudine Gothot-Mersch (dir.), Paris, UGE, coll. «10/18», 1975.
[13] Introduction à l'analyse du descriptif, Paris, Hachette, 1981. Mais le livre avait été précédé, il est vrai, en 1972, par un article paru dans Poétique, «Qu'est-ce qu'une description?» (n°12, 1972, p.465-485).
[14] La Production du sens chez Flaubert, op. cit., p.85.
[15] Ibid., p.101-102.
[16] Ibid., p.113.
[17] Ibid., p.113-114.
[18] Ricardou remaniera lui-même son texte dans ses Nouveaux problèmes du roman (Paris, Seuil, 1978).
[19] http://flaubert.univ-rouen.fr/revue/sommaire.php?id=10.
[20] Voir Francis Gandon, De Dangereux artifices. Saussure lecteur de Lucrèce. Les cahiers d'anagrammes consacrés au ‘De rerum natura', Louvain-Paris, Peeters, 2002; Federico Bravo, Anagrammes: sur une hypothèse de Ferdinand de Saussure, Limoges, Lambert-Lucas, 2011.
[21] Littérature, n°1, 1971, p.5-14.
[22] Ibid., p.11.
[23] Ibid., p.13.
[24] La Production du sens chez Flaubert, op. cit., p.121.
[25] Ibid., p.122.
[26] Pourtant, en 1986, Jean-Claude Lafay, dans un petit livre consacré à Madame Bovary, fera allusion au veau, dont il attribue l'idée à Claude Duchet, mais de façon seulement incidente, évoquant «une finale peu flatteuse (veau – qu'on peut rapprocher de Bovary)», d'ailleurs pour qualifier finalement Charles de «vilain petit canard» (Le Réel et la critique dans «Madame Bovary» de Flaubert, Paris, Minard, 1986, p.139).
[27] Jules de Gaultier, Le Bovarysme, op. cit., p.51.
[28] Pour mémoire: «Verba hermetica : Mallarmé, Rimbaud, Hugo», Romantisme, n°95, (1997-1), p. 81-97; L'Amour-fiction. Discours amoureux et poétique du roman moderne, Paris, Presses universitaires de Vincennes, coll. «Essais et savoirs», 2002; «Hermétisme et modernité», dans Écrire l'énigme, C. Reggiani et B. Magné (dir.), Paris, PUPS, 2007, p.23-36. L'Histoire littéraire, Paris, Colin, coll. «U», 2010.
[29] Victor Hugo, Les Misérables, Guy Rosa et Nicole Savy (éd.), Paris, Livre de Poche, 1998, p.1987.
[30] La Production du sens chez Flaubert, op. cit., p.116.
[31] Pour une présentation théorique générale de la poétique historique, telle que je la pratique, voir Alain Vaillant, L'Histoire littéraire, op. cit.
[32] Cette hésitation est déjà au cœur de l'article fondateur de Gustave Lanson, «La méthode de l'histoire littéraire», Revue du mois, n° 58, 1910, p.385-413 (repris dans Essais de méthode, de critique et d'histoire littéraire, Henri Payre (éd.), Paris, Hachette, 1965, p.31-56).
[33] Voir Roland Barthes, «Histoire ou littérature?», Annales, économies, sociétés, civilisations, n° 3, 1960, P.524-537 (repris dans Sur Racine, Paris, Points-Seuil, 1979 [1963], p.137-157).