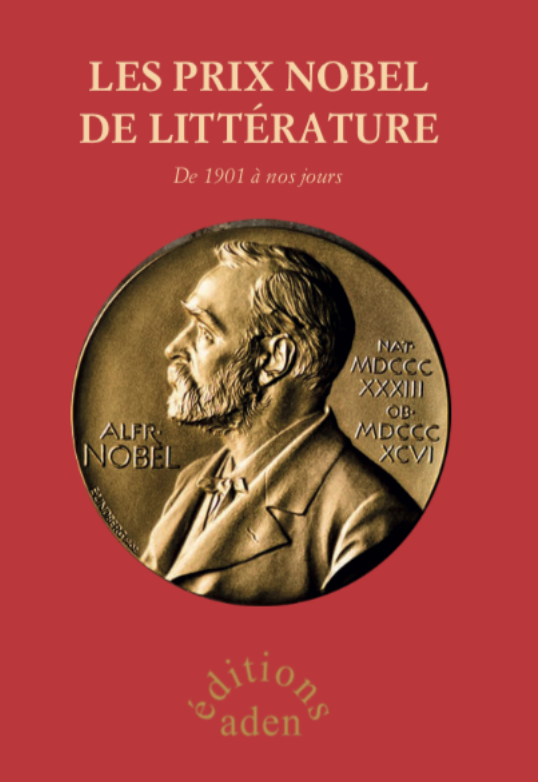
Préface : « Les littératures, à parts égales », par Olivier Penot-Lacassagne
En 1992 parut Les Prix Nobel de littérature, somme remarquable qui couvrait un siècle de consécration par l’Académie royale suédoise d’œuvres reconnues ou parfois restées dans l’ombre, sur lesquelles tombait une lumière soudaine qui en assurait la diffusion mondiale. « Le Prix Nobel est sans le moindre doute la distinction littéraire la plus prestigieuse qu’ait inventée l’Occident à l’époque moderne », écrivait Régis Boyer dans sa présentation de l’ouvrage. Ce Prix, dont il saluait la « valeur exemplaire », défendait « contre vents et marées » un monde dans lequel la littérature, si malmenée (par le marché, la censure, le divertissement industriel et cent autres périls), revendiquait le droit d’exister, de se faire entendre, d’être lue et débattue, d’être traduite et partagée. Certes, au fil du temps on n’avait pas manqué de souligner l’européocentrisme des choix des membres de cette institution, à peine corrigé par les noms d’Asturias (Guatemala, 1967), Kawabata (Japon, 1968), Neruda (Chili, 1971), Garcia Márquez (Colombie, 1982), Soyinka (Nigéria, 1986), Mahfouz (Égypte, 1988), Paz (Mexique, 1990). Certes, on avait parfois contesté avec humeur l’élection de tel lauréat, jugée incongrue, en lui opposant une liste abondante d’évincés. Comme il se doit, les habituelles querelles, partisanes ou non, les arguments spécieux ou raisonnés, les étonnements vraiment ou faussement scandalisés ont accompagnés l’histoire de ce Prix. La nobélisation inattendue de Claude Simon en 1986 en fut un exemple très commenté (celle de Bob Dylan, en 2016, ne le fut pas moins). Dans son Discours de Stockholm, l’écrivain, que l’on connaissait peu, pas ou mal, évoqua « les protestations », « l’indignation » et même « l’effroi » suscités par la décision suédoise. Certains y virent la confirmation de « la mort du roman » ; d’autres, plus fantasques, y décelèrent une emprise du « K.G.B. soviétique » sur le prestigieux comité. En France, où l’on ignorait tout ou presque de l’homme et de l’œuvre, on alla jusqu’à craindre une « catastrophe nationale ».
Mais quel que peut être l’accueil fait aux verdicts littéraires de l’Académie suédoise, ils sont toujours l’expression d’ « une certaine vie de l’esprit », indiquait Claude Simon, qu’il s’agit en tout lieu, par-delà les frontières géopolitiques et les barrières intérieures, conscientes ou non, de stimuler et de protéger. « Comme une obstinée protestation, dénigrée, moquée, parfois même hypocritement persécutée », cette vie de l’esprit, notait-il, est sans cesse menacée par la méfiance, « l’inertie », voire « l’hostilité » des « puissances conservatrices de tout ordre » qui entretiennent le grand public « dans un état d’arriération » culturelle, esthétique ou artistique. Le XXe siècle nobélisé aura souvent éclairé cet « engagement de l’écriture, qui, chaque fois qu’elle change un tant soit peu le rapport que par son langage l’homme entretient avec le monde, contribue dans sa modeste mesure à changer celui-ci » (ibid.). Parce qu’il est menacé d’aplatissement de mille façons, il est réconfortant que le « domaine des lettres » soit salué et valorisé chaque année. Et c’est sans doute la raison pour laquelle le rituel automnal de Stockholm retient toujours l’attention. Les hommes et les femmes mis en lumière participent de cette protestation, fragile et précaire, « urgente » et « impérieuse » (R. Boyer), contre le sinistre état des affaires humaines.
Trente ans après la première édition de cet ouvrage, le temps était venu de l’actualiser. Le monde a bien sûr changé, certains murs sont tombés, d’autres ont été construits. Ce qui faisait nationalement littérature d’une République des lettres à l’autre, dans un monde étroit, s’est érodé. Depuis la dissolution des empires coloniaux, la centralité européenne s’est fracturée puis défaite (en même temps se sont formés une Union et un marché commun intra-européens progressivement élargis). Les provinces et les lointains de naguère, affranchis de nos fabulations cardinales, départis de nos vérités nationales, ont concurrencé nos panthéons de la pensée, des arts et des lettres. « L’inventaire de nos désintérêts » (R. Bertrand) a montré l’étendue de nos certitudes et de nos préjugés ; nos impensés coloniaux, peu à peu dévoilés, ont libéré d’autres récits, non occidentaux.
Le mot « décentrement » a connu une fortune considérable au tournant du siècle. Centres et périphéries se sont effacés ou déplacés ; une nouvelle géographie, multicentrée, s’est imposée. Les catégories avec lesquelles l’Occident a configuré le monde pendant plusieurs siècles, contestées de toute part, se sont dévaluées. La provincialisation de l’Europe (D. Chakrabarty) a entraîné la dépréciation de ses canons de véridicité. Sans doute, habitués aux récits nationaux qui martelaient notre « prééminence dans tous les genres », trompés par ce que nous paraissions être, de longue date intériorisé : « la partie précieuse de l’univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d’un vaste corps » (P. Valéry), sans doute continuons-nous quelquefois à nous bercer d’illusion sur ce que nous sommes et devenons « en réalité » (ibid.). Décerné pour la première fois en 1901 à « des personnes “ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité” par leurs inventions, découvertes et améliorations dans différents domaines de la connaissance, des savoirs et de la culture » (cinq disciplines, on le sait, sont récompensées : médecine, chimie, physique, littérature et paix – Wikipédia), le Prix Nobel a été le miroir de ce temps où « Tout est venu à l’Europe et tout en est venu. Ou presque tout » (P. Valéry). Ce « tout » aujourd’hui déconstruit s’est transformé en réseaux d’échanges multicentriques et globalisés qui l’a profondément modifié. La notion de mondialisation traduit pour une part cette évolution radicale de ce qui faisait sens et le renversement irréversible des hiérarchies conceptuelles qui étaient imposées. Mais donner voix à parts égales à l’ensemble des mondes qui se rencontrent désormais est une tâche extraordinairement difficile.
Depuis près d’un demi-siècle, l’essor des pensées postcoloniales et transnationales, défaisant les prétentions universalistes d’une partie de l’humanité sur le reste, diversement décliné, a favorisé le décentrage et la pluralisation des récits, des concepts, des modèles d’analyse. La progressive déconstruction de la prose destinale de l’Occident, c’est-à-dire des signes, des croyances, des symboles, des représentations ayant soutenu et légitimé l’expansion de l’universalité des fins de « l’Homme européen » (Valéry), rythmé sa marche civilisatrice et donné sens à ses élans baptismaux, a favorisé la diffusion de proses longtemps jugées insignifiantes : ignorées, minorées, négligées, méprisées ou réprimées. Déverrouillant l’horizon, la compréhension élargie des mondes qui en découlent révèle mille et une manières d’être humain.e la plume à la main. Mais comment accueillir ces frayages d’écriture qui nous interpellent et ouvrent d’autres voies, comment leur rendre raison sans les arraisonner ? Comment donc les recevoir et les interroger sans les soumettre à une interprétation réglée par des actions ou des protocoles qui les réduisent et les dissolvent dans un post-exotisme bon teint, où le distant se mélange au proche, le nouveau à l’ancien, et réciproquement ?
Alors que se défont, se reforment et se déplacent les certitudes de l’Occident, d’autres contrées et d’autres pensées qui ne sont nullement les réserves, les appoints ou les contrepoints de ce que nous avons été, et sommes encore, modèlent notre présent. Au-delà des traditionnels champs nationaux ou culturels qu’arpentaient les chères « têtes blondes » d’autrefois, ce qui est devenu notre réalité commune n’admet plus guère la croyance obstinée en un horizon universel qui n’a jamais existé – croyance qui se survit, s’adapte, se renouvelle : le pas suivant, émancipé des fausses émancipations, sait se faire attendre. Les littératures mondiales, où l’on cherche du commun par habitude « humaniste », le disent : les différends, les dissemblances, les disjonctions abondent. Croisements et frictions, curiosités et désintérêts, rapprochements et indifférences façonnent cet espace.
La richesse des pratiques scripturales a longtemps été ignorée. « Le corpus européen des littératures a l’air d’un estropié congénital ou d’un mutilé volontaire », écrivait déjà en 1955 Raymond Schwab, qui invitait ses contemporains à parcourir la « Bibliothèque de l’univers ». « L’Europe n’est plus le seul écrivain », notait-il encore. Les recensements en cours, prenant acte de cette évidence bafouée, révèlent des gouffres de lacunes ; depuis la nuit des temps, admet-on dorénavant, les territoires de la littérature excèdent les terres littéraires de l’Europe lettrée.
Pressés de toutes parts, les pragmatiques cherchent à corriger cet oubli des autres par le récit de « l’égale dignité des “civilisations” » (R. Bertrand). Des Belles Lettres européo-universelles aux littératures locales et mondialisées, les diverses aventures de la littérature les retiennent enfin ; et ils mêlent volontiers, avec bonne volonté et en guise de réparation, rudiments anthropologiques et outils comparatistes pour affirmer tout à la fois l’universalité des formes et des pratiques littéraires et leur relativité empirique. De ces rencontres, qui seront bientôt, suivant une pente naturelle qui nous est habituelle, la matière d’une histoire « mondiale » de la « littérature » (voire de l’ « idée » de littérature dont on cherchera inlassablement occurrences et récurrences dans tous les recoins de la planète), on attend à la fois estrangement (on parlait naguère d’exotisme), résonances (que l’on se gardera d’unifier) et apparence ou sentiment de globalité (qu’on préservera des réductions de la globalisation). Pluralisme, polycentrisme et polyphonie – sésames du moment – seront ainsi honorés. Mais on peut craindre que l’usage superficiel de ces notions percutantes qui, pourtant, déblaient le terrain et ouvrent l’horizon, ne soit encore encombré de bagages conceptuels inutiles et de représentations erronées ou périmées : « notre » histoire mondiale n’est pas l’histoire « mondiale ». Construire un tel récit de la littérature, dont l’extension et la puissance d’accaparement aux XIXe et XXe siècles transcendent son « ethnocentrisme structural » (P. Casanova), suppose beaucoup plus que l’introduction d’éléments étranges et étrangers dans les désormais fausses évidences qui congestionnent nos esprits. Cet exercice est utile bien sûr ; mais cachant mal une intention normative implicite, il mélange attention aux autres, séduction interculturelle et créolisation des différences, et promeut une démarche qui se dira attentive aux contextes historiques et aux différences locales – ce qui est après tout la moindre des choses – pour mieux embrasser sous une même bannière bigarrée les littérateurs et littératrices de tous les pays et de toutes les contrées.
Qu’en est-il du Prix Nobel de littérature aujourd’hui, dans cette nouvelle géographie des êtres et des écritures effaçant les cartes d’hier et invalidant les réflexes passés ? Dans un monde qui « a perdu sa capacité de faire monde », dans un monde qui « semble avoir gagné seulement celle de multiplier à la puissance de ses moyens une prolifération de l’immonde qui, jusqu’ici, […], jamais dans l’histoire n’avait ainsi marqué la totalité de l’orbe » (J.-L. Nancy), ce Prix fait face à la viralité d’un global immonde. Peloton de reconnaissance de la multiplicité des mondes, attentif aux expressions contemporaines, à la fois populaires et lettrées, des diverses expressions de la condition humaine, son jury favorise la rencontre entre les êtres, les langues, les cultures, les imaginaires, les sensibilités ; il fait droit aux résistances et aux luttes poétiques et politiques, proches ou lointaines ; il fait entendre les cris de l’Histoire et de la Terre, au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest. Toni Morrison, Harold Pinter, Svetlana Alexievitch, Elfriede Jelinek, Herta Müller, Orhan Pamuk, Kenzaburô Ôé, Seamus Heaney, Abdulrazak Gurnah, Günther Grass, Mo Yan, J. M. G. Le Clézio, Imre Kertész, Doris Lessing… : les noms des lauréates et des lauréats du Nobel depuis trente ans sont l’expression littéraire d’un engagement de l’écriture contre l’immonde, quelque forme qu’il prenne. Poèmes, romans, nouvelles, pièces de théâtre et même chansons sont célébrés parce qu’ils et elles participent de cette vigilance, de ce sursaut, de ce refus. Au-delà de la Suède, c’est la Terre entière, du plus petit pays aux plus vastes territoires, c’est l’ensemble des peuples, avec ou sans État, qui sont à chaque fois interpellés.
Cette interpellation se nomme littératures. Essaimées sous toutes les latitudes. Sur tous les continents. À parts égales.
—
Références
Bertrand Romain, L’Histoire à parts égales, Paris, Éditions du Seuil, 2011.
Casanova Pascale, La République mondiale des Lettres, Paris, Éditions du Seuil, 1999 et 2008 (édition revue et corrigée).
Chakrabarty Dipesh, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence
historique (2000), Paris, Éditions Amsterdam, 2009.
Nancy Jean-Luc, La Peau fragile du monde, Paris, Galilée, 2020.
Simon Claude, Discours de Stockholm, Paris, Éditions de Minuit, 1986.
Valéry Paul, La Crise de l’Esprit (1919), Paris, Éditions Manucius, 2016.
Schwab Raymond, « Le porche oriental des littératures », in Mercure de France, Paris, n° 1098, février 1955.