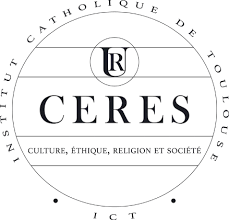
L'autre dans le miroir : Littérature jeunesse et numérique, les nouveaux outils de la rencontre ? The Other Through the Looking-Glass – Children's Literature and Digital Media: New Means of Encounter? (Institut Catholique de Toulouse, Bordeaux & Toulouse)
L'autre dans le miroir : Littérature jeunesse et numérique, les nouveaux outils de la rencontre ? The Other Through the Looking-Glass – Children's Literature and Digital Media: New Means of Encounter?
Après une première rencontre sur le thème de l’interculturalité, et une deuxième centrée sur le discours de la littérature jeunesse sur les migrations, nous organisons les 4 et 5 mars 2026 un colloque international et pluridisciplinaire intitulé « L’autre dans le miroir : Littérature jeunesse et numérique, les nouveaux outils de la rencontre ? ».
Ce colloque, qui veut ouvrir à de nouveaux espaces de rencontres et de pensées, s’organisera en deux journées et deux lieux distincts.
*****
Chapitre I. Rencontrer l’autre à l’ère du numérique
Le 4 mars 2026, la première journée, qui se tiendra à Bordeaux, interrogera la rencontre au prisme de la numérisation du monde, qui, accentuée par la crise sanitaire, a rendu familiers les outils de communication à distance, et notamment les réseaux sociaux.
Nous souhaitons donc interroger les mutations interculturelles en lien avec cette évolution de la technologie et du rapport à la distance. Dans un monde où la distance géographique peut sembler abolie par le développement de l’accessibilité à internet, peut-on en dire autant de la distance culturelle ?
Cette journée se veut à la fois un moment d’échanges réflexifs, conceptuels et scientifiques et une entrée pragmatique sur la question des outils. Elle proposera donc des interventions de chercheur-e-s, mais aussi de praticien-ne-s, de professionnel-le-s du champ, et pourra s’organiser autour de conférences et communications scientifiques, mais aussi d’ateliers et de tables rondes. La proposition de partage est donc ouverte à des chercheur-e-s débutant-e-s comme confirmé-e-s, mais aussi à des praticien-ne-s, concepteur-e-s d’outils, éditeurs et éditrices intéressé-e-s par ces thématiques, au milieu associatif et militant. Les propositions pourront s’intégrer dans un des deux axes suivants, mais aussi proposer des pistes de travail alternatives en lien avec la thématique générale de la journée.
Axe 1 : Rencontre et réseaux sociaux en littérature
La multiplication des supports numériques – des sites aux blogs, puis aux réseaux sociaux numériques – a redéfini la relation entre auteur et lecteur. L’écriture, moins centrée sur une posture auctoriale verticale, tend à s’inscrire dans une dynamique horizontale et participative (Jenkins, 2006), favorisant l’émergence de communautés littéraires en ligne où la parole des lecteurs acquiert une visibilité et une légitimité nouvelles (Paveau, 2017). Les plateformes sociales jouent dans ce cadre un rôle déterminant : les hashtags tels que #Bookstagram ou #BookTok par exemple, contribuent-ils à la mise en visibilité massive des œuvres ? La recommandation, la médiation et la viralité inhérentes aux réseaux sociaux permettent-elles de mieux appréhender l’altérité, en donnant accès à des récits issus de cultures éloignées, tant dans le temps que dans l’espace ? La circulation élargie des textes constitue-t-elle un levier pour favoriser une meilleure compréhension et acceptation de l’autre, ou bien reproduit-elle de nouvelles formes de normativité et d’homogénéisation culturelle ?
Dans ce contexte, la littérature jeunesse constitue un terrain d’étude particulièrement fécond. La manière dont elle investit ces nouveaux espaces numériques interroge la représentation et la transmission de l’altérité auprès des jeunes lecteurs (Serafini & Gee, 2017). De nombreux albums et romans abordent les thèmes de l’exil, de la frontière et de l’hospitalité, et leur circulation numérique (via blogs, chaînes YouTube pédagogiques, ou hashtags dédiés) amplifie leur rôle de médiation interculturelle (Colomer, 2002). Il peut s’agir de romans figurant ou ayant figuré dans les programmes scolaires et/ou ayant concouru pour des prix littéraires destinés aux jeunes, comme le prix Goncourt des lycéens et le roman de Gael Faye, Petit Pays (2016). Nous pensons aussi à la littérature pour les jeunes adultes, avec des œuvres telles A(ni)mal de Cécile Alix (2022), le roman graphique Illegal de Eoin Colfer, Andrew Donkin et Giovanni Rigano (2017), ou le recueil de poèmes de Michael Rosen On The Move (2020), ainsi qu’aux albums jeunesse, à l’instar de Comme un million de papillons noirs de Laura Nsafou (2018).
Axe 2 : Pédagogie et pratiques numériques interculturelles
Springer (2008) pose, à la suite de Pretceille (1999) que les jeunes et les adultes forment aujourd'hui de multiples communautés de pratiques et d'apprentissage sur la toile à travers lesquelles les identités sociales plurilingues se (co)construisent, et qui permettent de développer de nouvelles pratiques interculturelles. Sur le plan pédagogique, Porcher met en exergue dès 2003 la nécessité de parler des interculturels, dans le sens d'un monde construit par l'enrichissement mutuel et l'interpénétration des cultures.
Depuis l'avènement d'internet, de nouvelles formes de communication se sont développées, et les générations d'élèves actuels sont en continu en prise directe avec le monde.
Dans un autre cadre, comptant que l'identité se construit dans un double mouvement d'identification/ différenciation, nous interrogeons l'effet produit par l'accès à une information mondialisée sur les processus de construction identitaire, et, par là même sur la construction de représentations de l'autre.
Pour ce chapitre, les communications et interventions pourront concerner les questions suivantes :
Dans l’axe 1 :
Les transformations des pratiques de lecture et d’écriture en ligne conduisent-elles vers de nouvelles modalités de rencontre avec les œuvres et les auteurs (Hayles, 2008), avec l’autre ?
Quels rôles les communautés littéraires numériques (blogs, forums, réseaux sociaux) assurent-elles dans la redéfinition des médiations entre lecteurs et écrivains (Jenkins, 1992) ?
Comment les enjeux de visibilité et de prescription littéraire sur les plateformes sociales (#BookTok, #Bookstagram, etc.) naviguent-ils entre démocratisation de la lecture et nouvelles formes de normativité ?
La question de l’altérité et de sa représentation dans les espaces littéraires numériques : quelles figures de l’autre émergent et comment sont-elles médiatisées ?
La littérature jeunesse face aux réseaux sociaux numériques (RSN) : comment les récits, les formats et les dispositifs de médiation construisent-ils de nouveaux espaces de rencontre et de découverte culturelle ?
Dans l’axe 2 :
Les médias et plateformes numériques peuvent-ils être envisagés comme des médiateurs privilégiés dans la construction d’une rencontre avec l’autre ? Comment les formes narratives, visuelles ou hybrides qui circulent en ligne transforment-elles l’expérience de lecture des jeunes publics ?
Le numérique peut-il permettre une meilleure rencontre dans le cadre de la classe ? En d'autres termes, l'accès à une information enrichie par la mondialisation d'internet, facilité par la généralisation de la traduction simultanée automatique assistée par IA, permet-elle de mieux connaître l'autre, et de dépasser les stéréotypes induits par l'ignorance ?
Dans un contexte où le nombre d’enfants venus d’autres pays ou issus de familles migrantes augmente dans les classes, quels outils, quelles démarches, quels dispositifs permettent d’accompagner la communauté éducative vers une connaissance des processus migratoires qui soit en prise avec les réalités des personnes migrantes fréquentées au quotidien ? Les enseignants et les équipes de professionnels sont-ils outillés pour didactiser le discours médiatique ?
Comment l'évolution vers la numérisation de la pédagogie incluant le développement de la diffusion de supports numériques influence-t-elle le rapport à la littérature jeunesse interculturelle ? La discussion est ici ouverte à la fois à des éléments concernant l'évolution de l'accès aux supports, mais aussi à leur transformation et aux possibilités ouvertes par l'interactivité des outils.
Chapitre II. De l’autre côté du miroir
Le 5 mars 2026, à Toulouse, la deuxième journée sera consacrée à la notion de l’autre comme miroir dans la littérature jeunesse.
La construction identitaire est un processus social qui débute à la naissance et se construit tout au long de la vie. Marc postule que l'identité « a surtout un sens subjectif : elle renvoie au sentiment de son individualité (« je suis moi »), de sa singularité (« je suis différent des autres et j’ai telles ou telles caractéristiques ») et d’une continuité dans l’espace et dans le temps (« je suis toujours la même personne ») » (2016, p. 28). Henchoz-Reymond rappelle que « l’identité sociale s’articule autour de deux transactions : une transaction « interne » à l’individu et une transaction « externe » entre l’individu et les institutions avec lesquelles il entre en interaction » (2011, p. 38). En ce qui concerne les enfants dans le cadre scolaire, la littérature de jeunesse est un outil didactique ancien, dont les premières traces d'utilisation remontent au XVIIème siècle et dont les instructions officielles recommandent la fréquentation régulière (Devanne, 2006 ; Morin & Montésinos-Gelet, 2007). Les programmes scolaires ont ainsi conféré à la littérature jeunesse une place fondamentale dès le début de la scolarité, et ce dès 2002 en France. En 1999, Perrot avait souligné la nécessité de reconnaître la littérature comme un « fait culturel d'expression totale (…) instrument de lutte contre les handicaps culturels de l'enfant » .
À l’instar d’Alice chez Lewis Carroll, qui use du miroir comme d’un “espace métacognitif qui nous aide à aller au-delà des représentations” (López-Varela Azcárate, 2019, p. 79), enseignants et éducateurs utilisent la littérature jeunesse comme miroir de l’autre, comme un lieu de passage, un pont menant à la découverte de l’altérité et donc de soi, via la relation à l’autre. La “fracture analogique” présente dans les aventures d’Alice au Pays des merveilles (López-Varela Azcárate, 2019) est-elle une caractéristique de la littérature jeunesse des migrations, ou au contraire cette littérature jeunesse permet-elle de renforcer les liens analogiques, voire symétriques ? Des albums tels que Mirror de Jeannie Baker (2010), ou les publications bilingues des éditions Le port a jauni, mettent en avant les parallèles entre soi et l’autre. C'est dans ce cadre que cette deuxième journée de colloque interrogera la place de la littérature jeunesse dans la construction identitaire interculturelle à partir notamment de deux entrées :
Axe 3 : Pédagogies de la rencontre
Philippe Meirieu remarque, dans sa préface à l’ouvrage de Horemans et Schmidt (2013), que “L’enseignement est rencontre s’il permet un partage, si la transmission y est simultanément émancipation, si les protagonistes vivent une aventure dont le résultat, largement imprévisible, est créateur d’humanité.” Comment la littérature jeunesse peut-elle être vectrice d’un tel processus ? Mélanie Champoux (2024) propose une pédagogie de la rencontre au cœur de laquelle se trouve la notion de réciprocité, déjà mentionnée par Meirieu. La création culturelle et artistique est au centre de cette pédagogie qui s’articule en trois étapes : présentation, représentation et expression. Casey Ford, quant à lui, met en avant la notion d’intérité, lieu de rencontre liminal qui mène à la confrontation autant qu’à l’affinité, nécessaires dans l’enseignement (Ford 2020, p. 37).
En outre, Meirieu (2013) note également qu’“Il y a, dans une véritable rencontre, une subversion de tous les enfermements et de toutes les catégorisations.” On peut donc se demander comment créer ces moments de rencontre, de subversion qui redéfinissent les typologies d’un système éducatif.
L’association Narrative 4, créée notamment par des écrivains et artistes aux Etats-Unis, prône l’échange d’histoires pour mettre en place un dialogue et une compréhension mutuelle entre communautés, pour se retrouver soi au travers de l’histoire d’un autre. Il peut donc être également question des stratégies collaboratives ou participatives pour mettre à profit les initiatives associatives sur les enjeux de l’altérité dans la littérature jeunesse.
Axe 4 : Littérature jeunesse et langues
Au-delà de la question de la traduction des œuvres de littérature jeunesse, nous souhaitons ici nous pencher sur la manière dont la littérature de jeunesse envisage les questions de plurilinguisme, mais aussi celles liées aux langues régionales et minoritaires. On pourra se demander comment la langue, en tant qu’outil culturel, est utilisée dans la littérature jeunesse, avec l’exemple d’albums comme Little Treasures de Jacqueline Ogburn et Chris Raschka (2012) ou Le livre qui parlait toutes les langues d’Alain Serres et Fred Sochard (2013).
Au travers de la langue et de la littérature jeunesse, des figures de l’étranger sont ébauchées qui peignent en miroir une représentation de soi. Dans Illegal de Colfer, Donkin et Rigano, l’arabe libyen, le yoruba et l’italien sont les langues de l’autre, qui est tour à tour celui dont il faut se méfier ou celui qui aide, menant les lecteurs et lectrices à se demander où ils et elles se situent eux-mêmes dans ce réseau d’altérités.
L’autre est parfois aussi soi par la langue minoritaire, qui représente un patrimoine identitaire au cœur d’enjeux éducatifs. Ainsi, des maisons d’éditions comme Le port a jauni ou Onoko suggèrent un effort pour situer sa propre culture régionale/ minoritaire aux côtés des autres dans une carte du monde qui se redessine au prisme de soi. La musique vient parfois aussi servir de pont interculturel, pour reprendre le titre de l’ouvrage d’Auger et Le Pichon-Vorstman (2021), entre diverses langues et aires géographiques comme dans les ouvrages des éditions Bannoù-heol (Kan ar Bed, Ur Veaj war gan tro-dro d’ar bed/ Un Voyage musical autour du monde, 2018).
Ces ouvrages, ainsi que les ateliers d’écriture plurilingues, tels ceux mis en place par Isabelle Audras, Sidonie Brouwer, Anne Descamps, Elsa Valentin (La Page Educ’, s.d.), et le diamant langagier (Auger, 2025) sont autant d’exemples d’outils pour créer la rencontre en classe multilingue, qui se fait ainsi lieu d’hospitalité et de “babélité” (Paquot, 2019, p. 64).
Dans ce chapitre, les propositions pourront concerner les questions suivantes :
Dans l’axe 3 :
La littérature jeunesse permet-elle de (re)présenter ces moments d’intérité et donc de se faire l’outil de la rencontre ? Comment mettre en œuvre ces processus dans nos contextes éducatifs ?
La littérature jeunesse, au travers des images autant que du texte, construit-elle similarités autant que différences, ressemblances et dissonances ?
À quel point la littérature jeunesse peut-elle être subversive en créant liens et ponts ?
Comment mettre à profit les initiatives associatives en lien avec la littérature et l’altérité dans le contexte éducatif ?
Dans l’axe 4 :
Comment la littérature jeunesse s'empare-t-elle de la question de la langue en tant qu'outil culturel ? Quelle reconnaissance des langues et cultures autres, et en particulier dites « minoritaires » porte-t-elle ? De quelles dynamiques interculturelles les usages de la langue en littérature jeunesse participent-ils ? Quelles représentations des langues / quelles représentations des cultures par les langues proposent les ouvrages de littérature jeunesse ?
Comment le rapport à la langue de la littérature jeunesse dessine-t-il les contours de la figure de l'étranger et en quoi le travail sur la langue de la littérature jeunesse est-il aussi (et surtout ?) un travail sur l'altérité comme autre moi ?
Comment l’environnement éducatif multilingue favorise-t-il la création de ponts interculturels ?
Comment évaluer l’impact des outils de la rencontre dans le contexte éducatif ? Comment continuer à bâtir du lien à partir de ces expériences ?
*****
Nous invitons donc les propositions sur les thématiques suivantes :
Représentations de la rencontre et de l’autre dans la littérature jeunesse
Littérature jeunesse et numérique
Altérité dans la littérature jeunesse
Littérature jeunesse comparée sur ces thématiques
Interculturalité dans la littérature jeunesse
Plurilinguisme et traduction dans la littérature jeunesse
Didactique de la littérature jeunesse
Didactique du numérique
Pédagogie de la rencontre
Rôle des bibliothécaires et médiateurs culturels dans la rencontre multiculturelle
Soumission de proposition et échéances :
Les propositions de communications ou d’ateliers participatifs sont à envoyer (sous forme d’un résumé de 300 mots maximum, accompagné de 3 à 5 références bibliographiques et de 3 à 5 mots-clefs), ainsi qu’une courte bio-bibliographie, via la page https://littjeun.sciencesconf.org/?lang=fr pour le 10 janvier 2026.
Le colloque est ouvert à toutes les langues de communication. Merci de produire votre résumé dans la langue de communication et en français, anglais ou espagnol.
Les confirmations d’acceptation des communications seront envoyées au plus tard le 31 janvier 2026.
Informations pratiques :
Le chapitre 1 de ces rencontres aura lieu sur le campus de l’ICT à Bordeaux le mercredi 4 mars 2026 : 2 allée Marianne Loir, Bordeaux, à côté de la Gare St Jean.
Le lendemain, le chapitre 2 se tiendra sur le site historique de l’Institut Catholique de Toulouse, 31 rue de la Fonderie, dans le quartier des Carmes à Toulouse.
Les horaires du colloque tiendront compte du temps de trajet de Bordeaux à Toulouse le mercredi 5 mars en fin de journée, pour que les participants qui souhaitent être présents aux deux chapitres de ces rencontres puissent le faire.
Call for Papers “Rencontres ICT de littérature jeunesse”
After a first event on the theme of interculturality and a second focused on narratives of migration in children’s literature, this international and multidisciplinary conference is to take place on 4th and 5th March 2026 on the following topic: “The Other Through the Looking-Glass – Children’s Literature and Digital Media: New Means of Encounter?”
This conference, which aims to open new spaces of encounter and thought, is to be spread over two days and two campuses.
*****
Chapter I. Encountering the Other in the Digital Age
On 4th March 2026, the first day of the conference, held in Bordeaux, will question the theme of encounter through the prism of the digitalization of the world, heightened by the pandemic, and which has popularised online communication strategies, and particularly social media.
We wish to discuss intercultural changes linked to this technological evolution and to the evolving relation to distance. In a world where geographical distance may seem a thing of the past through a growing access to the internet, can the same be said of cultural distance?
This first half of the conference aims to be a time for reflective, conceptual and scientific discussions as well as a pragmatic perspective on means and practical strategies. It will therefore be open to academics as well as professionals in the field(s) and it could be articulated around both research papers and workshops or round tables. We welcome researchers at any stage of their career, along with professionals creating tools for the education sector, teachers, editors and publishers interested in these topics, as well as educational charity workers and activists. Proposals can fit into one of the two following approaches, but also offer alternative leads tied to the general theme of the conference.
Topic 1: Encounter and Social Media in Literature
The multiplicity of digital media – from websites to blogs and then to digital social networks – has redefined the relationship between author and reader. The author’s stance is now less top-down and is moving towards a horizontal and participative dynamics (Jenkins, 2006), thus fostering emerging literary online communities in which the readers’ views become more visible and legitimate (Paveau, 2017). Within this framework, social platforms play a key role: do hashtags such as #Bookstagram or #BookTok for instance massively enhance the visibility of literary works? Do recommendation, mediation and viral buzz, which are inherent characteristics of social media, allow us to better come to grips with otherness by giving us access to narratives from cultures away from our own, both geographically and chronologically? Does the wider circulation of texts enable a shift towards a better understanding and acceptance of the other, or does it replicate new forms of cultural normativity and homogenization?
In this context, children’s literature is a particularly fertile terrain: the way in which it moves into these new digital spaces questions the representation and transmission of the notion of otherness to young readers (Serafini & Gee, 2017). Many picture books and novels deal with themes like exile, borders, and hospitality, and their digital circulation (through blogs, pedagogical YouTube channels or dedicated hashtags) increases their role of cultural mediators (Colomer, 2002). There are novels which feature or have featured in school curricula and/or which have run for literary prizes aimed towards young people, such as the prix Goncourt des lycéens and Gael Faye’s novel Petit Pays (2016). One may also think of young adult literature, with works such as A(ni)mal by Cécile Alix (2022), Eoin Colfer, Andrew Donkin and Giovanni Rigano’s graphic novel Illegal (2017) or the poetry collection by Michael Rosen, On The Move (2020), as well as picture books such as Comme un million de papillons noirs by Laura Nsafou (2018).
Topic 2: Pedagogy and Intercultural Digital Practices
Springer (2008), following Pretceille (1999), posits that young people and adults now form multiple practice and learning communities on the web, through which plurilingual social identities are (co)constructed, and which enable new developing intercultural practices. At a pedagogical level, Porcher has highlighted as early as 2003 the necessity to speak of interculturality, in that a world is built through mutual enrichment and cultural intermingling.
Since the birth of the internet, new forms of communication have developed and the current generations of pupils are continually directly in touch with the world.
Within another framework, as identity can be understood as being built in a double process of identification and differentiation, we question the effect direct access to globalized information has on identity formation, and therefore on the construction of representations of the other.
For this chapter, papers and presentations may focus on the following questions:
Within Topic 1:
Do the transformations of reading and writing online practices lead to new modalities of encounter with the literary works and their authors (Hayles, 2008), and with the other?
Which role do digital literary communities (blogs, fora, social networks) play in the redefinition of the mediation between readers and writers (Jenkins, 1992)?
How do social platforms (#BookTok, #Bookstagram, etc.), and the notions of high visibility and literary reviewing and recommendation at stake within them, navigate between democratising reading and new forms of normativity?
On the question of otherness and its representation within digital literary spaces: which figures of the other emerge and how are they presented in the media?
Children’s literature facing digital social media: how do narratives, formats and mediating initiatives build new areas of encounter and of cultural discovery?
Within Topic 2:
Can media and digital platforms be considered the privileged means to set up and mediate an encounter with the other? How do the visual or hybrid narrative forms that are available online transform the reading experience for young people?
Can digital tools and strategies allow for a better encounter with the other within the classroom? In other words, can access to information, enriched by the globalized and globalizing internet, and facilitated by the spreading use of automated and simultaneous translation assisted by AI, allow to better know the other and to go beyond ignorance-induced stereotypes?
In a context in which the number of children from other countries or from immigrant background is rising in classrooms, which tools, initiatives and approaches can assist educators towards an understanding of the migration processes that is tied to the everyday realities of the people from a migration background they encounter daily? Are teachers and education professionals equipped to turn media discourse into a didactic tool?
How does the change towards the digitalization of pedagogy, including the development of the circulation of digital resources, influence the relation to intercultural children’s literature? The discussion is open to both aspects of the evolving access to these resources, and to their transformation and the possibilities offered by the interactive nature of these tools.
Chapter II. Through the Looking-Glass
On 5th March 2026, in Toulouse, the second day of the conference will focus on the notion of the other as a mirror in children’s literature.
Identity construction is a social process which begins at birth and which is built upon throughout one’s lifetime. Marc claims that identity “mainly has a subjective meaning: it calls upon one’s sense of individuality (‘I am me’), of singularity (‘I am different from others and I have such and such characteristics’) and of a space and time continuity (‘I am still the same person’)” (2016, p. 28). Henchoz-Reymond reminds us that “social identity is articulated around two transactions: one transaction ‘internal’ to the individual and one ‘external’ transaction between the individual and the institutions with which they interact” (2011, p. 38). With regards to children in the school context, children’s literature is an old didactic tool, whose first recorded uses date back to the 17th century and to which official recommendations put forth a regular exposure (Devanne, 2006; Morin & Montésinos-Gelet, 2007). School curricula have thus given a key place to children’s literature right from the beginning of a pupil’s schooling and as early as 2002 in France. In 1999, Perrot had underlined the necessity to recognize literature as a “cultural product of complete expression […], a tool to fight against a child’s cultural handicaps” .
Like Lewis Carroll’s Alice, who uses the mirror as a “metacognitive space that helps us look beyond representation” (López-Varela Azcárate, 2019, p. 79), teachers and educators use children’s literature as a mirror to the other, as a crossing place, a bridge towards the discovery of otherness and therefore of oneself, through the relation to the other. Is the “analogic fracture” which features in Alice’s adventures in Wonderland (López-Varela Azcárate, 2019) characteristic of children’s migration literature? Or, on the contrary, does this type of children’s literature strengthen analogical, even symmetrical, links? Picture books like Mirror by Jeannie Baker (2010) or the bilingual publications by editors such as Le Port a jauni highlight the parallels between self and other. It is within this tentative framework that the second day of the conference will question children’s literature’s impact on intercultural identity formation, particularly through two approaches:
Topic 3: Pedagogies of Encounter
Philippe Meirieu notes, in his preface to Horemans and Schmidt’s work (2013), that “teaching is an encounter if it enables sharing, if transmission is simultaneously emancipation, if the protagonists experience an adventure whose result, quite unpredictable, creates moments of humanity.” How can children’s literature be a vector for such a process? Mélanie Champoux (2024) puts forward a pedagogy of encounter at the heart of which is the notion of reciprocity, already mentioned by Meirieu. Cultural and artistic creation is central to this pedagogy, articulated in three steps: presentation/introduction, representation, and expression. Besides, Casey Ford points out the notion of interity, liminal meeting place that leads to confrontation as well as to affinities, both necessary in teaching (Ford 2020, p. 37).
Moreover, Meirieu (2013) also remarks that “there is, in a true encounter, a subversion of all entrapments and categorizations.” One may thus wonder how to create these moments of encounter and of subversion that redefine the typologies of an educational system.
Narrative 4 is a charity, notably founded by writers and artists in the United States of America, that advocates for story exchanges in order to set up dialogue and mutual understanding between communities, in order to find oneself in the story of another. We may then also examine collaborative or participative strategies to implement such activist initiatives around the issue(s) of otherness in children’s literature.
Topic 4: Children’s Literature and Languages
Beyond the matter of the translation of children’s literature works, we wish to focus on the manner in which children’s literature considers questions of plurilingualism, but also those tied to regional and/or minority languages. One may wonder how language, as a cultural tool, is used in children’s literature, with such picture books as Little Treasures by Jacqueline Ogburn and Chris Raschka (2012) or Le livre qui parlait toutes les langues by Alain Serres and Fred Sochard (2013).
Through language and children’s literature, figures of the other are sketched that mirror a certain representation of the self. In Illegal by Colfer, Donkin and Rigano, Libyan Arabic, Yoruba and Italian are the languages of the other, who is in turn a stranger to be wary of and who provides much-needed help, thus leading readers to wonder where they place themselves within this network of “othernesses”.
The other is sometimes also the self through a minority language, which represents a heritage at the heart of educational concerns. Editors like Le port a jauni or Onoko thus suggest an attempt to situate one’s own regional/minority culture alongside others on a map of the world that is redrawn through the prism of the self. Music at times comes as an intercultural bridge, to take up the title of Auger and Le Pichon-Vorstman’s book (2021), between diverse languages and geographical areas, as in the books published by Bannoù-heol (Kan ar Bed, Ur Veaj war gan tro-dro d’ar bed/ Un Voyage musical autour du monde, 2018).
These works, as well as plurilingual writing workshops such as those set up by Isabelle Audras, Sidonie Brouwer, Anne Descamps, Elsa Valentin (La Page Educ’, s.d.), and as the language diamond (Auger, 2025), are as many tools and strategies to create encounters in a multilingual classroom, which becomes a place of hospitality and “babelity” (Paquot, 2019, p. 64).
In this chapter, proposals may focus on the following questions:
Within Topic 3:
Does children’s literature allow a (re)presentation of moments of interity and thus become the means of encounter? How do we put these processes in place in our education contexts?
Does children’s literature, through image as much as text, build similarities as well as differences, resemblances and dissonances?
To what extent can children’s literature be subversive by creating links and bridges?
How can we implement activist initiatives linked to literature and otherness in the education context?
Within Topic 4:
How does children’s literature take hold of the language question as a cultural strategy? How does it convey an understanding of the language and culture of the other, in particular of so-called minority languages? Of which intercultural dynamics does language use in children’s literature partake? Which representations of language and of cultures through language do children’s literature works offer?
How does the relationship to language in children’s literature influence the representation of the other? How is the study of language in children's literature also (and particularly) the study of otherness as another self?
How does a multilingual education environment foster the creation of intercultural bridges?
How do we evaluate the impact of strategies of encounter in the education context? How do we continue to create encounters from these experiences?
*****
We thus invite proposals on the following themes:
Representations of encounter and otherness in children’s literature
Children’s literature and digital media
Otherness in children’s literature
Comparative children’s literature on these topics
Interculturality within children’s literature
Plurilingualism and translation in children’s literature
Children’s literature and didactics
Digital didactics
Pedagogies of encounter
Role of librarians and cultural mediation in multicultural encounters
Abstract submission and deadlines:
Please send proposals for papers or participative workshops (as an abstract of 300 words maximum, along with 3 to 5 bibliographical references and 3 to 5 key words) and a short bio-bibliography via the website https://littjeun.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=en by 10th January 2026.
The conference is open to all languages of communication. Please send your abstract in the language you wish to present in, as well as in French, English or Spanish.
Acceptance will be notified by 31st January 2026 at the latest.
Practical Info:
Chapter I of this conference will take place on the ICT Bordeaux campus on Wednesday 4th March 2026: 2 allée Marianne Loir, Bordeaux, by the main St Jean train station.
The following day, Chapter II will be held on the historic, main campus of the Catholic University of Toulouse, 31 rue de la Fonderie, in the Carmes district in Toulouse.
The schedule of the conference will allow for travelling from Bordeaux to Toulouse on Wednesday 5th March at the end of the day, so that participants who wish to attend both days of the conference may do so.
Références
Audras, I. & Brouwer, S. & Descamps, A. & Valentin, E. “Vivre la diversité des langues : l’exemple des ateliers d’écriture plurilingues accompagnés par une autrice.” La Page Educ’, s.d. https://www.page-educ.fr/article/vivre-la-diversite-des-langues-lexemple-des-ateliers-decriture-plurilingues-accompagnes-par-une-autrice
Auger, N. & Le Pichon-Vorstman, E. (2021). Défis et richesses des classes multilingues, Construire des ponts entre les cultures. ESF.
Auger, N. (2025). « Le diamant langagier pour valoriser les pratiques plurilingues. » conférence en ligne.
Champoux, M. (2025). Chapitre 1.2 - Vers une pédagogie de la rencontre - Une contribution au réenchantement de nos rapports au monde. » Champoux, M., Homier, M., Bernier, A., Blanchet, P-A., Edward, K., Gosselin, L., Guité, A., L’Heureux, K., Meilleur, B., Paquin, G., Point, C. Culture Éducation Écologie – Une approche contemporaine de l’enseignement. Université de Sherbrooke.
Colomer, T. (2002). El papel de la mediación en la formación de lectores. Colomer, T; Ferreiro, E. ; Garrido, F. Lecturas sobre lecturas. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 9-29.
Devanne, B. (2006). Mettre en projet les apprentissages littéraires. Québec français (143) : 68-70.
Ford, C. (2020). A Pedagogy of the Encounter: Interity and Education in Dewey and Deleuze. Chantiers de l’intervention en sciences humaines : interdisciplinarité pratique et action professionnelle 5 (pp. 29-39).
Henchoz-Reymond, A.-M. (2001). Construction de l'identité, un chantier en perpétuel mouvement. Educateur Magazine, pp. 38-39.
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.
López-Varela Azcárate, A. (2019). Beyond Analogy: the Semiosis of Lewis Carroll’s Fantasy Worlds. The ESSE Messenger, n°28.1, pp. 75-97.
Marc, E. (2016). La construction identitaire de l'individu. C. Halpern, Identité(s) : l'individu, le groupe, la société. pp. 28-36. Sciences Humaines Editions.
Meirieu, P. (2013). Préface à Pratiquer la pédagogie de la rencontre en éducation, ed. Horemans, J.-F. & Schmidt, A. Chroniques Sociales.
Montésinos-Gelet, I. & Morin, M-F. (2007). Approcher l’écrit à pas de loup. La littérature de jeunesse pour apprendre à lire et à écrire au préscolaire et au primaire. Chenelière Éducation.
Paquot, T. (2019). Pédagogie de l’hospitalité. Diversité 196. pp. 59-64.
Paveau, M-A. (2017). Linguistique des discours numériques : Dictionnaire des formes et des pratiques. Hermann.
Perrot, J. (1999). Recherche et littérature de jeunesse en France : recherche pure ou appliquée ?. Bulletin des bibliothèques de France. 44,3.
Porcher L. (2003). Interculturels : une multitude d’espèces. Le Français dans le
Monde, n°329. http://www.fdlm.org/fle/article/329/interculturel.php
Pretceille A. (1999). L’éducation interculturelle. Que sais-je ? PUF.
Serafini, F. ; Gee, E. (2017) Remixing Multiliteracies: Theory and Practice from New London to New Times.
Springer, C. (2008). Vers une pédagogie du dialogue interculturel : agir ensemble à travers les nouveaux environnements numériques sociaux. University studio press. Actes du colloque international " 2008. Année européenne du dialogue interculturel: communiquer avec les langues-cultures ».