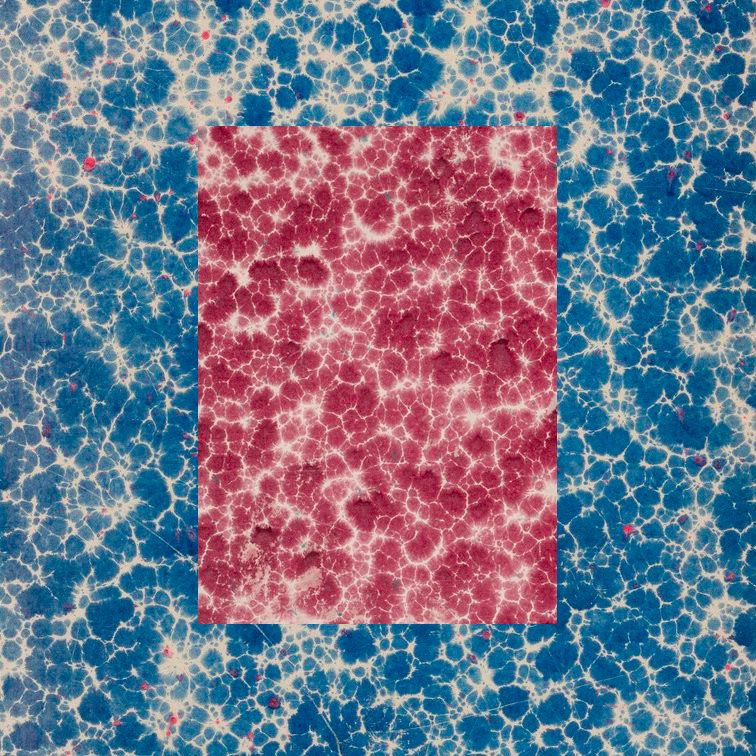
Le livre fait par tous : actualités et perspectives de la recherche sur l'autoédition (BnF – Site Richelieu)
Présentation
L’essor de l’autoédition et la diversité de ses usages (Bosser, 2019) interrogent les évolutions des pratiques d’édition, d’écriture et de lecture en contexte numérique, ainsi que la place et le rôle des acteurs institutionnels dans la reconnaissance et la conservation de ces productions. Dans le cadre du projet EDAM (« autoédition et pratiques amateurs ») financé par le Plan quadriennal de la recherche, la Bibliothèque nationale de France organise une journée d’étude consacrée à ce « continent ignoré » (Peltier et al.). L’autoédition sera abordée comme une « édition non sélective » (Parmentier, 2022), couvrant ainsi un large spectre allant de l’auto-impression (Martinelli, 2016) à l’édition à compte d’auteur (Lahire, 2006), du livre d’artiste (Mœglin-Delcroix, 1985) aux productions amateurs (Flichy, 2010), de la fiction à la non-fiction, de l’imprimé au numérique (Deseilligny, 2022). Cette rencontre, au carrefour des disciplines, rassemblera des chercheurs et chercheuses en économie de la culture, sociologie, sciences de l’information et de la communication, histoire et arts plastiques, pour dresser un état des lieux des travaux en cours et ouvrir de nouvelles perspectives de recherche.
Argumentaire
Contrairement à d’autres secteurs d’activités réglementés, le droit d’entrée dans le champ éditorial n’est pas strictement codifié (Mauger, 2007). Dans un contexte où chacun a potentiellement la possibilité de publier, l’éditeur traditionnel filtre les prétendants (Simonin & Fouché, 1999). De la même manière que « les goûts sont sans doute avant tout des dégoûts » (Bourdieu, 1979), le catalogue d’un éditeur est donc sans doute avant tout une liste de livres qu’il choisit de ne pas publier (Simonin, 2004). Bien que ce monopole du pouvoir de sélection et de consécration soit sans cesse contesté au nom de principes de hiérarchisations autonomes ou hétéronomes (Ducas, 2003), c’est in fine à l’éditeur qu’appartient la décision, et c’est lui qui en assume le risque financier.
De sorte que les candidats malheureux à la publication sont souvent relégués aux frontières du champ (Poliak, 2006), alimentant un « marché des refusés » que les plateformes d’autoédition cherchent à exploiter (Severo & Thuillas, 2020 ; Legendre, 2019). En effet, faute d’être publiés, certains prétendants décident de se publier, se réappropriant ainsi le pouvoir de décider de la diffusion de leurs textes. Si l’autoédition permet alors la disponibilité des œuvres, elle ne garantit pas d’être lu et elle enjoint donc l’auteur « à agir comme un entrepreneur pour assurer la visibilité des livres qu’il publie » (Wiart, 2015). Néanmoins, l’autoédition ne peut pas être réduite à une simple pratique de consolation. Elle recouvre une pluralité de fonctions et d’usages : elle constitue aussi une voie d’entrée dans le champ éditorial (Deseilligny, 2022 ; Le Bruchec, 2019), un vivier pour le sous-champ de la grande production (Bosser, 2019), une stratégie d’autonomisation pour des auteurs consacrés (Lesage, 2014 ; Benhamou, 2014), ou encore un moyen d’appareiller des contenus spécialisés et des publics restreints sur des secteurs de niche (Ravier, 2019).
Les contours de l’autoédition n’en restent pas moins difficiles à cerner (Bessard-Banquy, 2019). Le flou est parfois entretenu et théorisé, et certains cas posent question, ne serait-ce que lorsque les auteurs sont par ailleurs eux-mêmes éditeurs (Caraco, 2024 ; Morvandiau, 2024). Cette notion d’autoédition peut ainsi recouvrir des aspects juridiques (quelle est la nature du contrat ?), économiques (qui engage les fonds ?) et éditoriaux (qui assure les fonctions éditoriales ?). Selon la position des auteurs dans le champ, elle peut être assumée voire revendiquée, ou au contraire être mise à distance et jugée disqualifiante par ceux qui l’assimilent à un stigmate. Au tournant des années 2000, le numérique a par ailleurs favorisé l’essor de cette modalité d’édition (Peltier et al., 2024 ; Pajou, 2016) en contribuant à lever certaines des barrières symboliques, techniques et financières qui entravaient l’accès à la publication des « amateurs » (Flichy, 2010). Ces bouleversements font donc aussi de l’autoédition un révélateur des transformations du champ éditorial contemporain.
Nous proposons lors de cette journée d’aborder l’autoédition comme une « édition non sélective » (Parmentier, 2022), couvrant ainsi un large spectre qui va de l’auto-impression (Martinelli, 2016) à l’édition à compte d’auteur (Lahire, 2006), du livre d’artiste (Mœglin-Delcroix, 1985) au livre amateur, de la fiction à la non-fiction, de l’imprimé au numérique (Deseilligny, 2022), des pratiques les plus légitimes à celles qui sont les plus déconsidérées. Nous souhaitons ainsi interroger la place, le sens et les évolutions de cette « édition parallèle » (Habrand, 2016) : quels sont le profil et la trajectoire de ceux qui s’autoéditent ? Quel rapport entretiennent-ils au livre et qu’est-ce qui motive le recours à l’édition non sélective (Harchi, 2019) ? Quelles sont la nature ou les spécificités des œuvres ainsi éditées ? Comment ces livres sont-ils produits (Baverstock et al., 2015) et de quels types de médiations (Barth-Rabot, 2023) font-ils l’objet, en matière de diffusion, de conservation et de valorisation ?
Programme - vendredi 28 novembre 2025
9h – Accueil
9h30 – Mots d’introduction des organisateurs et conférence inaugurale
• « L’autoédition, un continent ignoré », Stéphanie Peltier, La Rochelle Université.
10h45 – Les institutions et l’autoédition – modération : Sylvie Colombani (BnF)
• « L’autoédition en Belgique francophone : frontières et critères de légitimation », Tanguy Habrand, Université de Liège.
• « L’autoédition des sociétés savantes », Arnaud Dhermy, Bibliothèque nationale de France.
12h – Pause déjeuner
13h30 – Des plateformes et des livres
• « Autoédition et éditeurs : état des lieux d’une relation tout en nuances », Sylvie Bosser, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
• « De l’auto-publication sur Wattpad à l’édition imprimée : processus éditoriaux et trajectoires de jeunes auteurs », Oriane Deseilligny, Université Sorbonne Paris Nord
15h – S’éditer en amateur – modération : Cécile Rabot (Université Paris-Nanterre)
• « Produire de “vrais livres” : l’essor de l’autoédition et la valeur de l’objet-livre en Égypte », Giedrė Šabasevičiūtė, Académie des Sciences tchèque.
• « “Si plus personne ne lit, pourquoi autant de gens se mettent à écrire des livres ?” », Iñaki Ponce Nazabal et Irène Bastard, Bibliothèque nationale de France.
16h30 – Diversité des pratiques du livre et de l’écrit – modération : Sophie Noël (Université Paris-Panthéon-Assas)
• « Contrebande et livre d’artiste : deux utopies de l’autoédition ? », Morvandiau, Université Rennes 2.
• « Usages sociaux de l’écrit dans l’espace des spiritualités contemporaines », Anna Berrard, EHESS.
18h – Conclusion et moment convivial