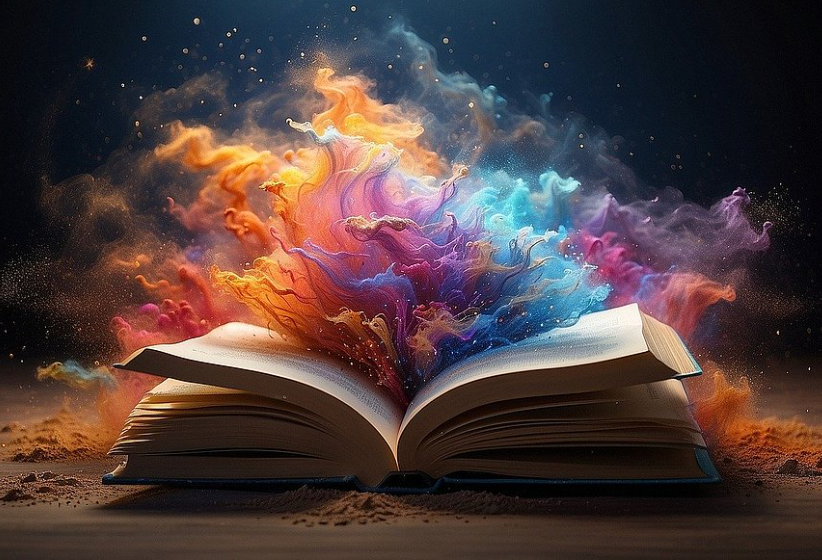
Voyages de contes. Processus de transfert culturel entre la tradition des contes italiens, français et espagnols (Wuppertal, Allemagne)
Congrès international sur les processus de transfert culturel entre la tradition des contes italiens, français et espagnols du 10 au 12 juin 2026 à la Bergische Universität Wuppertal (Allemagne)
Nous vous invitons à nous envoyer un résumé de 350-400 mots avant le 30 novembre 2025 au plus tard. Veuillez envoyer votre résumé avec un bref CV à selina.seibel@ilw.uni-stuttgart.de et wiemer@uni-wuppertal.de. Les frais de déplacement et d'hébergement peuvent probablement être pris en charge.
Raconter des contes présuppose une communauté narrative culturelle, même imaginaire, qui se constitue comme telle par des schémas et motifs narratifs créateurs de réalité, de sens et d’identité. Cela se fait d’une part dans les conditions propres à leur espace culturel, mais aussi en relation avec les processus d’adaptation et de transformation auxquels les matières et motifs des contes sont soumis lorsqu’ils « voyagent » dans l’histoire croisée / entangled history (Conrad/Randeria 2002) comme travelling narratives (Baumbach/Michaelis/Nünning 2012) entre les espaces culturels. En conséquence, la notion de voyage doit être comprise, pour le colloque, en un triple sens : elle recouvre à la fois les mouvements adaptatifs trans- et intertextuels des matières et motifs de contes à travers la Romania, mais aussi les voyages géographiques concrets de nombreux auteurs et autrices de contes. Par ailleurs, le topos du voyage au sens d’un rite de passage (van Gennep 1909) constitue le noyau de la diégèse du conte, renvoyant structurellement aux origines anthropologiques du conte (Propp 1987). Une attention particulière est donc accordée aux déplacements des personnages des contes, car leur mobilité est aussi l’expression de la migration transculturelle des matières et motifs merveilleux, et peut dès lors être comprise comme le reflet d’espaces de mobilité sociaux, politiques et imaginaires.
L’objectif du colloque d’orientation transromane et comparatiste est de mettre en lumière le phénomène jusqu’ici peu étudié – bien que d’ampleur considérable – des voyages de contes, c’est-à-dire la triade du transfert réciproque de matières et motifs entre contes italiens, français et espagnols, des voyages des auteurs et autrices et des personnages des contes eux-mêmes.
Les matières de contes se distinguent par une fréquence d’adaptation et de migration exceptionnellement élevée. Cela est démontré notamment par les typologies systématisées de la recherche folklorique depuis le XIXᵉ siècle, comme la classification Aarne-Thompson-Uther (ATU), qui classe les types de contes, quoique de façon assez générale, au-delà des frontières nationales, linguistiques et médiatiques. Rarement un autre réservoir littéraire est-il autant marqué par la réutilisation, la reconfiguration, l’hybridation et le franchissement des genres ; les contes deviennent de véritables « medium breakers » (Greenhill and Matrix 2010) et « shape shifters » (Tatar 2010, p. 56 ; Warner 1994). Ainsi, surtout aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, avec l’essor des genres dramatiques (théâtre, opéra, mélodrame), ils sont de plus en plus adaptés pour la scène, et conquièrent, à partir du XXᵉ siècle, notamment grâce à la Walt Disney Company, l’espace cinématographique (Ayres 2003 ; Haas/Trapedo 2018) et enfin le World Wide Web.
En tant que partie intégrante de l’ADN culturel – Zipes parle ici de memes mémoriels (2006) – les contes traitent des thèmes fondamentaux de l’existence humaine et de la vie en société (Rudy 2018) et élaborent des cadres narratifs universels, adaptés, actualisés et transformés écotypiquement (Sydow 1934). Ils doivent dès lors être compris comme des vecteurs narratifs et communicatifs de moments réflexifs spécifiques, qu’ils soient historiques, sociaux, politiques, juridiques, économiques, ou littéraires et poétologiques. En particulier en temps de crise, les contes enrichissent les réalités de vie de sens, en réduisent la complexité et offrent, grâce à leurs mondes narratifs magiques, confiance et potentiel d’identification (Buttsworth and Maartje Abbenhuis 2017 ; Lopez-Ortíz 2014 ; Grätz 1995). De cette façon, les contes deviennent des lieux utopiques de désir, mais aussi des instruments de critique et de subversion, puisqu’ils remettent en question les rapports de pouvoir établis et les répartitions de rôles, ainsi que les normes et valeurs transmises, et proposent des visions sociétales alternatives.
Bien que l’espace de circulation des matières de contes soit global (Graça/Tehrani 2016 ; Johnson et al. 2021, p. 1), on observe dans la Romania une densité et une intensité particulièrement forte de transfert de matières et de culture (Seago 2018, Trinquet 2012) ; ceci, non seulement en raison de l’origine latine commune, qui se manifeste par exemple dans la réception transculturelle de l’Amor et Psyche d’Apulée (Bottigheimer 2014). Entre l’Italie, la France et l’Espagne, on peut constater dès le XVIᵉ siècle de multiples intertextes, réinterprétations et rétroactions qui témoignent d’un réseau étroitement intriqué de mobilité littéraire. Cela inclut, avec la traduction et l’édition par Galland, Les Mille et Une Nuits (1704-1717), des matières « orientales », et avec la réception des Grimm, aussi la tradition des contes allemands. La Romania fonctionne ainsi non seulement comme un champ décisif de transfert de motifs narratifs, mais aussi comme un laboratoire de transformations poétologiques, médiatiques et sociopolitiques du conte.
Il s’agit ici d’une opportunité, dans une perspective diachronique et synchronique à partir du XVIᵉ siècle, d’examiner le traitement des matières afin de mettre en évidence et d’interpréter les contextes sociétaux, politiques et économiques spécifiques. La littérature de recherche considère toutefois la fin du XVIIᵉ siècle comme une période clé de la réception des contes en Europe, et situe la France comme point de départ géographique. C’est là que Charles Perrault fixa et publia, dans ses recueils Contes en vers (1694) et Histoires ou Contes du temps passé, avec des moralités ou Contes de ma Mère l’Oye (1697), les récits transmis oralement pendant des siècles. C’est également à cette époque que les questions poétologiques relatives au genre du conte de fées littéraire, en opposition aux contes transmis oralement, deviennent virulentes, car elles s’opposent aux principes de la doctrine classiciste de la vraisemblance (Trinquet 2012).
En réalité, dès le XVIᵉ et au début du XVIIᵉ siècle en Italie, des recueils de contes ont été rédigés, comme ceux de Giovanni Francesco Straparola (Le piacevoli notti, 1550-1553) ou de Giambattista Basile (Il Pentamerone, 1634), qui influencèrent de manière déterminante la genèse des contes français de la fin du XVIIᵉ siècle ainsi que ceux d’Espagne (Seago 2018). La mise par écrit de ce genre foncièrement oral n’extrait nullement les contes de leur oralité ; au contraire, ils deviennent, à la fin du XVIIᵉ siècle en France, un élément de divertissement et de distinction pour l’élite sociale et un élément fixe de la culture des salons. Dans ce contexte, et sur fond de la Querelle des femmes et du cercle des autrices appelées Les Précieuses, des dames aristocratiques telles que Madame d’Aulnoy, Madame L’Héritier et Madame de Murat reprennent avec succès la tradition italienne du conte et la transforment en un instrument d’émancipation, agissant de manière subversive tant sur le plan socioculturel que politique. Au XVIIIᵉ siècle, les recueils de leurs successeures comme Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (Magasin des Enfants ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves, 1756) prennent alors une orientation de plus en plus pédagogique, car ils s’adressent – comme les Kinder- und Hausmärchen (1812-1857) des frères Grimm – à un public jeune, principalement féminin en France, qu’il s’agit d’éduquer grâce à la littérature de contes. Enfin, au début du XIXᵉ siècle, des autrices comme la Comtesse Stéphanie Félicité Genlis, avec ses Nouveaux contes moraux et nouvelles historiques (1805), transposent lescontes dans des adaptations résolument féministes (Duggan 2018, p. 115). En Italie aussi, on observe au XIXᵉ siècle une tradition de collecte et d’étude des variantes régionales des contes, comme dans Fiabe e novelle popolari veneziane (1828) de Domenico Giuseppe Bernoni ou Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani (1875) de Giuseppe Pitrè.
L’Espagne fut la destination de nombreux voyages d’étude d’écrivaines françaises telles que Madame d’Aulnoy et la jusque-là peu connue Catherine Bernard, qui, dans son roman Inès de Cordue (1696), rédigea la première version du conte Riquet à la houppe (1697), aujourd’hui attribué à Perrault. Toujours en Espagne, Cecilia Böhl de Faber, sous le pseudonyme masculin « Fernán Caballero », rassembla et écrivit au début du XIXᵉ siècle les premiers contes populaires espagnols dans Cuentos y poesías andaluces (1859) et Cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes populares (1877), non sans subir l’« influence italienne » et « française » des contes des Grimm, qu’elle connaissait par ses racines allemandes.
De plus, les textes de contes espagnols ne s’intègrent pas seulement à la tradition européenne du conte, mais aussi à la tradition « orientale » en raison de l’influence « maure » séculaire dans le sud de l’Italie et sur la péninsule ibérique. Celle-ci a d’ailleurs durablement marqué la tradition française du conte, puisque c’est l’orientaliste parisien Antoine Galland qui traduisit pour la première fois, au début du XVIIIᵉ siècle, le recueil des « 1001 Nuits » en langue européenne, en l’occurrence en français, et l’a « transformé à la manière franco-occidentale » (Grätz 1995, p. 7).
Ces exemples illustrent l’extrême complexité du phénomène transroman du transfert culturel des contes. L’objectif du colloque est d’étudier et de discuter, dans une perspective comparatiste, les processus réciproques et jusqu’à présent inexplorés de migration, d’adaptation et de réception des thèmes et motifs des contes dans l’entangled history entre l’Espagne, l’Italie et la France ainsi que l’Allemagne voisine.
—
Nos invitons à nous envoyer un résumé de 350-400 mots avant le 30 novembre 2025 au plus tard. Veuillez envoyer votre résumé avec un bref CV à selina.seibel@ilw.uni-stuttgart.de et wiemer@uni-wuppertal.de. Les frais de déplacement et d'hébergement peuvent probablement être pris en charge.
—
Questionnements possibles
Les contes comme miroir des structures et changements sociaux : Quels contextes politiques, sociaux ou économiques influencent les traditions nationales des contes et les voyages transnationaux des contes dans la Romania ? Quelles matières et quels motifs sont spécifiques aux processus de transfert culturel entre l’Italie, la France et l’Espagne (ainsi que l’Allemagne) ? Peut-on identifier certaines matières ou figures – p. ex. la bonne fée, le hideux animal groom – comme particulièrement mobiles et malléables dans l’échange interculturel ? Quelles actualisations, par exemple dans le domaine des Queer et Disability Studies, reçoivent-ils et à quels contextes sociopolitiques et culturels cela renvoie-t-il ?
Contes et mutations médiatiques : Comment la réception des contes a-t-elle évolué avec leur adaptation dans différents formats oraux et écrits, aussi en ce qui concerne la narration multimodale ? Dans quelle mesure la poétique, la fonction et la forme esthétique du conte changent-elles au fil de ses adaptations dans divers formats médiatiques – de la culture orale de narration aux fixations littéraires, jusqu’aux représentations multimodales et digitales (film, roman graphique, jeu vidéo, publicité, réseaux sociaux, IA) ? Quelles transformations poétologiques, narratives, affectives et idéologiques subissent les matières, tant dans des adaptations médiatiquement dominantes comme celles de la Walt Disney Company (Sleeping Beauty, Tangled) que sous l’influence de l’IA, qui peut raconter des contes nouveaux et différents ?
Perspectives postcoloniales : Quel rôle jouent les récits coloniaux et « orientalistes » dans la tradition transromane des contes (Lau 2025), y compris dans l’espace culturel francophone et latino-américain ? Comment les représentations de l’altérité, par exemple dans les Contes marins de Villeneuve et le Magasin des enfants de Beaumont, façonnent-elles les espaces et les personnages secondaires ? Comment se configure la réception de Les Mille et Une Nuits ou de contes avec des topos « orientaux » (par ex. animaux exotiques parfois anthropomorphisés, pratiques culturelles et artefacts, origine des personnages) ? Quels « colonial encounters » (Sago 2021) peut-on également reconnaître dans les cadres narratifs ? Dans quelle mesure la présence de motifs narratifs Ladino ou judéo-séfarades peut-elle être interprétée comme l’expression de zones de contact transculturelles (Pratt 1991), en particulier dans le contexte napolitain ou ibérique ?
Oralité et transfert culturel : Dans quelle mesure la transmission orale des contes influence-t-elle leur migration transculturelle entre l’Italie, la France et l’Espagne ? Comment la structure narrative change-t-elle lorsque les contes passent d’une tradition orale à une fixation écrite, en particulier dans le contexte du transfert transroman des contes fondés sur l’origine latine commune ? Comment la position de l’instance narrative est-elle transformée par le déplacement médiatique de l’oralité vers l’écrit ? Comment se construit la mise en scène auctoriale dans des textes comme Lo cunto de li cunti de Basile, les contes de Perrault ou les contes de fée de d’Aulnoy – et comment ces mises en scène recourent-elles à des conventions rhétoriques qui imitent autant qu’elles contrôlent des formes orales traditionnelles ? Comment la fixation écrite de matières transmises oralement établit-elle un nouvel ordre narratif, qui s’opère souvent par l’insertion du récit dans un cadre ou une situation narrative métadiégétique ? Quelle fonction le cadre narratif comme la cour, le salon ou l’école, assume-t-il dans ce processus ?
Le voyage des personnages dans la genèse de la narration : Quels espaces et quelles frontières sémantiques (Lotman 1972) traversent-ils ou franchissent-ils ? Ces espaces sont-ils transformés, stabilisés ou contrariés ? Comment ces espaces se modifient-ils lorsque les matières de contes elles-mêmes voyagent géographiquement et temporellement ? Dans quelle mesure les crises économiques et politiques telles que les guerres ou les famines influencent-elles les espaces de voyage des contes ? Dans quelle mesure le voyage peut-il même être compris comme une poétique des récits merveilleux, qui évoque sur le plan thématique et structurel une dynamique quasi rituelle entre separation, liminality et reincorporation (van Gennep 1909) ?