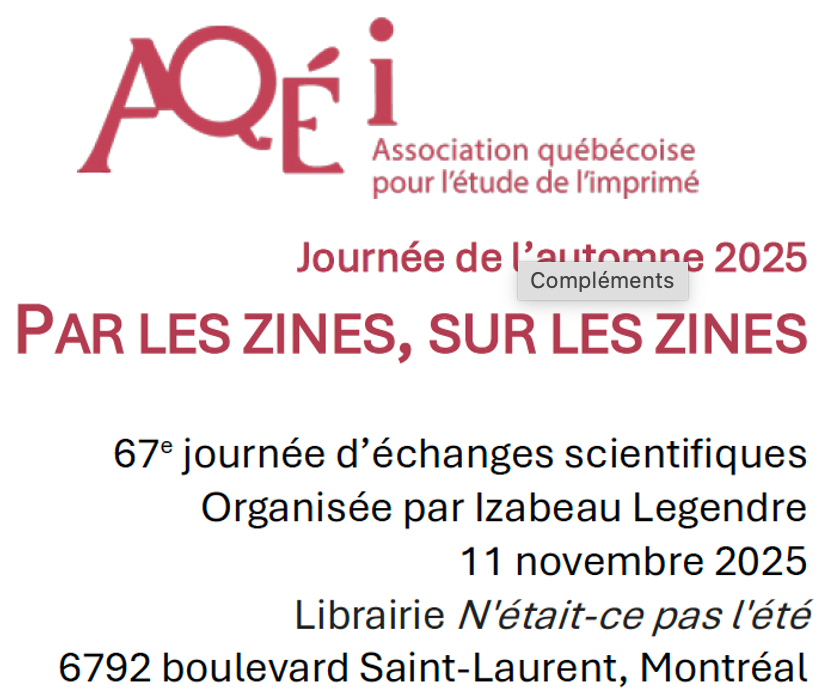
Par les zines, sur les zines. 67e journée d’échanges scientifiques, Association québécoise pour l’étude de l’imprimé AQÉI (Montréal)
PAR LES ZINES, SUR LES ZINES
67e journée d’échanges scientifiques
Organisée par Izabeau Legendre
11 novembre 2025
Librairie N'était-ce pas l'été
6792 boulevard Saint-Laurent, Montréal
—
En parallèle de la 24e édition du festival Expozine cet automne, l’AQÉI propose une journée d’échanges scientifiques portant sur le phénomène du zine. Nous souhaitons faire le point sur l’objet zine lui-même, sur son cycle de vie et ses fonctions multiples; mais aussi plus largement sur les processus dynamiques unissant le « centre » éditorial et artistique et ses « marges ».
Contexte
La recherche sur les zines n’est déjà plus l’affaire d’une ou deux personnes, comme en témoignent les initiatives locales, nombreuses : le colloque « Regards sur les scènes du zine et de l’édition alternative » organisé par le CRILCQ en 2022 (Forget et St-Amand, 2023) succédait à des recherches plus topiques s’accumulant depuis une vingtaine d’années, comme le projet Mobilivre (St-Amand et Pourtavaf, 2003), l’analyse de la presse musicale alternative France-Québec (Hein, 2005), puis de la scène musicale anglophone (Stahl, 2007), l’étude des zines féministes (Pagé, 2014), celle des zines de bande dessinée durant la grève étudiante de 2012 (Rannou, 2020), etc. À ces regards critiques s’annexent une recherche et un appareil de commentaires « endogènes » (Radway, 2011; Bréan, 2012) – c’est-à-dire produits dans les zines, sur les zines.
En dépit de cette effervescence et de cette autonomisation, les zines paraissent assujettis aux pratiques plus organisées. N’offrent-ils pas une rampe d’accès vers l’édition conventionnelle ? C’est en tout cas une idée explorée par Fabien Hein (2006), réfléchissant à la presse musicale alternative :
On peut donc imaginer sans peine que le fanzine soit un laboratoire d'acquisition des compétences et dans le même temps, qu'il puisse constituer une passerelle ou un tremplin […]. Car éditer un fanzine permet de capitaliser un savoir-faire éventuellement valorisable et transférable dans des sphères d'activités rédactionnelles de type commercial (p. 91).
On conçoit plutôt bien que les pratiques éditoriales alternatives conduisent des personnes créatrices à se faire un nom ou un style, mais nous croyons que ces fonctions d’incubation masquent d’autres processus par lesquels les zines et autres objets semblables ont un impact sur l’édition traditionnelle et l’univers social. L’événement accueillera des réflexions et des études de cas permettant de rendre compte des rôles moins connus (et plus puissants?) des zines dans divers secteurs de l’édition et hors de celle-ci.
Les propositions pourront s’inscrire dans l’un des deux axes suivants, sans s’y restreindre :
Les ZINES comme moteurs artistiques et éditoriaux
S’arrêtant sur quelques exemples, on voit bien que le zine soutient une foule de productions et domaines plus ou moins traditionnels, de manière éclatante ou discrète :
la science-fiction : pensons à l’histoire remarquable de Requiem / Solaris depuis 1974 et son rôle essentiel dans la constitution d’un champ de la science-fiction au Québec (Painchaud, 1989);
l’édition en bande dessinée, où la publication de zines a accompagné la naissance de maisons d’édition (Rannou, 2023), et sert encore aujourd’hui d’espace d’expérimentation et de voie d’accès à l’édition professionnelle (Legendre, 2022) ;
la poésie : le Québec se démarque d’ailleurs sur ce point, qu’on pense à l’imposant corpus de Steak haché (1998-2007) (Tillard, 2023) ou à la trajectoire impressionnante des auteur·ices des éditions En Jachère, par où sont passé·es les poètes Jonas Fortier et Névé Dumas (Beaulieu-April, 2024) ;
le domaine du design graphique, où les zines ont accueilli des chantiers majeurs ces dernières années, comme celui de la typographie non binaire et inclusive (Walter, 2023) ;
le domaine des arts visuels, où les zines ont contribué au renouveau du livre d’artiste et des arts imprimés (Lefebvre, 2024) ;
l’édition queer (Bronson et Aarons, 2008) et transféministe (Lefebvre, 2023), où les zines suppléent à l’édition conventionnelle tout en servant d’espace de contestation de ses pratiques d’exclusion.
Les ZINES comme vecteurs de communication et de cohésion
Les zines ne sont pas pour autant confinés au monde de l’édition mais sont mobilisés dans un nombre toujours grandissant de contextes :
le contexte scientifique, comme outil favorisant la diffusion des recherches – c’est le cas du Small Science Collective aux États-Unis – voire comme vecteur de communautés de pratiques axées sur la recherche, notamment dans le cadre des projets Acazine et Comme-un-fanzine en France ;
le contexte pédagogique, où les ateliers de création et l’utilisation des zines en soutien à l’apprentissage se multiplient (Thomas, 2018), et où le médium s’intègre au répertoire des enseignant·es du primaire et du secondaire (Alloprof, 2025) ;
les milieux communautaires et militants, où le zine sert de liant, comme le font les zines Debouttes et à boutte de La Marie Debout, centre de femmes du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal (2025) et Awoueille, zine bimestriel d’Effervescence Citoyenne (depuis 2023) ;
les bibliothèques et les archives, finalement, où les collections se multiplient en milieu universitaire (Université du Québec en Outaouais; Université de Montréal), dans les bibliothèques publiques (Bibliothèques de la ville de Montréal; Bibliothèque Gabrielle-Roy) et même à la Bibliothèque nationale, s’ajoutant à de nombreux efforts de préservation par des acteur·ices du milieu (ARC MTL, DIRA, La Mandragore, Archives révolutionnaires, Dick’s, le Labo de zinologie, etc.).
—
Les propositions de communications (court résumé, notice biobibliographique) devront être envoyées à izabeau.legendre@gmail.com avant le 24 octobre 2025.
Les communications devront avoir une durée de 20 minutes et seront suivies d’échanges.
Les personnes dont les propositions seront retenues devront être membres de l’AQÉI au moment de l’événement. La journée d’échanges sera ouverte aux non-initié·es et aux curieux·euses.
—
Orientations bibliographiques
Alloprof. 2025. « Intégrer les zines en classe : renforcer les apprentissages de façon ludique », Alloprof Enseignants : https://www.alloprof.qc.ca/fr/enseignants/ ressources-pour-enseigner/integrer-les-zines-en-classe-renforcer-les-apprentissag es-de-facon-ludique-z0256.
Beaulieu-April, Joséane. 2024. « Créer en commun et travailler ensemble : étude sémiotique de la forme de vie du contemporain à La Tournure, La Jachère, et La Passe », thèse doctorale, Université du Québec à Montréal.
Bréan, Simon. 2012. « Les érudits de la science-fiction en France, une tradition critique endogène. » ReS Futurae : Revue d’Études sur la Science-fiction, no 1 (octobre) : 1–20.
Bronson, AA, and Philip Aarons. 2008. Queer Zines. New York : Printed Matter.
Forget, Benjamin, and Karolann St-Amand. 2023. Regards sur les scènes du zine et de l’édition alternative. Montréal : Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ). https://crilcq.org/publications/ collections/nouveaux-cahiers-de-recherche/regards-sur-les-scenes-du-zine-et-de-l-edition-alternative/.
Hein, Fabien. 2006. « Le critique rock, le fanzine et le magazine. “Ça s’en va et ça revient” » Volume ! La revue des musiques populaires vol. 5, no 1: 83–106.
Lefebvre, Antoine. 2024. Print-It : ARTZINES Adventures, Print-It : L’aventure ARTZINES. Paris : Antoine Lefebvre éditions.
Lefebvre, Judith. 2023. On ne peut pas écrire transféminisme sans transfem, Montréal : Autoédité.
Legendre, Izabeau. 2022. La scène du zine de Montréal. Montréal : AURA éditions.
Painchaud, Rita. 1989. « La constitution du champ de la science-fiction au Québec:(1974-1984) », thèse doctorale, Université du Québec à Trois-Rivières.
Radway, Janice. 2011. « Zines, Half-Lives, and Afterlives: On the Temporalities of Social and Political Change », PMLA, vol. 126, no 1 : 140–50.
Rannou, Maël. 2020. « La bande dessinée durant le Printemps érable (2012), un outil de diffusion et de mobilisation pour une lutte en cours », Le Temps des médias, no 35: 54–71.
Rannou, Maël. 2023. « Pow Pow, itinéraire d’un éditeur quadricéphale », Revue française d’histoire du livre, vol. 143 (janvier) : 71–82.
Stahl, Geoff. 2007. « Musicmaking and the City. Making Sense of the Montreal Scene. » Popular Musik Forschung, no 35: 141–59.
St-Amand, Isabelle, and Leila Pourtavaf. 2003. « Le projet MOBILIVRE-BOOKMOBILE : histoire d’une bibliothèque itinérante », Argus. La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire, vol. 32, no 3 : 35–40.
Thomas, Susan. 2018. « Zines for Teaching: A Survey of Pedagogy and Implications for Academic Librarians », Portal: Libraries and the Academy, vol. 18, no 4: 737–58.
Tillard, Patrick. 2023. « 109 numéros, 700 collaborateurs: Steak Haché contre “le docte pouvoir” et les “poèmes-parking” », dans Existe-t-il une littérature québécoise contre les chaises berçantes ? Montréal : Éditions de la rue Dorion.
Walter, Louise. 2023. « La typographie inclusive : émergences, usages et circulations dans les espaces francophones (2017-2023) », mémoire de maîtrise, Université Paris Nanterre.