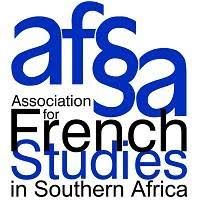
Écologies relationnelles dans les études françaises et francophones. 28e Congrès de l’AFSSA (Prétoria, Afrique du Sud)
Appel à communications
28e Congrès biennal de l’AFSSA
Université de Pretoria, Pretoria, Afrique du Sud, En collaboration avec l'université du Witwatersrand
14-16 septembre 2026
Date limite de soumission des résumés : 1er février 2025
Écologies relationnelles dans les études françaises et francophones
Invitée d’honneur : Véronique Tadjo
Les écologies relationnelles s’inscrivent d’emblée dans une perspective interdisciplinaire. Elles se situent à la conjonction des études anthropologiques, sociologiques, philosophiques, écologiques, littéraires, linguistiques, artistiques et autres, pour appréhender les multiples interconnexions entre les êtres vivants humains et les non-humains, et entre des contextes sociaux variés. Si Glissant (1990) nous a déjà incités à repenser l’identité dans un contexte relationnel, les deux termes – écologies et relations – pris séparément ont suscité ces dernières années de nombreux débats dans les sphères politiques, les sociétés civiles, les universités et les médias des pays francophones et au-delà. C’est qu’ils sont au coeur des enjeux sociopolitiques, géopolitiques, diplomatiques de notre monde postcolonial. L’adjonction pléonastique des deux termes mis en exergue révèle que l’écologie à elle seule est relationnelle. Cependant, ils expriment un enjeu de taille : qu’il ne s’agit pas que d’urgences environnementales mais aussi de mise en lumière de modes d’appréhension du monde et de propositions subjectives que prennent les joies de l’activité créatrice, les formes de résistances et de résiliences multiples, les modes de réparations de la nature (Ferdinand 2024), des sujets affligés par la maladie, le deuil, la dépossession, le dénuement, etc., ou simplement préoccupés par la mise en oeuvre de formes spécifiques de liberté, de justice et d’égalité. Les écologies relationnelles traitent ainsi de la question de l’organisation des collectifs au niveau biophysique et social. Elles se préoccupent de la diversité et du vivre ensemble dans la différence et des interrelations et des positions des individus et des groupes sociaux dans une perspective politique (Foucault 2001), écosophique (Guattari 2013), philosophique (Gefen & Laugier 2020 ; Rancière 2007, 2017), phénoménologique (Levinas 2011), esthétique (Gefen & Laugier 2020 ; Bourriaud 1998), etc.
Dans le domaine des études littéraires, l’écocritique interroge les intersections entre la nature et l’être humain pour appréhender, entre autres, la détérioration des écosystèmes à partir de nouvelles formes esthétiques et d’imaginaires. Ainsi, se sont développées des gaïagraphies, modes d’écriture et de narrations de la Terre comme ayant une subjectivité propre, des intérêts propres et une agentivité à restaurer. Ces écritures inventent de nouvelles manières de vivre ensemble au travers de l’esthétique. Elles entendent sortir la nature de son statut d’objet en recréant la communauté manquante qui lie la Terre aux êtres vivants humains et non-humains (Latour 2015 ; Descola 2019). De même, les littératures portant sur la migration touchent de près aux écologies relationnelles en tant que systèmes d’interdépendance sociaux et moyens de reconfigurations identitaires, éthiques et politiques. Elles proposent de ce fait une écriture du vivant qui examine les enjeux inhérents aux déplacements de populations à travers la planète : l’accueil (l’espace, le territoire et le lieu), les formes de violence, l’identité nationale ou individuelle, le droit (Nouss 2021 ; Bessière 1999), les pratiques solidaires, les phénomènes métasporiques, etc.
L’écolinguistique (Calvet 1999) et plus récemment l’intégration des principes écologiques dans l’enseignement et l’apprentissage des langues (Kramsch 2008, van Lier 2010) proposent un cadre de réflexion sur les réalités contextuelles des phénomènes sociolinguistiques, tout en soulignant leur interconnection, interdépendance et mutualité. Cette perspective met en cause la standardisation linguistique et les approches traditionnelles de l’enseignement en faveur des pratiques personnalisées adaptées au contexte et en prenant en compte divers facteurs socioculturels. La prise en compte des différences individuelles et culturelles s’élargit dernièrement au paradigme de la neurodiversité, appréhendée comme une manifestation naturelle de diversité génétique (Chapman 2020) et qui nous incitent à repenser l’altérité, le rapport à l’autre et l’apprentissage atypique. Enfin, il semble incontournable de sonder l’impact des nouvelles technologies et des outils de l’intelligence artificielle sur les écologies relationnelles dans les espaces numériques et en ce qu’elles reconfigurent les rapports au sein du triangle didactique et les pratiques des professionnels de langue.
Le champ de « l’écotraduction » et le lien entre le savoir écologique et la traduction suscitent actuellement de nombreux débats autour des notions de l’écopoétique, la traduction « durable » ou « l’écologie du traduire » (Samoyault 2024) et nous invitent à réfléchir sur des questions éthiques relationnelles et environnementales de la traduction telles que « la question du genre » (Guest 2024).
Les écologies relationnelles ne sauraient être envisagées comme des configurations neutres ; elles sont traversées par des dynamiques postcoloniales, culturelles et géopolitiques complexes. Elles s’articulent selon des régimes esthétiques et politiques hétérogènes, mobilisant des notions telles que la résilience, la résistance, la réparation ou encore une éthique de la joie.
Nous invitons dès lors les chercheurs intéressés par ces questions à contribuer à une réflexion sur la pluralité des déclinaisons que les écologies relationnelles suscitent dans les domaines des études littéraires, de la didactique des langues et de la traductologie.
Les axes thématiques comprennent, sans s’y limiter, les sujets suivants :
- Enjeux politiques et éthiques des relations sociales
- Expériences sensibles et éthique du soin (care)
- Écritures et esthétiques relationnelles
- Déconstruction de l’anthropocentrisme
- Fictions de l’entropie ; Écritures de la néguentropie
- Approches autochtones et décoloniales
- Pédagogies relationnelles et écologiques
- Ecologies numériques et apprentissage des langues
- Ecologies cognitives et apprentissage des langues
- Mobilités géographiques (enracinerrance ; diasporas et métasporas)
- Actes et modes de résilience, de réparation et de résistance
- Intelligence artificielle et fictions ; intelligence artificielle et pédagogies ; intelligence artificielle et écologies
- L’écotraduction et l’éthique environnementale de la traduction
—
Les propositions de communication devront comporter entre 250 et 300 mots. Elles seront accompagnées d’une notice biographique succincte, n’excédant pas 150 mots. L’ensemble est à envoyer à l’adresse suivante : annamarie.debeer@up.ac.za.
—
Bibliographie :
Bessière, Jean et Moura, Jean-Marc. 1999. Littératures postcoloniales et représentations de l’ailleurs. Afrique,
Caraïbe, Canada. Conférences du séminaire de littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle. Paris :
Honoré Champion.
Calvet, Jean-Louis. 1999. Pour une écologie des langues du monde. Paris : Plon.
Chapman, Robert. 2020. “Defining Neurodiversity for research and practice”. In Neurodiversity studies. A New critical paradigm. Edited by Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Nick Chown and Anna Stenning. Routledge.
Ferdinand, Malcom. 2024. S’aimer la terre : Défaire l’habiter colonial. Paris : Seuil.
Foucault, Michel. 2001. Dits et écrits, I (1954-1975). Paris : Gallimard.
Gefen, Alexandre et Laugier, Sandra. 2020 Le pouvoir des liens faibles. Paris : CNRS Éditions.
Glissant, Édouard. 1990. Poétique de la Relation. Paris : Gallimard.
Guattari, Félix. 2018. Qu’est-ce que l’écosophie ? textes présentés par Stéphane Nadaud. Éditions Lignes/ Poche.
Guest, Bertrand. 2024. « Vers une extension herméneutique : pour traduire « la nature », décoloniser les signes ». Littérature. 216(4) : 27-40.
Kramsch, Claire. 2008.“Ecological perspectives on foreign language education”. Language Teaching 41(3): 308-408.
Latour, Buno. 2015. Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique. Paris : Éditions La Découverte.
Levinas, Emmanuel. 2011. « Les Nourritures ». In R. Calin et C. Chalier (dir.). Parole et Silence et autres conférences inédites au Collège philosophique (OEuvres 2). Paris : Grasset – IMEC.
Nouss, Alexis. 2021. Droit d’exil. Pour une politisation de la question migratoire. Paris / Dijon : Éditions MIX.
Rancière, Jacques. 2007. Politique de la littérature. Paris : Éditions Galilée.
– 2017. Les bords de la fiction. Paris : Éditions du Seuil.
Samoyault, Tiphaine. 2024. « La traduction durable ». Littérature. 216(4) : 41-54.
van Lier, Leo. 2010. “The ecology of language learning : Practice to theory, theory to practice.” Procedia - Social and Behavioral Sciences. 3: 2-6.
—
Comité d’organisation :
Anna-Marie de Beer (University of Pretoria)
Fiona Horne (University of the Witwatersrand)
Emmanuel Mbégane Ndour (University of the Witwatersrand)
Carina Steenekamp (University of Pretoria)
—
Comité scientifique :
Markus Arnold (University of Cape Town)
Albertus Barkhuizen (University of the Free State)
Sarah Davies Cordova (University of Wisconsin-Milwaukee)
Anna-Marie de Beer (University of Pretoria)
Bernard De Meyer (University of Kwazulu-Natal)
Catherine du Toit (Stellenbosch University)
Karen Ferreira-Meyers (University of Eswatini)
Carina Grobler (North West University)
Fiona Horne (University of the Witwatersrand)
Abdoulaye Imorou (Université du Ghana)
Emmanuel Mbégane Ndour (University of the Witwatersrand)
Céline Peigné (Institut National des Langues et Civilisations Orientales [Inalco])
Karel Plaiche (University of Cape Town)
Carina Steenekamp (University of Pretoria)
Alexandra Stewart (University of Kwazulu-Natal)