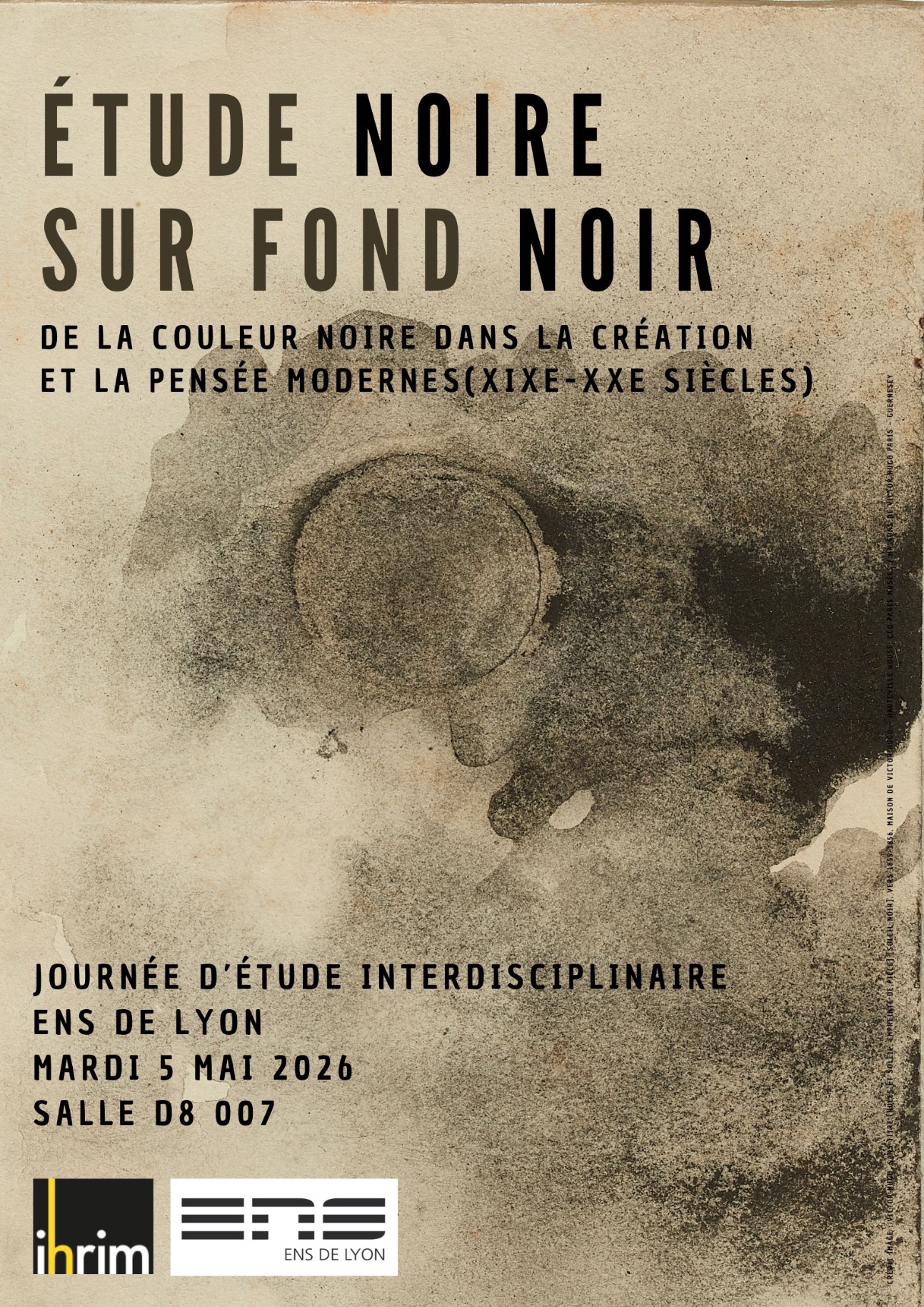
Étude noire sur fond noir. De la couleur noire dans la création et la pensée modernes, XIXe-XXe s. (ENS de Lyon)
Étude noire sur fond noir. De la couleur noire dans la création et la pensée modernes (XIXe-XXe siècles)
Appel à communications
Journée d’étude interdisciplinaire littérature, philosophie, histoire de l’art.
ENS de Lyon, mardi 5 mai 2026.
« Je passe ma vie dans le noir et quand dans ce noir je commence à écrire – je ne trouve que la lumière, partout la lumière », écrivit Christian Bobin à propos de son processus créateur (Bobin 2019, 36). La couleur noire, lue comme une grille d’interprétation du moderne, incarnerait l’espace monochrome de la création, interrogeant ses moyens et ses limites, tout en devenant une ressource privilégiée de nouvelles illuminations.
Au milieu du XIXe siècle, le narrateur du Promontoire du songe déclare d’abord qu’il « ne voi[t] rien » face à la « plénitude du noir » (Hugo 2002, 640), décrivant un sentiment d’enfermement dans un hermétisme apparemment stérile, symptomatisé par la couleur noire. La saturation du noir, livrant à la privation sensorielle, semble couper court au discours. Les œuvres des poètes, artistes et penseurs modernes mettent pourtant au jour un chemin à travers cette stérilité, un travail de la limite ouvrant à la possibilité d'une étude noire sur le fond noir de la modernité. En résultent des tentatives variées de repousser les frontières de la créativité, dont cette journée d’étude s’attachera à étudier les modalités.
Le noir est travaillé en tant que matière par les artistes modernes et contemporains. Il est moteur d’une réflexion sur le contraste, les formes, le pigment (le noir absolu d’Anish Kapoor), ou encore l’épaisseur et le relief. Cette question est d’actualité : deux expositions en cours consacrées à Pierre Soulages s’intéressent aux matières noires utilisées par le peintre, du brou de noix (« Soulages, une autre lumière » au Musée du Luxembourg) au goudron (« Pierre Soulages, la rencontre » au Musée Fabre). Loin de représenter un obstacle pour la pensée, la négation de toute visibilité se révèle stimulante jusqu’à révéler une lumière inédite, nommée « outrenoir » par Soulages. La négativité critique du noir, « la couleur qui s’oppose le plus à tout ce qui l’entoure » (Soulages dans Meschonnic 2000, 183), est gage d’une opposition dynamique. Ce travail sensible rend féconde l’indétermination que représente la couleur noire : ainsi, les Black Paintings d’Ad Reinhardt jaillissent du « pas-encore d’une intention non résolue » (Boehm 2012, 84).
En poésie, l’opacité impénétrable du noir est moteur d’un élan créatif sur le plan symbolique. Elle est synthétisée par l’image du gouffre qui, tout en représentant un danger de liquidation, devient le lieu de régénération de l’écriture et des images poétiques. Le gouffre noir est chez Baudelaire le seul lieu susceptible de générer « du nouveau » (Baudelaire 2019, 186), avant que Michaux ne vante la « connaissance par les gouffres » (Michaux 1961). René Char, dans ses Feuillets d’Hypnos, synthétise cette dynamique paradoxale : « la couleur noire renferme l’impossible vivant. Son champ mental est le siège de tous les inattendus, de tous les paroxysmes » (Char 1967, 147). Si l’opacité du noir cristallise le sentiment d’impossibilité, elle renferme un caractère inouï qui ravive la création. C'est en vertu d'une telle puissance que le surréalisme choisit de se tourner « au plus noir de la conscience » (Breton dans Angenot 1972, 189) ou « au plus noir [du] cœur » (Éluard dans Ibid.). Ouvrant à des horizons « inattendus », la couleur noire renouvelle le champ de la parole en liant l’écrit et le visuel, jusqu’à devenir un langage à part entière, voire à se substituer au langage : le poète et plasticien Bernar Venet en fait un signifiant absolu dans son Livre noir entièrement composé de pages noires.
Entre matière et abstraction naît ainsi une variété de « discours sur le noir » (Meschonnic 2000, 187), dont l’articulation est également mise en évidence dans les différents domaines de la philosophie. Tandis que le noir, d’un point de vue ontologique, peut représenter ce qui ne cesse de se dérober, un Abgrund (Heidegger), il est tout autant l’occasion d’une extension du domaine épistémique. Face aux toiles noires du peintre Jean-Michel Atlan, Derrida reconnaît l’échec du langage. Cependant, cette aphasie génère la tentative de créer de nouveaux référents, et enrichit le discours herméneutique (Derrida 2013, 232-234).
Alors que la couleur noire semble absorber toute autre forme d’expression, comment les poètes, artistes et penseurs modernes s’en servent-ils comme d’un levier de création ? De quelle manière cette articulation paradoxale entre opacité et créativité ouvre-t-elle vers de nouveaux champs d’expérimentations et de nouveaux discours théoriques ?
Nous accueillons les propositions de doctorant.e.s, jeunes chercheur.euse.s et chercheur.euse.s confirmé.e.s. en littérature, philosophie et histoire de l’art.
Axes possibles :
- La confrontation de l’artiste à la couleur noire, le paradoxe créateur qui en découle.
- Poétique de la couleur noire, dire le noir, le noir comme langage.
- La matérialité du noir opaque et le travail de la matière.
- Lumières du noir.
- La valeur épistémique du noir.
- La dimension transgressive du noir (entre langage et image, intelligible et sensible).
- Le pouvoir éversif du noir dans la logique iconique.
—
Les propositions de communication doivent nous parvenir en format .doc ou .pdf au plus tard pour le 15 novembre 2025. Les fichiers doivent contenir : nom, affiliation académique, bref CV (max. 700 signes espaces inclus), domaine(s) disciplinaire(s) où la communication s’insère, titre et résumé de la communication (max. 2000 signes espaces inclus).
Merci d’envoyer les propositions à l’une des adresses suivantes :
anita.merlini@uniud.it
sol.jait_sola@ens-lyon.fr
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
—
Bibliographie indicative
ANGENOT Marc, « Le Surréalisme noir », Les Lettres Romanes, vol. 26, n°2, Louvain, Université Catholique de Louvain, 1972, p. 181-193.
BOEHM Gottfried, Der Grund. Über das ikonische Kontinuum, dans G. Boehm, M. Burioni (éd.), Der Grund. Das Feld des Sichtbaren, München, Wilhelm Fink, 2012, p. 29-94.
DERRIDA Jacques, Penser à ne pas voir. Écrits sur les arts du visible 1979-2004, Paris, Éditions de la différence, 2013.
EDWARDS-DUJARDIN Hayley, Noir. Des grottes de Lascaux à Pierre Soulages, Paris, Éditions du Chêne, « Ça c’est de l’art », 2020.
LAVANDIER Marie, GUÉPRATTE Juliette, PIRALLA-HENG VONG Luc, Soleils noirs, Paris, Liénart, Louvre-Lens, 2020.
LE BRUN Annie, Les arcs-en-ciel du noir : Victor Hugo, Paris, Gallimard, « Arts et artistes », 2012.
MESCHONNIC Henri avec SOULAGES Pierre, « Un noir lumière », Le rythme et la lumière, Paris, Odile Jacob, « Hors Collection », 2000.
MOLLARD-DESFOUR Annie, Le Noir. Dictionnaire des mots et expressions de couleur. XXe – XXIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2010.
PASTOUREAU Michel, Noir. Histoire d’une couleur, Paris, Éditions du Seuil, 2008.
SOULAGES Pierre, Écrits et propos, Paris, Éditions Hermann, 2009.