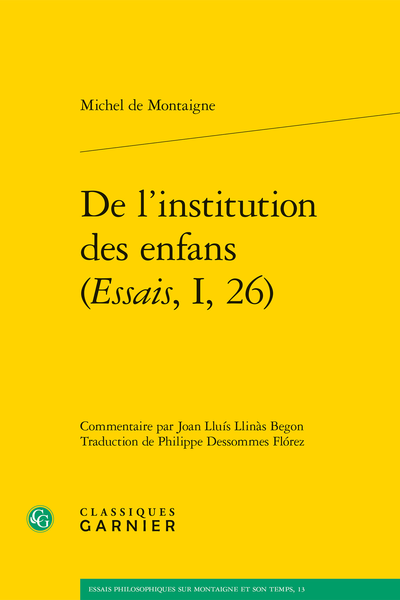
Le chapitre « De l’institution des enfans » pose les fondements d’une nouvelle démarche éducative, destinée à former le jugement de l’élève. Montaigne vise moins ici à définir une réforme des programmes pédagogiques qu’à montrer l’importance de la formation du jugement dans la formation de soi.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos 7
Introduction 9
La production du chapitre 9
Un chapitre au style disparate ? 12
Un chapitre bien structuré ? 14
Une éducation sans religion ? 18
Un chapitre uniquement sur l’éducation ? 21
Des idées actuelles sur l’éducation ? 23
ESSAIS,
LIVRE I, CHAPITRE 26
DE L’INSTITUTION DES ENFANS
De l’institution des enfans 29
Variantes significatives 79
Commentaire 85
Écrire sur l’éducation sans être pédagogue,
produire une écriture sans savoir (l. 1-121) 85
Déclaration d’inscience (l. 1-33) 85
Justification de l’écriture de soi (l. 33-121) 94
Difficulté d’écrire à propos d’éducation (l. 122-188) 99
272
Une dédicace originale (l. 122-135) 99
Influence des inclinations (l. 135-162) 102
Un précepteur d’un genre nouveau (l. 163-199) 107
Exercer sa compréhension (l. 200-299) 110
Critique du savoir reproductif (l. 200-208) 110
Relation précepteur-élève (l. 208-224) 111
Entraîner le jugement pour éviter la soumission
à l’autorité (l. 225-248) 113
Formation du jugement et toute-puissance
de l’entendement (l. 249-299) 118
Acquérir de l’expérience (l. 300-549) 126
Expérience et pratique du monde,
sans les parents (l. 300-365) 126
Règles du commerce des hommes (l. 366-453) 132
Lecture de la vie des grands hommes.
Plutarque et La Boétie (l. 454-497) 138
Fréquentation du monde (l. 498-522) 144
Contemplation du monde (l. 522-549) 148
La philosophie comme discipline essentielle
de l’éducation (l. 549-754) 152
Philosopher pour bien vivre
et bien mourir (l. 549-620) 152
Philosophie comme agréable outil de formation
du jugement (l. 621-669) 160
Philosophie rivée à l’âme et au corps,
vise la vertu (l. 670-738) 165
Philosophie et action (l. 739-971) 180
Philosophie pour la jeunesse (l. 739-781) 180
Lieu de l’éducation : La critique des écoles (l. 782-838) 182
Éducation de l’homme entier (l. 838-849) 184
Éducation par une sévère douceur (l. 850-887) 186
Faire en sorte qu’il puisse
faire toutes choses… (l. 888-941) 189
… et n’ayme à faire que les bonnes (l. 909) 191
Une éducation par le rapport entre l’action
et le langage (l. 942-1173) 196
273
Faire et dire : la vie comme un miroir (l. 942-972) 196
Supériorité des actes sur les paroles (l. 972-1001) 202
Interaction entre les paroles et les actes (l. 1001-1059) 203
Conceptions de la philosophie, conceptions de la vie :
la réflexion sur la poésie (l. 1059-1089) 209
Périls du langage
et vagabondage de la pensée (l. 1090-1114) 212
Tout langage sert (l. 1114-1118) 215
Style et éducation (l. 1118-1162) 217
Langage et société :
vers une nouvelle rhétorique (l. 1163-1173) 227
L’éducation de Montaigne, un modèle d’éducation
par l’appétit et l’affection ? (l. 1175-1383) 231
Langue et communication.
À propos du latin et du grec (l. 1175-1237) 231
Sur l’éducation de Montaigne (l. 1237-1286) 237
Sur l’importance du caractère et du regard des autres
au processus formatif et littéraire (l. 1287-1342) 239
Utilité du théâtre : son rôle social (l. 1343-1377) 247
Allécher l’appétit et l’affection (l. 1378-1383) 250
Remerciements 255
Bibliographie sélective 257
Index nominum 267