par Marc Escola
(Université de Lausanne)
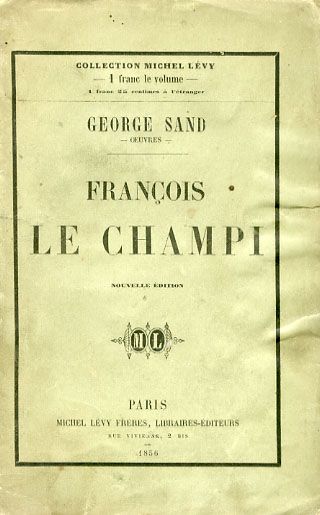
Une première version de ce texte est paru dans Le Magazine littéraire, n° 553, été 2013.
Dossier Intertextualité.
La cause est entendue, et nous devrions tous plaider coupables : il n'est de lecture qu'infidèle, et le lecteur le plus authentique est celui que sa passion subjugue au point de trahir son objet, sauf à se sentir trahi par lui. Dans des pages célèbres originellement destinées à servir de préface à sa traduction de Sésame et les Lys de J. Ruskin et reprises en 1919 sous le titre « Journées de lecture » dans les Pastiches et mélanges, Proust a admirablement décrit de quelle inévitable déception s'accompagne l'achèvement de toute lecture :
« C'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres (et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle) que pour l'auteur ils pourraient s'appeler “Conclusions” et pour le lecteur “Incitations”. Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses, quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. […] D'ailleurs, si nous leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, nous leur demandons aussi des réponses qui ne nous instruiraient pas. »
Lire passionnément, c'est sans doute s'immerger pleinement dans un monde possible, mais c'est aussi s'émanciper régulièrement de la lettre du texte pour en projeter la suite ou l'imaginer autrement : le vrai lecteur est celui qui sait encore « lever les yeux du livre », selon la formule elle-même heureuse d'un poète — Y. Bonnefoy, dans un article donné en 1988 à la regrettée Nouvelle revue de psychanalyse.
Parce que tout écrivain a d'abord été ce lecteur, l'histoire de la littérature se laisse parcourir comme le catalogue des petites ou grandes infidélités. Lorsqu'ils se font interprètes de leurs prédécesseurs, nos meilleurs auteurs enseignent à l'envi la fécondité du contresens — fût-il volontaire et relevant dès lors non pas tant du malentendu que de la mauvaise foi ; voyez Rousseau contempteur des Fables de La Fontaine au livre II de l'Émile (« Où en sera l'enfant si vous lui apprenez que le renard ne dit sans mentir que parce qu'il ment ? »), ou le même Jean-Jacques censeur du Misanthrope dans la Lettre à d'Alembert sur les spectacles (Alceste est un « homme droit, sincère, estimable, qui déteste les mœurs de son siècle et la méchanceté de ses contemporains » : « il n'y a pas un homme de bien qui ne soit misanthrope en ce sens », et c'est le complaisant Philinte que l'on doit regarder comme « le plus grand ennemi des hommes » : refaites donc sur ces bases un nouveau Misanthrope, « plus juste que l'original ») ; entendez encore Voltaire avocat de notre humanité comparaissant au tribunal de Pascal (« j'ose prendre le parti de l'humanité contre ce misanthrope sublime »), pour inaugurer dans la XXVe de ses Lettres philosophiques une lecture résolument laïque des Pensées sur la religion. Les infidélités du siècle des Lumières ne sont pas seulement celles des libertins : lorsqu'on naît dans l'ombre du Grand siècle, comment grandir sans trahir ? Les « générations » littéraires s'éclairent ainsi à la lueur des testaments trahis.
Et que dire des réécritures ? La logique de la réfection est bien encore celle d'une lecture infidèle, désireuse de faire triompher sa variante dans une nouvelle version de la fabula héritée. Racine est-il bien respectueux de son devancier grec lorsqu'il substitue sur l'autel du sacrifice d'Iphigénie un personnage secondaire au lieu de la biche attendue et en quelque sorte seule « autorisée » ? La Fontaine de son côté, qui fait profession d'avoir seulement mis « en vers français » les Fables d'Ésope, ne s'interdit pas de démentir son illustre prédécesseur, s'agissant par exemple de la supériorité en matière de « matoiserie » accordée au renard sur le loup dans le corpus ésopique (« et j'oserais peut-être / Avec quelque raison contredire mon maître », Le Loup et le Renard, XI, 6) : de fait, le fabuliste français est un peu partout à son modèle ce que le loup est au renard (« je crois qu'il en sait plus… »). Il entre à l'évidence dans toute réécriture une part d'irrévérence juvénile : cela peut aller jusqu'à la jubilation, à l'instar de ces parodies burlesques que sont les Virgile travesti de Scarron ou Télémaque travesti de Marivaux — tous exercices qui ne valent que par le plaisir un peu potache de la désacralisation.
Cela va parfois jusqu'à la profanation : observez plus près de nous le sort dévolu aux maximes des moralistes classiques au sein des Poésies II de Lautréamont (qui regarde comme signe de courage ce que La Rochefoucauld envisageait comme effet de la crainte : « L'amour de la justice n'est, en la plupart des hommes, que le courage de souffrir l'injustice. ») ; ou considérez, dans le chef-d'œuvre de Joyce, ce qu'il advint d'Ulysse confronté, un certain 16 juin 1904 et sans autre talisman qu'une vulgaire pomme de terre au fond de sa poche, à une Circé aussi plantureuse que dominatrice dans un bordel de Dublin.
On peine d'ailleurs à imaginer ce que serait une lecture strictement respectueuse : l'inusable fiction de Borges « Pierre Ménard auteur du Quichotte » illustre, entre autres leçons, l'impossibilité de la tautologie. Si toute lecture transforme ainsi le texte auquel elle s'adonne pour y délivrer quelque texte fantôme, on voudrait voir gravé au fronton de nos bibliothèques et universités l'orgueilleux aphorisme sur lequel G. Genette a choisi de refermer un essai magistral sur la récriture qui se lit aussi comme une théorie de l'histoire littéraire (Palimpsestes, Seuil, 1982) : « Lira bien qui lira le dernier ».
Mais est-ce bien de trahison qu'il convient à chaque fois de parler ? Les exemples qui précèdent relèvent de processus d'appropriation qu'on peut juger plus ou moins légitimes en fonction de l'idée qu'on se fait du « droit de suite », mais ils ne peuvent être dits infidèles que par métaphore : infidèles à quelle promesse au juste ? Un lecteur s'engage-t-il par contrat à obtenir l'aveu de l'auteur pour chacune des significations qu'il découvre dans l'œuvre, et qui donc se trouve habilité à décider de la légitimité d'une lecture en départageant le cas échéant les interprétations divergentes ?
Si l'on tient que toute métaphore boite, et que c'est précisément par là qu'elle a quelque chose à nous apprendre, on peut se demander par exemple ce que serait une lecture adultère. Une réponse possible, et assez inattendue, consisterait à imaginer un lecteur qui prétendrait changer d'auteur comme on changerait de partenaire : pour renouveler ses plaisirs ou connaître d'autres jouissances. Telle est la liberté prise dans deux livres parus chez le même éditeur à quelques années d'intervalle, dont le premier relève de la fiction critique et le second de la critique-fiction : dans Le Vaillant petit tailleur (Minuit, 2003), É. Chevillard dresse le portrait d'un écrivain dont toute l'ambition est de devenir l'auteur qui fait apparemment défaut à l'histoire du tueur de mouches, « enfantée négligemment par l'imagination populaire, soumise à tous les avatars de la tradition orale puis recueillie en ce lamentable état par les frères Grimm », lesquels se sont révélés durablement incapables « d'élever le frêle personnage qui en est le héros au rang de figure mythique » ; dans Et si les œuvres changeaient d'auteur ? (Minuit, 2010), P. Bayard théorise de son côté, en Valmont de la critique littéraire ou en Versac de la poétique, une pratique du changement d'attribution « qui permet de revisiter à moindre frais les grands classiques », en renouvelant notre perception des œuvres : « il n'est que de songer à (relire ?) L'Étranger de Kafka, Autant en emporte le vent de Tolstoï. » La surprise est que la substitution d'auteur s'opère ici comme là dans une forme paradoxale de fidélité : il s'agit bien de continuer à aimer toujours le même livre mais autrement — en se donnant régulièrement de nouvelles raisons d'en jouir.
La véritable trahison ne consisterait-elle pas dès lors, et selon une réponse finalement assez commune, à aimer un livre nouveau au point d'en délaisser un autre auquel on avait promis fidélité ou qu'on s'était promis d'aimer toujours ? Non pas tant assumer un changement de goût, qu'on pourrait encore croire passager (retour de flamme toujours possible), mais accepter de faire le deuil de telle de nos lectures d'enfance, en brûlant ce que l'on a adoré. Là serait sans doute la seule vraie trahison, qui viendrait briser la continuité de notre vie de lecteur — disperser cette bibliothèque que nous sommes. Comment accepter de m'amputer de telle histoire dont je suis depuis toujours le dépositaire : pour aimer Chevillard, devrais-je accepter de renier la Comtesse de Ségur ? Et qui voudrait regretter les larmes versées à la lecture de Sans famille ?
Mettons résolument nos pas dans ceux du narrateur du Temps retrouvé entrant dans la bibliothèque de l'hôtel de Guermantes pour y connaître l'illumination sur sa vie future et l'œuvre à écrire : parmi les « précieux volumes » (leur valeur bibliophilique est d'avance connue par ce qu'en dit le Journal des Goncourt), il y retrouve François le Champi, l'un des quatre romans « champêtres » ou « berrichons » de Georges Sand offerts par sa grand-mère lors d'un séjour à Combray et lu à haute voix telle nuit d'insomnie par sa mère, « lectrice infidèle » qui « passait toutes les scènes d'amour » de ce roman quelque peu incestueux (Du Côté de chez Swann, I, 1). Faut-il se replonger dans ce volume « tiré sans trop y faire attention » des rayonnages du prince de Guermantes et que l'on ouvre d'abord « distraitement » ? D'où vient que la reconnaissance du titre autrefois aimé ne suscite d'abord qu'une « impression désagréable », comme si « un étranger » venait infliger une blessure ?
« Cet étranger, c'était moi-même, c'était l'enfant que j'étais alors, que le livre venait de susciter en moi, car de moi ne connaissant que cet enfant, c'est cet enfant que le livre avait appelé tout de suite, ne voulant être regardé que par ses yeux, aimé que par son cœur, et ne parler qu'à lui. »
On n'a pas assez noté que cette épiphanie s'accompagne d'un singulier interdit — celui de la relecture :
« Si je reprends dans la bibliothèque François le Champi, immédiatement en moi un enfant se lève qui prend ma place, qui seul a le droit de lire ce titre : François le Champi, et qui le lit comme il le lut alors, avec la même impression du temps qu'il faisait dans le jardin, les mêmes rêves qu'il formait alors […]. »
On ne peut continuer à aimer le roman de G. Sand que si l'on s'abstient de le « reprendre » vraiment : c'est à ce prix que le temps de l'enfance peut être retrouvé ; l'ouvrage doit tenir désormais tout entier dans sa « tranche », dans son seul titre, « les livres se comport[a]nt en cela comme des choses » :
« J'aurais trop peur d'y insérer peu à peu mes impressions d'aujourd'hui jusqu'à en recouvrir complètement celles d'autrefois, j'aurais trop peur de le voir devenir à ce point une chose du présent que, quand je lui demanderais de susciter une fois encore l'enfant qui déchiffra son titre dans la petite chambre de Combray, l'enfant, ne reconnaissant pas son accent, ne répondît plus à son appel et restât pour toujours enterré dans l'oubli. »
Que l'interdiction de la relecture soit le gage de la continuité de l'amour que nous portons à un livre, et la condition même de la fidélité à nous-mêmes, tel n'est pas le moindre des paradoxes, théorisé au sein d'une œuvre tout entière programmée pour une relecture.
Depuis combien de temps n'avez-vous pas relu La Chartreuse de Parme ou Belle du Seigneur, dont vous parlez pourtant si souvent comme de romans que vous n'avez jamais cessé d'aimer ? Si même vous les avez relus.
Marc Escola (Université de Lausanne), 2013.
Mis en ligne dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula en novembre 2020.