La référence et l'influence
par Gilles Philippe (Université de Lausanne)
Extrait (Introduction) de French Style. L'accent français de la prose anglaise, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2016, p.5-25.
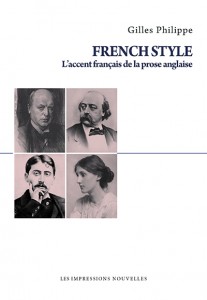
Ce texte est reproduit dans l'Atelier avec l'aimable autorisation de l'auteur et de son éditeur
Dossiers: Histoire, Style, Référence, Influence.
«Je ne lis que du français depuis quatre semaines. Une idée me vient pour un article sur le français; ce que nous en savons.» Cette note du 24 avril 1928 m'intrigue. Car Virginia Woolf ne devait jamais écrire l'article projeté dans son journal, se contentant de donner en février 1929 un joli texte: «On not Knowing French», «Sur l'ignorance du français». Mais si elle avait suivi son idée première, qu'aurait-elle dit? Comment un auteur anglais des années 1920 percevait-il notre langueou la littérature écrite dans notre langue?
C'est à ces questions que ce livre veut répondre. Il essaie à sa façon d'écrire l'article que Virginia Woolf n'a pas écrit. Il prend aussi au sérieux le nous du «nous en savons»: il ne s'agit pas de savoir ce que la romancière savait du français, mais bien ce qu'en savait toute sa génération, la dernière sans doute qui fût d'abord tournée vers la France, avant que la littérature anglaise, comme celle de toute l'Europe, ne regardât vers l'Amérique.
Le retard et la dette
L'enquête qu'on va lire prend cette note de journal comme point de départ et comme point d'arrivée. Pour faire bonne mesure, on arrondira la date à 1930. Cette année-là meurt Charles Kenneth Scott Moncrieff, qui a permis à l'Angleterre de lire Marcel Proust dans sa langue. Mais l'arrondi permet surtout de dépasser l'anecdote: le début des années trente marqua une forte rupture dans l'histoire littéraire anglaise, avec une évidente internationalisation de ses perspectives et surtout une très nette montée des préoccupations politiques et sociales, tant en poésie que dans le roman. Cette date de 1930 est d'ailleurs communément retenue pour noter la fin d'une période de cinquante années, où les historiographes britanniques regroupent les derniers victoriens et les premiers modernistes. Cinquante ans, c'est l'empan nécessaire pour comprendre ce qu'un auteur comme Woolf savait effectivement du français. Nous voici ramenés en 1880: c'est l'année de la mort de Gustave Flaubert et de George Eliot. Virginia Woolf est née en 1882.
Or, pris comme un bloc, ce demi-siècle apparaît d'abord comme le «moment français» de la littérature anglaise. On aura d'ailleurs l'occasion de vérifier que la borne aval est ici encore pertinente: les années 1930 virent un très rapide reflux de l'intérêt pour la langue, la culture et la littérature françaises, reflux en quelque sorte symétrique du mouvement qui, à la fin de l'ère victorienne, avait vu reculer les clichés antifrançais au profit d'une attention de plus en plus vive pour tout ce qui se passait outre-Manche[2]. Bien sûr, l'année 1880 ne marqua en rien le début de l'influence littéraire française en Angleterre (la légende veut par exemple que George Eliot ait choisi son prénom en hommage à George Sand), mais auparavant l'influence avait été symétrique. Pendant cinquante ans, cette symétrie fut rompue: l'Angleterre eut le sentiment d'avoir, face à la France, un retard et une dette.
La dette ne me préoccupera pas d'abord, ou plutôt pas comme telle. Henry James l'a bien résumée en 1899: «Nous devons tous tellement à la France de ces cinquante dernières années que ce serait manquer aux bonnes manières que de laisser passer l'occasion […] de dire notre gratitude[3].» On a longtemps considéré que le retard concernait principalement un genre, le roman, et l'on a parfois encore convoqué James: «En règle générale, rien n'est plus frappant dans un habile roman français que la supériorité de sa facture et de ses proportions artistiques sur celles d'un habile roman anglais[4].» Selon un historiographe de la littérature britannique, la situation pouvait être ainsi résumée en 1900: «les exigences françaises de style, d'économie artistique, de complétude structurelle, étaient largement et pleinement acceptées par ceux qui prenaient leur art au sérieux[5].» Le style, c'est donc d'abord de cela qu'il s'agit. Mais l'allégeance dépassa le seul genre narratif.
Pendant cinquante années, l'Angleterre a, plus que jamais et plus que tout autre pays, considéré la France comme le pays du style. Alors qu'une certaine méfiance avait été auparavant jetée sur l'obsession française de la mise en mots, les conditions semblèrent tout à coup réunies pour que le pays transformât en pure admiration le soupçon longtemps maintenu sur ce qu'il percevait comme un formalisme moralement douteux.
Le plus grand romancier anglais lui-même n'avait d'ailleurs jamais eu une très haute idée de son style[6]. Charles Dickens était mort en 1870; dix ans plus tard, il était de notoriété européenne que les écrivains français ne se préoccupaient guère que de style, et que les écrivains anglais ne s'en souciaient point. L'attestent par exemple ces lignes bien connues d'Émile Zola:
Les étrangers ne comprennent absolument rien à nos soucis de style. J'en ai causé avec des Anglais et des Allemands ; jamais aucun mouvement semblable n'a eu lieu dans leurs littératures. Les plus grands romanciers anglais, Dickens entre autres, ont écrit au petit bonheur de la langue, sans raffiner sur la ponctuation[7].
C'est un peu injuste, car les derniers textes de Dickens marquaient un évident infléchissement vers un plus grand souci rédactionnel et esthétique, et c'est cet infléchissement même, celui de toute l'époque, qui explique que l'Angleterre eût soudain honte de sa nudité et qu'elle décidât d'aller prendre à Paris des leçons de vêture.
Vers 1880, une chose semblait ainsi assurée: il y avait un retard à combler. La France avait ce que l'Angleterre n'avait pas: du style, le style. Les Français savaient écrire, les Anglais non. Parmi les nombreux témoignages que ce livre va convoquer, parmi ceux surtout qu'il laissera sur sa marge pour ne pas s'encombrer de répétitions inutiles, je retiendrai par exemple celui du grand critique John Addington Symonds: «ces auteurs français», écrivait-il en 1890, sont «nos maîtres pour ce qui est de l'expression littéraire considérée comme un art»; et il poursuivait: «Bien tard peut-être mais résolument, nous autres, Anglais, avons fini par reconnaître notre infériorité dans l'art de la prose et la nécessité dans laquelle nous étions d'en apprendre les règles auprès de nos maîtres français»[8]. Robert Louis Stevenson n'avait pas dit autre chose en 1885: «la prose française est sensiblement meilleure que l'anglaise[9].» Thomas Sturge Moore le dirait encore en 1910: «par sa prose, la France occupe le premier rang parmi les nations[10].» Nous appellerons bien assez de témoins à la barre; ceux-ci nous suffiront pour le moment.
Le sentiment d'un retard sur la France en matière de style était tel, au début du xxe siècle, qu'il ne concernait même plus la seule prose littéraire:
Ce n'est pas seulement en littérature, mais dans toutes les branches de la prose, en histoire et en politique, en religion et en philosophie, en mathématiques et dans les sciences naturelles avec leurs divers domaines d'application, que les auteurs français apparaissent supérieurement clairs et plaisants[11].
John Middleton Murry, dont on verra tout ce que sa théorie du style doit à la France, s'en amusait en 1922: «Ce style, dit-on souvent, c'est la qualité que, par nature, les journalistes français possèdent mais pas les journalistes anglais[12].»
D'autres s'en inquiétaient depuis longtemps: on voulait bien faire la part de l'esprit des nations, mais le retard tournait à l'humiliation. Comme il advient souvent en telles matières, l'École comparut au banc des accusés. Puisque les élèves français savaient si bien s'exprimer dans leur propre langue, et les élèves anglais si mal, il fallait importer les méthodes pédagogiques d'outre-Manche; il fallait faire de la composition anglaise, comme d'autres faisaient de la composition française. C'est la thèse que défendait, avec exemples et applications à l'appui, un livre qui eut un impact majeur sur l'enseignement des techniques de rédaction en Angleterre: The Art of Writing du grand pédagogue Philip Joseph Hartog. Nous sommes en 1907, c'est l'année où achèvent de paraître, dans les Annales politiques et littéraires, les chroniques que Gustave Lanson rassemblerait en volume l'année suivante sous le titre L'Art de la prose. Dans cette célébration du «merveilleux trésor de notre prose[13]», on aurait bien du mal à dénicher le moindre indice d'un sentiment de retard vis-à-vis de l'Angleterre ou de qui que ce soit. Et imagine-t-on, pour comparer ce qui est comparable, que les Conseils sur l'art d'écrire que Lanson publia chez Hachette en 1913 nous eussent invités à prendre nos modèles en Angleterre?
Depuis la fin du xixe siècle, il est vrai, la littérature française traversait ce que j'ai pu appeler ailleurs un «moment grammatical»[14]. De fait, le «moment français» de la littérature anglaise ne prit jamais exactement les mêmes formes, d'abord parce que toute espèce de «technicité» langagière restait étrangère à l'esprit national. Il n'y eut par exemple en Angleterre aucun texte similaire à l'article de Proust sur le style de Flaubert en 1920: aucun écrivain ne parla jamais avec la même assurance de prépositions, de pronoms, de temps verbaux. Certains le regrettèrent d'ailleurs, tel John Middleton Murryen 1922: «Les préfaces critiques de Henry James […] ont payé le prix d'un intérêt excessif pour ce qui est technique[15].» Technique est peut-être le mot le plus odieux de la langue anglaise[16], dirait un jour le très francophile romancier Ford Madox Ford, voyant là une des raisons pour lesquelles ce qui est possible en France est impossible en Angleterre: acheter un livre inconnu à l'étal d'une gare en étant assuré qu'il sera bien écrit.
Encore s'agit-il ici de technicité narrative autant que stylistique ou linguistique, puisque les écrivains anglais ne partagèrent jamais l'intérêt des écrivains français pour la chose grammaticale. Leonard Woolf, le mari de Virginia, s'en étonnait en 1924 à l'occasion de la parution de The Philosophy of Grammar d'Otto Jerpersen:
Je trouve bien surprenant que la plupart des écrivains n'éprouvent aucun intérêt pour le matériau avec lequel ils doivent travailler. Par matériau, je veux dire les mots: non pas seulement les mots isolés et leurs sens, tels qu'ils apparaissent momifiés ou pétrifiés dans le dictionnaire, mais aussi la ponctuation et la grammaire[17].
Virginia Woolf devait reprendre cette réflexion trois ans plus tard, le 16 octobre 1927, en rendant compte des Aspects of the Noveld'Edward Morgan Forster pour le supplément littéraire du New York Herald Tribune: comment un essai sur le roman peut-il ne rien dire de la langue, alors qu'on imaginerait mal un livre sur la peinture sans la moindre remarque sur le medium pictural lui-même[18]? On le savait en Angleterre: «La France est une nation de grammairiens[19]», tandis qu'outre-Manche la situation n'avait guère changé depuis la fin de l'ère victorienne: le lien entre langue et littérature y restait fort distendu[20].
Si l'on considère que la catégorie de style est précisément celle qui permet de penser ce lien, l'Angleterre avait un légitime sentiment de retard dans la problématisation et la description des pratiques littéraires; elle en conclut qu'elle avait aussi un retard dans les pratiques mêmes. À en croire Virginia Woolf, ce retard n'avait pas été comblé à la fin des années 1920, pour ce qui est du moins de la prose romanesque:
En Angleterre, en tout cas, le roman n'est pas une œuvre d'art. […] En France et en Russie, la fiction est prise au sérieux; Flaubert pouvait passer un mois à chercher une expression pour décrire un chou […][21].
Comme toute l'Europe et la France même, les lecteurs et les auteurs britanniques avaient, depuis les années 1890, les yeux également tournés vers la Russie, dont les romans fascinaient au point qu'il y eut de longs débats sur la préférence à leur donner ou non sur leurs homologues français. Mais ce débat ne pouvait inclure la question stylistique, et cela pour une raison fort simple: c'est qu'on ne lisait point le russe.
Or, comme Virginia Woolf le dit fort bien en février 1929: «Quand nous lisons une langue qui n'est pas la nôtre, notre attention est éveillée, et nous sommes sensibles à l'éclatante surface des mots[22].» Cette langue qu'elle lit et qui n'est pas la sienne, c'est évidemment le français. L'inventaire de la bibliothèque de Leonard et Virginia Woolf est désormais disponible: à l'unique exception des classiques latins et grecs, seuls des ouvrages en langue française y côtoient les livres publiés en anglais. Virginia Woolf parlait certes moins bien notre langue que la plupart de ses proches de Bloomsbury; elle la lisait cependant avec aisance, bien que Proust lui donnât du fil à retordre[23].
Pendant toute l'ère victorienne et jusqu'à la Seconde guerre mondiale au moins, il fut acquis que les élites cultivées lisaient sans peine le français[24]. En 1915, le poète-lauréat offrait ainsi au roi George V un volume où il mêlait prose et vers en langue française et en langue anglaise[25]. En 1929, Woolf estimait qu'un Anglais sur deux pouvaient lire le français[26]; c'est sans doute bien exagéré, mais l'hyperbole même est parlante. Je ne multiplierai pas les exemples; on verra notamment que le français fut longtemps la seule langue citée sans traduction dans la prestigieuse revue de T.S. Eliot, The Criterion.
Chevaux de Troie
En avril 1934, Eliot écrivait justement dans un éditorial de la revue: «Les jeunes générations ont du mal à se représenter quel désert intellectuel l'Angleterre et l'Amérique ont traversé pendant au moins la première décennie du siècle[27].» C'est certainement un peu injuste, mais moins injuste que le sentiment que connut l'Angleterre des années 1890 d'une traversée du désert littéraire. On peinait à voir comment on se remettrait des morts successives des grands romanciers victoriens nés dans les années 1810: William Makepeace Thackeray, Charles Dickens, Anthony Trollope, George Eliot. Plus jeune d'une demi-génération, George Meredith ne semblait plus devoir donner de récit important. Les années 1880 avaient paru particulièrement peu fécondes. Or, les chevaux de Troie français étaient déjà dans la place.
Le premier est presque négligeable, et il présente pour nous assez peu d'intérêt. C'est le gallicisme linguistique: un auteur importe alors un mot ou un tour depuis le français. Au moment où nous prenons l'histoire de la littérature anglaise, le prototype de l'auteur à gallicismes linguistiques restait encore sans doute le créateur du roman gothique, Horace Walpole. Il aurait été «l'écrivain anglais le plus francisé [frenchified] du xviiie siècle», selon Thomas Babington Macaulay, qui trouvait à sa prose un air de «mauvaise traduction du français» et épinglait à la fois de très banals imports lexicaux («The impertinent personage!») et de plus étranges imports grammaticaux, notamment un occasionnel alignement sur le système des temps verbaux français («She is dead rich», par exemple, au lieu de «She died rich», pour «Elle est morte riche»). Et il soupçonnait Walpole de s'être laissé séduire par une langue qui avait été «le véhicule de tous les aimables petits riens» de l'Europe, une sorte de signe maçonnique, qui se prêtait à la raillerie ou à l'anecdote[28]. Un siècle après ces remarques de Macaulay, l'Angleterre continuait à trouver de tels imports de mauvais goût, avec leur côté à la fois pédant et nouveau-riche[29].
Mais, pour la période que nous retenons, Walpole est évidemment largement éclipsé par un autre écrivain à gallicismes, Joseph Conrad. L'histoire est connue: né polonais, le romancier avait appris le français dès son enfance, l'anglais fort tard, bien qu'il fît carrière dans cette langue. On le sait aussi par le témoignage de son confrère et ami Ford Madox Ford, tous deux parlaient volontiers français entre eux, et surtout ils ne lisaient que du français: «Flaubert, Flaubert, toujours Flaubert.» Ford rapporte d'ailleurs un propos que Conrad aurait tenu vers 1897: «Quand j'écris, je pense en français puis je traduis en anglais les mots de ma pensée»[30]. Rien d'étonnant dès lors que son lexique sentît bien involontairement le français; ainsi le mot grief (chagrin y a-t-il régulièrement le sens de son homographe français, dont l'équivalent anglais est en fait grievance[31].
Mais il n'est pas toujours aisé de faire le départ entre le gallicisme linguistique et le gallicisme stylistique. Quand nous lisons dans Un paria des îles«a silence cold, mournful, profound» (An Outcast of the Islands, 1896, II-6[32]), doit-on considérer que la position des épithètes après le nom est simplement une possibilité offerte par l'anglais littéraire, ou bien un calque de l'usage français (puisque, à en croire Conrad, les mots lui seraient d'abord venus dans cette langue), ou encore l'importation d'une pratique stylistique déjà bien établie chez les écrivains français, qui apprécient d'aligner ainsi trois épithètes non coordonnées après le nom. Il serait un peu vain de vouloir nécessairement choisir entre les trois explications, mais il est quelque pertinence à réfléchir sur la possibilité d'un gallicisme proprement stylistique dans l'Angleterre des années 1880-1930, et c'est à cette réflexion que le présent ouvrage est consacré.
Le gallicisme stylistique fut en effet le véritable cheval de Troie de la littérature française dans la littérature anglaise du tournant des xixe et xxe siècles. Dès lors qu'on tenait pour acquis que l'Angleterre n'avait développé ni une sensibilité formelle, ni un bagage réflexif suffisant, ni les instruments langagiers pouvant répondre aux nouveaux besoins expressifs et esthétiques qui s'étaient fait jour, on voulut combler le retard en important de France les matériaux qui manquaient. Ou du moins le crut-on. Car l'omniprésence de la référence française dans le discours ou les revendications stylistiques anglaises est trompeuse. Il est évident que les exigences stylistiques qui apparurent vers 1880 ne devaient rien à la France: elles étaient l'aboutissement d'une évolution qui s'observe de façon générale dans les littératures européennes à la fin du xixe siècle. Mais il apparut que la France avait une sorte d'avance, et l'on se tourna vers elle.
Cette référence fut spectaculaire, mais il n'est pas certain qu'elle fût décisive: la France avait simplement déjà répondu à un certain nombre de questionsqui se posaient soudain en Angleterre. On décida alors que ces questions étaient françaises, et l'on crut importer des réponses qui étaient en fait déjà présentes dans le discours littéraire anglais mais qui avaient d'abord été formulées outre-Manche. On crut également adopter le souci stylistique voire certaines pratiques rédactionnelles de Flaubert; on le fit assurément un peu, mais pas autant qu'on le pensa, ou pas de la manière qu'on le pensa: on emprunta certaines combinaisons rythmiques par exemple, mais on ne se rendit pas compte qu'on empruntait aussi un certain usage du style indirect libre, et surtout on n'importa point l'interdit flaubertien (voire français) de la répétition d'un même mot en contexte étroit. Reste que ce souci du style et peut-être même certaines pratiques seraient fort probablement apparus sans Flaubert; mais Flaubert était déjà là, et son nom dominait une littérature au sommet de son prestige. C'est une méthode qui nous est familière: nous avons une idée, et nous allons chercher ailleurs des garants ou des formulations pour l'étayer. La France a fourni à l'Angleterre des garants et des formulations, des catégories et sans doute quelques idées aussi. Nous en jugerons sur pièce.
Telle est en tout cas la raison pour laquelle je parlerai plus volontiers ici de référence que d'influence. La notion d'influence simplifie à l'extrême la perception que nous pouvons avoir des évolutions internes de l'histoire littéraire et notamment des évolutions stylistiques. Elle a souvent toute pertinence quand il s'agit de pratiques singulières d'auteurs singuliers, mais, au-delà, elle nous fait courir trois risques. Le premier est d'ordre esthétique: à partir des années 1830, l'originalité et la singularité sont peu à peu devenues deux critères majeurs d'évaluation des œuvres; dès lors, la question de l'influence reste parasitée par celle de la hiérarchie artistique: le style influencé serait nécessairement inférieur au style influenceur. Or, comme l'a bien souligné Nathalie Heinich, il s'agit là d'une pure construction historique ou sociale et non scientifique: la singularité «n'est pas une propriété substantielle des œuvres ou des artistes, mais un mode de qualification — au double sens de définition et de valorisation — qui privilégie l'unicité, l'originalité, voire l'anormalité, et en fait la condition de la grandeur en art[33]». Le deuxième risque est d'ordre méthodologique: dans un ouvrage récent, Judith Schlanger a bien montré combien la notion d'influence devait être dépliée et combien la dialectique du «neuf» et du «déjà-là» ne saurait être réduite à un simple mouvement de transfert qui ramène l'histoire à un flux orienté et régi par les lois simplistes de la causalité[34]. Le troisième risque est d'ordre idéologique: la notion d'influence nous ramène presque systématiquement au «paradigme généalogique» naguère dénoncé par François Noudelmann. Il ne s'agissait pas seulement pour le philosophe de lancer un nouvel appel à la prudence contre le sophisme du post ergo propter, une nouvelle condamnation de toutes les formes d'illusion rétrospective ou de mise en récit de la successivité des données historiques, mais simplement de nous mettre en garde contre le recours systématique à la «généalogie» comme principe d'explication[35].
De fait, un constat de proximité, de ressemblance ou de parenté ne gagne guère à être d'abord pensé sur le mode de la succession, c'est-à-dire de l'héritage, et le recours à la notion d'influence apparaît souvent comme une facilité. Ainsi, pour prendre un tout autre exemple, a-t-on parfois considéré que la vogue du récit au présent dans la littérature anglaise des années 1960 trahissait une «influence» du Nouveau roman français[36]; quand on y regarde de plus près, une telle position n'est pas tenable: comme toutes les littératures européennes, la littérature anglaise était soumise à un drift évolutif qui devait mener à l'avènement du récit au présent. Mais le Nouveau roman français était là; sans doute certains auteurs et certains lecteurs trouvèrent-ils bien «français» de conduire le récit à un temps autre que le passé. Il n'y eut probablement pas influence, mais il y eut assurément référence.
Pour achever de clarifier une possible distinction entre les deux notions, je prendrai encore un exemple: le roman français de la fin des années 1920 a connu une véritable «vogue endophasique» qui s'est traduite par un soudain engouement pour le monologue intérieur[37]. Il faut y voir pour une part l'influence de l'Ulysse de James Joyce, qui avait suscité un vif intérêt en France dès sa parution, en anglais mais à Paris, en 1922. Mais bien des signes avant-coureurs laissent penser que ce triomphe du monologue intérieur aurait eu lieu sans Ulysse, tout simplement parce que le mouvement évolutif propre du roman français depuis un quart de siècle le rendait en quelque sorte sinon inévitable, du moins prévisible. Le livre de Joyce influença moins qu'il ne servit de référence: il suffit, pour s'en rendre compte, de regarder les textes mêmes. À la même époque, la France faisait par ailleurs un soudain retour à Edgar Allan Poe: le poète américain fut cité à tout proposet souvent à l'appui des pires banalités. Pendant quelques années, il fut une référence absolue, c'est-à-dire une référence vide; depuis longtemps déjà il n'exerçait plus la moindre influence[38].
C'est cette question de la référence et de l'influence que j'entends traiter dans les pages qui suivent. Je viens d'opposer les deux notions un peu trop fortement, pour les simples besoins de la clarté de l'exposition, alors qu'elles sont difficilement démêlables, puisqu'elles coexistent nécessairement dans une dynamique dialectique: la référence la plus décorative modifie nécessairement la position première et donc l'influence, etc. Aussi vais-je à la fois prendre acte de l'omniprésence de la référence stylistique française dans le discours littéraire anglais des années 1880-1930 et me demander si cette référence a abouti à une véritable influence formelle. Cette seconde opération est la plus délicate et, en telles matières, on doit se contenter d'hypothèses puis opérer par coups de sonde. Pour cela, je vais construire des observables de types divers: je vais par exemple solliciter les nombreux auteurs anglais dont on a pu dire qu'ils avaient un «style français». Pour tenter de comprendre ce que «style anglais» et «style français» signifient, je vais également convoquer les auteurs français, cette fois fort rares, dont le style fut trouvé «anglais» par l'Angleterre même. On peut espérer que la comparaison des pratiques rédactionnelles des uns et des autres nous aide à y voir plus clair, mais même un résultat négatif nous intéressera.
Je me propose aussi de repérer des tours stylistiques parfaitement possibles en anglais et bien attestés dans la littérature britannique avant 1880, mais dont on a pu, à un moment donné, considérer qu'ils étaient plutôt français et que l'on a sollicités en tant que tels. Pour affiner l'analyse, je vais en outre user occasionnellement d'une méthode simple: puisque l'on considère que les textes traduits ne doivent pas «sentir» la langue de départ et que la traduction doit par conséquence éviter de calquerles tours d'origine, il suffira alors de repérer quels tours sont contournés, par exemple dans les premières traductions de Flaubert ou de Zola, puis de regarder si ces mêmes tours se retrouvent en revanche dans la prose romanesque anglaise elle-même, dont le style prendrait alors une possible couleur française, un possible accent français.
J'ai jusqu'à présent utilisé l'adjectif anglais avec une certaine légèreté. J'ai cité Conrad, Eliot et James qui ne sont pas nés sujets de sa Majesté. C'est que le critère de la nationalité n'est pas ici premier; par littérature anglaise, j'entendrai littérature produite en Angleterre, par des écrivains pris dans les réseaux littéraires et éditoriaux du pays au moment où celui-ci traverse à la fois son «moment stylistique» et son «moment français»: on l'a compris, c'est tout un. Je n'évoquerai ainsi James Joyce que marginalement et à titre de comparaison. J'évoquerai fréquemment George Moore, qui est également né irlandais mais a longuement fréquenté les milieux littéraires londoniens et pris part à leurs débats; du moins ne l'évoquerai-je que jusqu'au moment où il retourna en Irlande. Le très anglais Arnold Bennett cessera de m'intéresser dès lors qu'il s'établit à Paris. À ce parti pris, j'apporterai une importante nuance: il n'est pas indifférent que l'on ait grandi et surtout que l'on ait été scolarisé à tel moment et dans tel pays. Il nous faudra garder cela en mémoire.
Autant qu'une analyse de la présence française dans la réflexion et la pratique stylistiques anglaises de l'entre-deux-siècles, cet essai se veut en effet une réflexion sur les mécanismes de création collective des filtres stylistiques et sur la dimension collective des faits de style, que l'on envisage trop souvent dans une seule perspective individuelle et «auteuriste». Ce faisant, il souhaite aussi participer à une histoire stylistique de la littérature française. Le miroir tendu depuis l'outre-Manche permet en effet de mieux comprendre la stabilisation d'une certaine pensée esthétique française, mais aussi, par comparaison et contraste, d'en mieux cerner les enjeux et les formes langagières.
Le premier chapitre de cet ouvrage tente de saisir les modalités d'apparition, d'infiltration et d'évolution de la référence française dans les grands discours sur le style que l'Angleterre a produits en aval mais surtout pendant cette période si particulière que furent les années 1880-1930. Le deuxième pose plus directement la question de l'influence, en déplaçant le regard de la théorie vers la pratique: on y verra comment on voulut «écrire en anglais comme on écrit en français» et notamment comment on voulut suivre deux des grands modèles fournis et célébrés par la France: Ernest Renan et Gustave Flaubert.
Le troisième chapitre s'arrête sur la question, centrale pour toute la période considérée, du devenir anglais de l'«impressionnisme» stylistique français: on y verra comment celui-ci influença une première génération de romanciers et quelles difficultés on éprouva à transposer en anglais le phénoménisme et le subjectivisme issus de Flaubert; on y verra ensuite comment une seconde génération put, après 1910, se revendiquer fortement de l'impressionnisme stylistique français, sans que cette référence se traduisît par une réelle influence sur ses pratiques d'écriture.
Les deux chapitres suivants prolongent la réflexion en s'arrêtant sur deux paradoxes: pourquoi plus Henry James devint anglais, plus son style se fit français? Pourquoi l'Angleterre décida-t-elle que Proust était un auteur de langue française mais de style anglais? Le dernier chapitre forme boucle avec le premier: il étudie les formes et les formulations de la référence stylistique française dans le Criterion, la revue qui a dominé le champ littéraire britannique de l'entre-deux-guerres. On y contemplera le grand moment français du style anglais à son sommetpuis à son déclin.
Comment pourrait-on ne pas bien écrire dans une langue qui possède des mots comme amertume ou pierreries?, s'émerveillait Virginia Woolf en 1929. Que les Français écrivent vraiment mieux que les Anglais est «peut-être une illusion», poursuivait-elle: une illusion née du dépaysement que leur littérature procure et du prestige dont elle jouit, mais une illusion qui ne cesse de gagner des soutiens[39].
C'est l'histoire de cette illusion que l'on va lire ici.
Printemps 2016
Pages associées: Histoire, Style, Référence, Influence.
[1] The Diary of Virginia Woolf, t. III, Londres, The Hogarth Press, 1980, p.182. Dans les citations en anglais, les usages typographiques originaux ont été respectés. Sauf indication contraire, toutes les traductions sont miennes.
[2] Sur le créneau chronologique exact qui nous retiendra, voir le livre de Christophe Campos, The View of France, from Arnold to Bloomsbury, Oxford, Oxford University Press, 1965.
[3] Henry James, «The Present Literary Situation in France» (1899), Literary Criticism, t. I, New York, The Library of America, 1984, p.111.
[4] H. James, «[Recent Novels]» (1876), ibid., p.41.
[5] Ernest A. Baker, The History of the English Novel, t.IX, Londres, Witherby, 1938, p. 205.
[6] Voir l'introduction, par Daniel Tyler, de Dickens's Style, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
[7] Émile Zola, Les Romanciers naturalistes (1881), Œuvres complètes, t. X, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2004, p.619.
[8] John Addington Symonds, «Notes on Style», Essays Speculative and Suggestive (1890), Londres, John Murray, 1907, p. 168et 201.
[9] Robert Louis Stevenson, Essais sur l'art de la fiction, trad. F.-M. Watkins et M. Le Bris, Paris, Payot, 1992, p.269; «On Some Technical Elements of Style in Literature» (1885), Essays on the Art of Writing, Londres, Chatto and Windus, 1919, p.30.
[10] Thomas Sturge Moore, Art and Life, Londres, Methuen and Co., 1910, p.108.
[11] Philip Joseph Hartog, The Writing of English, Oxford, Clarendon Press, 1907, p.5.
[12] John Middleton Murry, The Problem of Style, Londres, Humphrey Milford and Oxford University Press, 1922, p.6.
[13] Gustave Lanson, L'Art de la prose (1908), Paris, La Table ronde, 1996, p.28.
[14] Voir G. Philippe, Sujet, verbe, complément. Le moment grammatical de la littérature française (1890-1940), Paris, Gallimard, 2002.
[15] J. M. Murry, The Problem of Style, p.21.
[16] Ford Madox Ford, «Techniques» (1935), repris en annexe de The Good Soldier, New York, Norton, 2012, p.300.
[17] Leonard Woolf, «Words», The Nation & Athenæum, 26 juillet 1924, vol. XXXV, p.538.
[18] V. Woolf, «Is Fiction an Art?» (1927), The Essays of Virginia Woolf, t.IV, Londres, Hogarth, 2000, p.462. Tout le début de ce paragraphe doit beaucoup à Sara Sullam («“It is all in oratio obliqua”», Letteratura e letterature, no5, 2011, p.135-149).
[19] La célèbre formule de Georges Duhamel était encore reprise dans Lewis Charles Harmer, The French Language Today. Its Characteristics and Tendencies, Londres, Hutchinson's University library, 1954, p.11.
[20] Voir Toni Cerutti, «La questione della lingua (1850-1900)», dans F. Marenco, dir., Storia della civiltà letteraria inglese, t. II., Turin, Utet, p.567 et p. 573-577.
[21] V. Woolf, «Is Fiction an Art?», p.463.
[22] V. Woolf, «On Not Knowing French» (1929), The Essays of Virginia Woolf, t.V, Londres, The Hogarth Press, 2009, p. 3.
[23] Voir Emily Dalgarno, Virginia Woolf and the Migrations of Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p.99-100.
[24] Voir Terry Hale, «Readers and Publishers in Britain», dans P. France et K. Hayes, dir., The Oxford History of Literary Translation in English, t. IV, Oxford, Oxford University Press, 2006, p.34-47.
[25] Robert Bridges, The Spirit of Man: an Anthology of Poets and Philosophers in English and French, Londres, Longmans Green and Co., 1916.
[26] V. Woolf, «On Not Knowing French», p.3.
[27] T. S. Eliot, «A Commentary», The Criterion, vol. XIII, no 52, avril 1934, p.451-452.
[28] Thomas Babington Macaulay, «Horace Walpole» (1833), Historical Essays, New York, Thomas Y. Crowell and Co., 1901, p.119-121.
[29] Voir Herbert Read, English Prose Style (1928), Londres, Bell and Sons, 1952, p. 10.
[30] Successivement: F. M. Ford, Thus to Revisit, Londres, Chapman and Hall, 1921, p.39, et A Personal Remembrance, Londres, Duckworth<em>, 1924, p.37.
[31] On trouvera de nombreux exemples de gallicismes lexicaux en se reportant aux notes proposées par Sylvère Monod et Jean Deurbergue pour leur traduction de The Secret Agent (1907) et de Under Western Eyes (1910), dans Œuvres, t. III, Paris, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1987. Dans la préface de cette édition, S. Monod a apporté toutes les nuances nécessaires à une tradition critique qui a sans doute indûment insisté sur les gallicismes de Conrad (t. I, 1982, p. xxxv-xxxvi).
[32] Les passages empruntés aux grandes œuvres du canon littéraire français et anglais seront référencés par simple indication de chapitre ou de section. Je me permettrai par ailleurs de ne pas traduire les quelques segments qui font l'objet d'un commentaire purement stylistique.
[33] Nathalie Heinich, La Sociologie de l'art, Paris, La Découverte, 2004, p.107, cité dans Vincent Capt, Poétique des écrits bruts, Limoges, Lambert-Lucas, 2014, p. 46.
[34] Voir Judith Schlanger, Le Neuf, le différent et le déjà-là. Une exploration de l'influence, Paris, Hermann, 2014.
[35] Voir François Noudelmann, Pour en finir avec la généalogie, Paris, Léo Scheer, 2004.
[36] Ce lieu commun est dénoncé par Kazunari Miyahara dans «Why Now? Why Then? Present-Tense Narration in Contemporary British and Commonwealth Novel», Journal of Narrative Theory, vol. XXXIX, no2, 2009, p.242.
[37] Voir G. Philippe, «La langue littéraire, le phénomène et la pensée», dans G. Philippe et J. Piat, dir., La Langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, Fayard, 2009, p. 102-107.
[38] Voir William Marx, «Transmission et mémoire», dans V. Debaene, M. Macé et M. Murat, dir., L'Histoire littéraire des écrivains, Paris, Pups, 2013, p.135-137.
[39] V. Woolf, «On Not Knowing French», p. 5.