par Jérôme Meizoz
(Université de Lausanne)
Extrait de Jérôme Meizoz, Faire l'auteur en régime néo-libéral. Rudiments de marketing littéraire, Genève-Paris, Slatkine, coll. «Erudition», 2020, pp. 91-101 (chapitre 4).
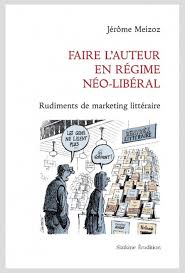
Ce texte est reproduit dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula avec l'aimable autorisation de l'auteur et de son éditeur.
Rendre au livre une grande qualité qui lui manque parfois : un moment de plaisir. Un livre long, mais qui se lise vite parce qu'on ne veut pas s'en détacher. […] L'envie d'écrire pour les lecteurs exigeants comme pour les lecteurs hésitants. […] L'envie de faire l'effort d'aller vers les lecteurs : l'envie de donner envie. — Joël Dicker [1]
Quand Joël Dicker, est interrogé sur l'énorme succès de son roman, La Vérité sur l'affaire Harry Quebert (2012), trois arguments principaux structurent l'ensemble de ses réponses. Premièrement, il opère une distinction entre une littérature comme «exercice de style», expérimentale et gratuite (“des livres qui n'ont ni queue ni tête” ; “très bien écrits mais complètement vides”) et une littérature narrative plus «populaire», calquée sur les usages du storytelling, en vue d'être accessible à un large public. Deuxièmement, il invite à une réhabilitation démocratique des livres à large audience, «compris et lus par tous». Selon lui, seule la tradition française élitiste juge honteusement des ouvrages signés d'auteurs comme Georges Simenon ou Marc Levy. Troisièmement, ce type d'ouvrages a pour qualité de faire lire des gens qui lisent peu ou pas (“Marc Levy est capable de faire lire plus d'un million de personnes par an, c'est impressionnant ! ” [2]). Et Dicker ajoute :
« La Vérité sur l'affaire Harry Quebert aura représenté un peu plus de deux années de travail. À mes yeux, plus qu'un livre, il s'agit d'un projet. Tout naît de l'envie d'écrire une véritable histoire ; l'envie d'emporter le lecteur, de l'arracher à son quotidien. Rendre au livre une grande qualité qui lui manque parfois : un moment de plaisir. Un livre long, mais qui se lise vite parce qu'on ne veut pas s'en détacher. L'envie de tout lâcher pour lire. L'envie de terminer sa journée pour rentrer chez soi et lire. L'envie d'écrire pour les lecteurs exigeants comme pour les lecteurs hésitants. L'envie d'écrire pour ceux qui n'ont pas le temps de lire et qui soudain le trouvent. L'envie de faire l'effort d'aller vers les lecteurs : l'envie de donner envie. » [3]
Dès lors, s'il consent à ce que sa conception du roman soit discutée par des professionnels du style, Joël Dicker prend par contre le parti de ses lecteurs et les défend contre la «dynamique de tyrannie» qui s'exercerait sur eux, en France. Cette alliance avec les lectrices et les lecteurs se trouve maintes fois réaffirmée, autant dans l'intrigue de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert que dans les entretiens de l'auteur :
« La véritable réflexion qui m'intéressait était celle de la relation auteur-lecteurs. Il y a parfois chez les écrivains la peur de la perte du lien entre eux et les lecteurs. Au fond, c'est le plus passionnant, je trouve. Cette relation presque dépendante avec son public que peut créer le succès. Marcus a peur de voir le lien se rompre. Mais c'est le livre qui doit créer le lien, et non l'inverse. » [4]
Dressant le portrait-type de l' «écrivain-à-succès» à partir d'une enquête menée à la fin des années 1990, Nathalie Heinich observait que les auteurs du pôle de grande production, confrontés à la critique récurrente sur leur légitimité, trouvent à y répondre par l'affirmation d'autres valeurs, parmi lesquelles l'adhésion au modèle entrepreneurial, la méfiance à l'égard de l'imagerie romantique de l' «écrivain-souffrant», le choix ostensible du grand public, la recherche du succès «hors des pages littéraires», enfin la défense de l'intérêt et des droits des lecteurs. [5]
Lorsque la journaliste fait remarquer à Joël Dicker avec une pointe d'ironie qu'il parle «un peu comme Marc Levy», le jeune romancier renchérit. Sur plusieurs points, son argumentaire est d'ailleurs analogue à celui de l'auteur français. Il consiste à retourner le stigmate du rattachement à une «littérature industrielle» (selon le mot de Sainte-Beuve en 1839) en promotion démocratique de la littérature et des lecteurs. Se présenter en écrivain de «l'inclusion» (contre les auteurs de l'«exclusion») donne une image généreuse du projet à l'origine d'un best-seller. D'autant que la visée générale de l'auteur reste fidèle aux valeurs classiques de l'humanisme bourgeois :
« […] défendre la littérature est aussi l'une de mes préoccupations. Si un de mes livres donne du plaisir aux gens et qu'il les pousse à en lire d'autres, je considère avoir rempli une bonne partie de ma mission. » [6]« Après tout, ce qui est beau dans un livre, c'est que ça rassemble. » [7]
À cela s'ajoute le fait que, mettant les lecteurs de son côté, Dicker n'omet pas de dénoncer le «système» des jugements littéraires, empruntant ici à l'argumentaire populiste :
« En France, il y a une vraie cellule à Saint-Germain-des-Prés qui décide de ce qui est bien et dit que le reste, c'est de la m...! C'est pour ça que le livre français va mal. » [8]
En effet, pour faire pendant aux jugements esthétiques souvent défavorables de la critique intellectuelle (dont le paradigme serait la chronique d'Eric Chevillard sur Le livre des Baltimore ou les propos cruels de Yann Moix à la télévision), Dicker prend appui sur l'arbitrage du grand public, le nombre n'étant plus ici synonyme de massification, mais de rassemblement, d'inclusion et de partage.
Quel bilan tirer de l'étude de ces deux campagnes publicitaires et des discours qu'elles ont suscités ? Le recours à un jeune auteur à succès comme image de marque pourrait signifier une reconnaissance voire même une promotion de la littérature dans l'espace public. A lire les propos des publicitaires, cette hypothèse optimiste semble fragile. Les marques Swiss et Citroën cherchent moins un écrivain qu'un support humain pour les valeurs qu'elles promeuvent comme la jeunesse, la beauté et l'argent :
« Le but premier de ces opérations est de rapprocher notre marque du grand public avec des personnalités accessibles et qui suscitent l'affection, explique Evelyne Lozeron-Gentile, responsable de la communication de Swiss pour la Romandie. Notre deuxième objectif est d'éveiller l'intérêt des médias par la présence de ces ambassadeurs de choix. Et notre troisième intention est de partager nos communautés sur nos réseaux sociaux respectifs. Ainsi, chaque fois qu'ils voyagent avec nous, ils le postent sur leur mur avec la mention #SwissGVA. En contrepartie, nous leur offrons un volume en espèces pour se déplacer sur nos lignes. Mais il est important de préciser qu'il ne s'agit pas de montants faramineux. Pour Joël Dicker, par exemple, cela ne couvre absolument pas tous ses déplacements. » [9]
Les publicitaires s'adressent à Joël Dicker pour sa célébrité, parce que son nom fonctionne comme un label, bien au-delà des cercles de lecteurs. En effet, bien des téléspectateurs et lecteurs de la grande presse connaissent le nom et le visage du jeune écrivain «à gueule d'ange» sans avoir lu ses romans, de même qu'une partie non négligeable des 5 000 lettres de lecteurs adressées à Georges Simenon provenaient de gens qui ne l'avaient pas lu mais vu dans les médias [10]. Une fois connu pour sa notoriété (comme disait Andy Warhol), un écrivain voit son nom transformé en marque : c'est pourquoi l'on entend des lecteurs dire désormais qu'ils achètent «du Musso ou du Levy», le partitif grammatical révélant ici une transformation du rapport au nom d'auteur [11]. Dans le cosmos médiatique décrit ici, signature, le nom d'auteur passe d'une valeur de signature à une valeur marque. Autrement dit, l'énonciateur désigné renvoie moins à un être assumant son propos (auctor) qu'à la labellisation d'un processus industriel.
Des argumentaires contrastés
Le Matin du 18 octobre 2015 consacre son article aux campagnes publicitaires mettant Dicker en vedette :
«Littérature. Joël Dicker en pilote pour faire la pub de Swiss, ça fait jaser.
Depuis la sortie de son nouveau roman, l'écrivain genevois multiplie les opérations de communication pour la compagnie aérienne. Un choix qui ne laisse pas indifférent.
Débat.
Sa casquette vissée sur la tête, Joël Dicker réalise un rêve de gosse. Ce 8 octobre, l'écrivain genevois est aux commandes d'un Airbus A320 de Swiss à l'aéroport de Cointrin (GE). Vêtu de tout l'attirail d'un vrai pilote, le jeune homme fait un signe de la main depuis le cockpit de l'appareil à la foule des invités. L'espace d'un instant, il est le commandant de bord d'un avion de ligne. “Volez, lisez, rêvez”, lance-t-il comme un slogan publicitaire.
Depuis la sortie de son nouveau roman Le livre des Baltimore, fin septembre [2015] en Suisse romande, Joël Dicker multiplie les opérations de ce type pour la compagnie aérienne. Une fois, il décrit sa passion pour l'aviation et Swiss, une autre, il raconte que son roman a été écrit depuis les airs dans un appareil à croix blanche, et une troisième, justement, il touche du doigt ce qu'il a tant convoité dès l'âge de 9 ans. Le tout avec la complicité de son nouvel ami, le musicien vaudois Bastian Baker, lui aussi engagé par la compagnie pour en faire la promotion.» [12]
Suit un débat contradictoire entre deux journalistes sous le titre : «Un écrivain est-il un vendeur d'aspirateurs comme un autre?». Sonia Arnal se charge de répondre oui, Raphaël Leroy soutient que non. Le cadre du débat contribue à renforcer le caractère binaire des arguments, les deux journalistes étant invités à défendre, de manière rhétorique, des points de vue inverses. Sonia Arnal recourt de manière ironique à l'argument des «pseudo-intellos» qui ont «des préjugés sur ce qu'est un artiste»:
«Je résume : un bon écrivain ne vend rien, vit dans la pauvreté et l'anonymat le plus complet. Il est encore meilleur comme écrivain si en plus il est suicidaire ou en tout cas dépressif à cause de la noirceur du monde et de la bêtise de ses contemporains qui le désespèrent. Il meurt abandonné de tous, sans un rond, et finit dans la fosse commune. Parce que des génies, comme Mozart ou Van Gogh, ont vécu tout ou partie de ce parcours, nos amis choqués par Joël Dicker sur un bus en déduisent dans un syllogisme affligeant que c'est la pauvreté et le manque de reconnaissance publique qui font le génie. J'en vois qui vont dire que justement, Dicker… » (Ibidem)
À ce «syllogisme affligeant», Sonia Arnal oppose deux faits historiques. D'une part, que l'écriture est un métier et que les écrivains doivent en vivre ; d'autre part, que depuis le XIXe siècle, nombre d'auteurs reconnus ont collaboré avec des publicitaires :
« À ceux-là je répondrais que Hemingway a fait de la pub pour Ballantine Ale, comme Steinbeck d'ailleurs, et que Mark Twain a vanté les mérites d'une plume à réservoir, la Paul E. Wirt Fountain Pen. Plus près de chez nous, Virginie Despentes ou David Foenkinos (qui a aussi bossé pour Nespresso) ont vendu leur plume à Vuitton, faisant l'éloge de la malle. Même Bruckner a donné dans l'apologie d'une sorte de loto de la Française des Jeux. Tous des médiocres? Non, juste des gens qui considèrent qu'écrire est un métier et qu'il vaut mieux en vivre bien grâce notamment à des entreprises privées que mal grâce à quelques subventions publiques. » (Ibidem)
Quant à Raphaël Leroy, sa position prend appui sur la définition romantique de l'écrivain comme individu désintéressé, au statut particulier («piédestal»), dont le «devoir de recul» sur le monde fait un sage laïc, rétif aux seules logiques économiques, comme le «philosophe» Alexandre Jollien, cité à l'appui. Leroy refuse que l'écrivain, du fait de son magistère intellectuel, s'assimile à une «pop star» ou à un «sportif» dont les fonctions sont avant tout de l'ordre de la détente. Ce faisant, il invite à maintenir une nette séparation entre art et divertissement :
« Un écrivain n'est pas une pop star. Joël Dicker semble l'avoir oublié. L'a-t-il seulement bien compris ? Depuis près de deux ans, le surdoué genevois du roman prête son image à la compagnie aérienne Swiss. Noble dessein que de vouloir promouvoir un secteur qui le passionne depuis son enfance. Mais être écrivain, c'est autre chose. C'est un devoir de recul sur nos sociétés éclatées, de solitude devant les modes et tendances, de rareté face à l'effervescence du monde. Être écrivain, nous dit l'auteur et philosophe romand Alexandre Jollien, c'est “témoigner d'un état d'esprit, d'un rapport au monde qui nous rapproche d'une humanité plus solidaire, plus vraie et finalement loin d'une logique mercantile et de compétition”. En multipliant les opérations de communication jusqu'à la nausée, en expliquant que son dernier livre a été écrit dans des avions Swiss (oh, hasard!), Joël Dicker a fait descendre l'écrivain de son piédestal. Il a fait de lui l'égal d'un simple sportif qui arrondit ses fins de mois en vendant des rasoirs et des montres. » (Ibidem)
En convoquant des exemples fictifs, Leroy semble ignorer que nombre d'écrivains célèbres ont collaboré à des entreprises publicitaires :
« J'exagère? Alors imaginez un instant Michel Houellebecq vanter les mérites d'Air France, Alexandre Jardin vendre des préservatifs Durex, Albert Camus prêter son nom aux casseroles Tefal ou Marguerite Duras devenir l'égérie d'Orangina. De quoi auraient-ils l'air? » (Ibidem)
Enfin, loin de dénier du talent au jeune auteur, Leroy juge toutefois la participation à ces campagnes publicitaires comme une faiblesse temporaire d'un garçon trop jeune et inexpérimenté pour résister aux tentations. Encore une fois, le journaliste prend appui sur la définition de l'écrivain comme «phare, «solitaire» et réfractaire à l'instrumentalisation, pour inviter Dicker à revenir au statut noble du créateur sans compromis :
« Du haut de son immense talent, Joël Dicker a succombé à la tentation du buzz, de l'hypermédiatisation, du bourrage de crâne, du trop-plein. Et, quelque part, à la futilité. Comme s'il avait peur que tout s'arrête. Ce faisant, il a choisi la facilité. Or ce n'est pas ce qu'on attend d'un écrivain. Ce dernier ne doit pas suivre une vague mais la précéder. Il ne doit pas s'asservir aux aspirations populaires ou des communicants, comme un vulgaire politique, mais y résister. Toujours. Plus que quiconque, un écrivain doit mener sa route en solitaire hors du chemin mercantile du monde. Sinon, qui d'autre ? » (Ibidem)
Synthèse
Le formidable écho de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert a fait de Joël Dicker une célébrité incarnant plusieurs idéaux : jeunesse, sex appeal, créativité, succès, liberté. À une échelle plus locale, sans doute, les campagnes publicitaires du chanteur pop Bastian Baker reposent sur les mêmes attendus. Tous deux sollicités par la compagnie aérienne Swiss, Dicker et Baker ont sociologiquement en commun d'être de jeunes hommes présentant bien et prêts à produire pour le marché, selon ses contraintes, explicites ou intériorisées. Leur discours ne réfère pas à une nécessité créatrice par défi esthétique (art pour l'art, Flaubert), par souci de la vie publique (de Zola à Sartre) ou par émulation vis-à-vis des pairs littéraires (Bourdieu). Dans l'environnement médiatique de la littérature, l'écrivain doit pouvoir tenir un discours adapté aux circonstances : en l'occurrence, dans le cosmos de l'entreprise privée, une parole de vendeur. Ou du moins une parole sur la littérature qui la rende en partie compatible avec le régime marchand, sans lui porter atteinte en tant que pratique culturelle démocratique.
C'est dire si la réflexion sur le best-seller gagne à tenir ensemble au moins trois problèmes : celui de la montée en singularité des artistes, celui des logiques spécifiques du champ littéraire et enfin celui du modèle économique qui régit la chaîne du livre. En l'occurrence, la singularité de Joël Dicker s'élabore à travers la promotion médiatique de l'auteur sur fond d'un cosmos marchand présenté comme bénéfique et pacifié, en étroite affinité avec le secteur le plus commercial du champ littéraire. Dans un tel univers de production, même le style, pourtant critère suprême invoqué par la «grande» littérature, s'avère mobilisable comme marqueur commercial. La griffe auctoriale que constitue le style sert à singulariser le nom d'auteur dans un contexte commercial visant la labellisation. En effet, en quelques décennies, la littérature a passé d'un régime de la signature à un régime de la marque, ce qu'illustre bien l'image de Michel Houellebecq dans l'univers médiatique contemporain.
Jérôme Meizoz (Université de Lausanne) 2020
Mis en ligne dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula en août 2020.
[1] Propos de l'auteur sur son site officiel : https://joeldicker.com/about/
[2] Extraits d'un entretien avec Anne Rougemont, Swiss seasons, 2012, p. 149-152, Cet argument démocratique est mobilisé en général par les Salons du livre au moment de présenter leurs programmes. En mars 2017, le plus grand succès du Salon du livre de Paris fut le livre de la «superstar» Nabilla, Trop vite (2016), cf. Paris-Match, 27 mars 2017. En avril 2017, le Salon du livre de Genève annonce sur son site officiel : «Oui, vous avez bien lu ! Marc Levy, l'auteur aux 40 millions de livres vendus nous fait l'immense plaisir d'être présent au salon.»
[3] Joël Dicker, sur son site officiel : https://joeldicker.com/about/
[4] Entretien avec Jean Leclercq, 2012, http://www.le-mot-juste-en-anglais.com/2012/12/entretien-exclusive-avec-joël-dicker.html
[5] Nathalie Heinich, Être écrivain. Création et identité, La Découverte, 2000, p. 31.
[6] Entretien de Joël Dicker à Mirmag (magazine de la banque privée Mirabaud, Genève), août 2016, https://www.mirabaud.com/fr/mirmag/mirmag-detail/article/1469632123-joel-dicker-talent-passion-et-creativite/
[7] Entretien avec François Alquier, 21 novembre 2012, http://www.mandor.fr/archive/2012/12/15/joel-dicker-interview-pour-la-verite-sur-l-affaire-harry-que.html
[8] Ibidem.
[9] Raphaël Leroy, «Joël Dicker en pilote pour faire la pub de Swiss, ça fait jaser», Le Matin, 18 octobre 2015.
[10] Véronique Rohrbach, L'Ordinaire en partage. Le courrier des lecteurs à Georges Simenon, Presses universitaires de Rennes, 2017.
[11] Jérôme Meizoz, La littérature «en personne». Scène médiatique et formes d'incarnation, Slatkine, «Erudition», 2016, dont on peut lire l'introduction dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula, sous le titre "L'exposition de l'auteur".
[12] Raphaël Leroy, «Joël Dicker en pilote pour faire la pub de Swiss, ça fait jaser», art. cit.