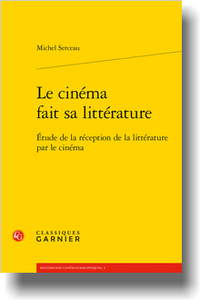
M. Serceau, Le cinéma fait sa littérature. Étude de la réception de la littérature par le cinéma
Michel Serceau
Le cinéma fait sa littérature. Étude de la réception de la littérature par le cinéma
Paris, Classiques Garnier, coll. Recherches cinématographiques, 2019
EAN : 9782406086468
530 p. — 59,00 €
Qu’est-ce que le cinéma doit à la littérature ? Cette question, qui déborde de loin le cadre de l’adaptation, relève des études de réception. Le présent ouvrage examine donc ce que le cinéma a effectivement pris en compte des formes et genres de la littérature, de ses auteurs, quels qu’ils soient.
Table des matières, etc. (en ligne)
Table des matières
AVERTISSEMENT 7
INTRODUCTION 9
DES RELATIONS SÉMIOTIQUES ET NON LINGUISTIQUES 23
L’impasse de la littérarité et de la cinématographicité 23
Cinéma et théâtre.
Une greffe hasardeuse 32
Cinéma et poésie.
Histoire et raisons d’un impossible mariage 55
De la saga au péplum.
La survie de l’épos 85
Cinéma et roman.
La greffe d’un mode plus que d’un genre 99
DES ANTIQUES AUX MODERNES
La réception du théâtre par le cinéma 117
La faible réception des tragédies et drames antiques et classiques 120
La faible réception des dramaturges modernes 128
La réception de la comédie classique 134
La prégnance du théâtre de boulevard 136
Le théâtre dans les grandes filmographies.
Convergences et divergences 142
La place et le poids du théâtre dans le cinéma français 143
La place et le poids du théâtre dans le cinéma italien 155
La place et le poids du théâtre dans le cinéma américain 159
Le théâtre dans deux filmographies non-occidentales 167
La place et le poids du théâtre dans le cinéma égyptien 167
La place et le poids du théâtre dans le cinéma japonais 173
DES CLASSIQUES AUX MODERNES
La réception du roman par le cinéma 179
Le cinéma allogéne aux classiques, aux modernes, aux révolutions et à la déconstruction du roman 180
La réception de la littérature antique et de la littérature médiévale 187
La faible fortune cinématographique du roman classique 190
La faible fortune cinématographique des modernes. 206
La réception du roman naturaliste 208
Du roman-feuilleton au roman prolétarien en passant par le sérial.
Quelle réception du roman populaire ? 211
La réception du roman historique, d’aventure et de leurs avatars (exotisme, orientalisme…) 221
La réception du roman policier 226
La réception de la littérature de science-fiction 233
La réception de la littérature fantastique 236
Le roman dans trois grandes cinématographies occidentales.
Convergences et divergences 242
La place et le poids du roman dans le cinéma français 245
La place et le poids du roman dans le cinéma italien 262
La place et le poids du roman dans le cinéma américain 271
Le roman dans deux filmographies non occidentales 280
La place et le poids du roman dans le cinéma égyptien 280
La place et le poids du roman dans le cinéma japonais 287
L’universalité est l’exception et non la règle 291
LA PART DE LA LITTÉRATURE DANS LES ŒUVRES DES GRANDS CINÉASTES…
Et de quelques autres auteurs 293
Des ratios très variables 300
Des filmographies indigènes, voire autistes 309
Les classiques pas davantage que les modernes 316
La qualité des adaptations ne dépend pas de la qualité des textes littéraires 323
L’art difficile de la transposition.
De quelques réussites et de quelques échecs 329
L’intertextualité plus que l’adaptation 337
LE CINEMA RÉANCRE LA LITTÉRATURE DANS L’ÉPISTÉMOLOGIE DU SIGNIFIÉ 343
Plusieurs formes, niveaux et degrés de réception 343
Le corps plus que l’âme ? 353
La parodie comme forme de réception 362
Variations, suites et préquelles 378
Texte/intertexte/métatexte 385
LE CINÉMA SUR LA PENTE DU MYTHOS PLUS QUE DU LOGOS, ÉCHO DES GRANDES QUESTIONS CIVILISATIONNELLES ET MIROIR DE LA PSYCHÉ COLLECTIVE 401
La vie dans le cinéma des grands thèmes, motifs et figures littéraires.
Synchronies et asynchronies avec la littérature, dyschronies, uchonies 406
La question de la cité.
Le cinéma sur la pente de la dystopie 417
La question du mal 424
De Mabuse aux superhéros : les figures du mal et leurs antonymes 424
De Faust à Frankenstein, les avatars de Prométhée 431
La contre-figure du héros civilisateur, Orphée 435
La question de la violence 439
De quelques représentations 439
Face à la violence, les figures d’Électre et Antigone 444
La question de l’amour 458
Les figures du séducteur 460
Les figures de la séductrice 464
Les figures du couple : la prégnance de Roméo et Juliette 467
L’exacerbation de quelques questions anthropologiques qui ne sont pas toujours
au premier plan dans la littérature, un exemple.
La figure du double 479
Le texte cinématographique de l’autre et la fonction cathartique du cinéma 480
De Janus aux frères ennemis : la vulgarisation de l’archétype du double 486
Du cinéma de genre au cinéma d’auteur : la revification de l’archétype du double 491
CONCLUSION
Un signifié allogène aux arts institués 495
BIBLIOGRAPHIE 503
INDEX DES ÉCRIVAINS ET CINÉASTES 511